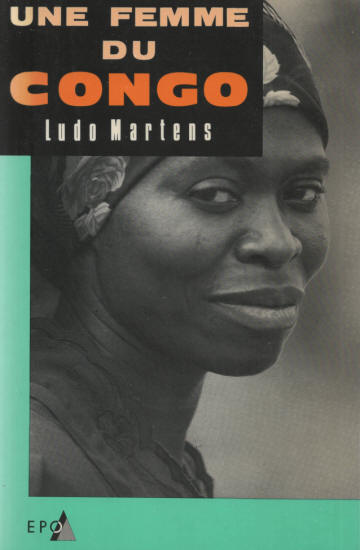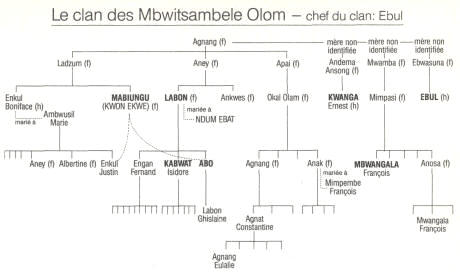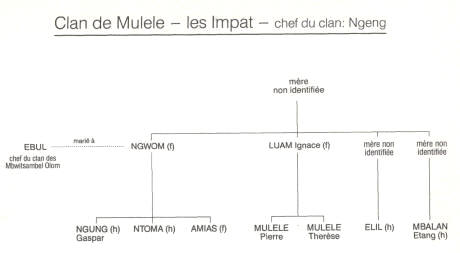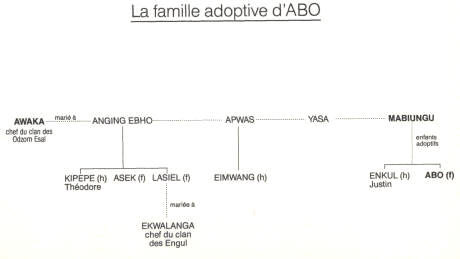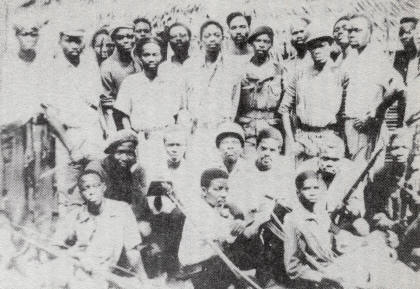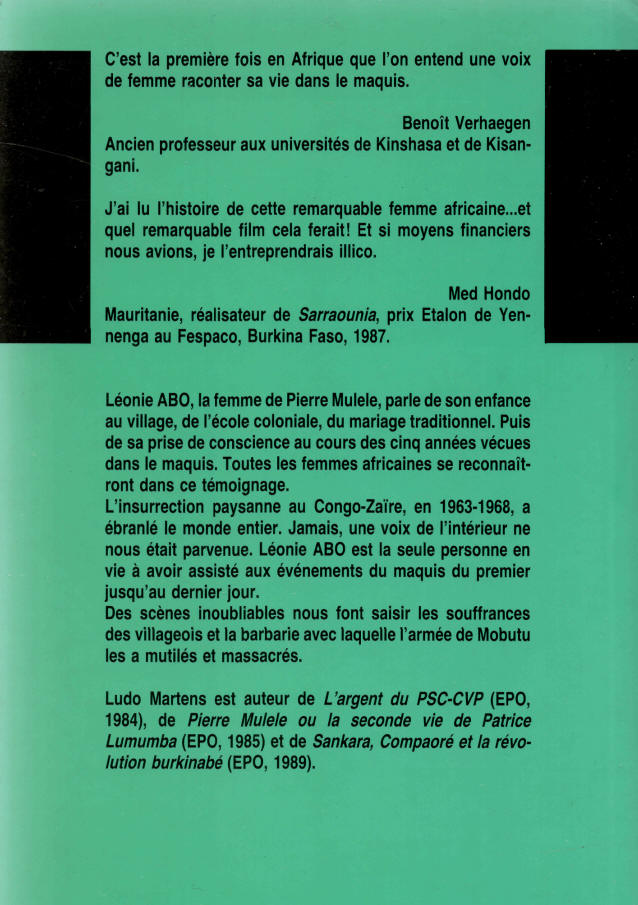|
Une femme du Congo
-
Ludo Martens, 1991 |
|
Couverture: Liliane Pauwels, Photocomposition et impression: EPO, 1991 Editions EPO 20A rue Houzeau de Lehaie 1080 Bruxelles - Belgique, Lange Pastoorstraat 25-27 2600 Anvers — Belgique, D 1991/2204/6 ISBN 2 87262 046 X Couverture arrière (Contenue) - Table de matières C'est la première fois en Afrique que l'on entend une voix de femme raconter sa vie dans le maquis. Benoît Verhaegen, Ancien professeur aux universités de Kinshasa et de Kisan-gani. J'ai lu l'histoire de cette remarquable femme africaine...et quel remarquable film cela ferait! Et si moyens financiers nous avions, je l'entreprendrais illico. Med Hondo, Mauritanie, réalisateur de Sarraounia, prix Etalon de Yen-nenga au Fespaco, Burkina Faso, 1987. Léonie ABO, la femme de Pierre Mulele, parle de son enfance au village, de l'école coloniale, du mariage traditionnel. Puis de sa prise de conscience au cours des cinq années vécues dans le maquis. Toutes les femmes africaines se reconnaîtront dans ce témoignage. L'insurrection paysanne au Congo-Zaïre, en 1963-1968, a ébranlé le monde entier. Jamais, une voix de l'intérieur ne nous était parvenue. Léonie ABO est la seule personne en vie à avoir assisté aux événements du maquis du premier jusqu'au dernier jour. Des scènes inoubliables nous font saisir les souffrances des villageois et la barbarie avec laquelle l'armée de Mobutu les a mutilés et massacrés. Ludo Martens est auteur de L'argent du PSC-CVP (EPO, 1984), de Pierre Mulele ou la seconde vie de Patrice Lumumba (EPO, 1985) et de Sankara, Compaoré et la révolution burkinabé (EPO, 1989). Table des matières - Livre Glossaire 1. 1945 - 1951, A Malungu et Lukamba
Carte 1, chapitre 3, 4 en 17 * Arbres généalogiques - Table de matières
L'arbre généalogique du clan d'Abo, tel qu'elle a pu le reconstituer. Dans le système matrilinéaire, chacun appartient au clan de sa mère. L'arrière grand-mère d'Abo est Agnang; elle eut des sœurs qu'Abo ne connaît pas. Tous leurs descendants par filiation matrilinéaire sont des frères et des sœurs d'Abo. Pour des raisons pratiques, nous avons mis les enfants de Boniface Enkul dans ce schéma, quoiqu'ils appartiennent au clan de leur mère, Marie Ambwusil. Pour la clarté du tableau, nous avons retenu essentiellement les personnes qui apparaissent dans le témoignage d'Abo.
Glossaire (Repris du réédition Abo, Une femme du Congo, l'Harmattan, 1995) - Table de matières A la commande. Châtiment où les mains et les pieds sont liés ensemble derrière le dos.Authenticité. L'idéologie officielle de Mobutu qui prétend retourner aux valeurs authentiques, traditionnelles de l'Afrique pré-coloniale; en réalité il s'agit d'une idéologie néocoloniale qui justifie le pouvoir de la grande bourgeoisie zaïroise et du contrôle étranger en se basant sur les traits les plus réactionnaires de la tradition. Boubou. Tunique africaine, longue et large. Boy. Employé de maison noir. Cadre, dirigeant politique ou militaire dans le maquis. Capita. Surveillant, contremaître Chef médaillé. Un chef était désigné selon les régies traditionnelles, mais seuls les chefs qui étaient reconnus comme tels par les autorités coloniales pouvaient en fait exercer leurs fonctions; on les appelait "chefs médaillés" parce qu'ils recevaient une médaille comme preuve de leur investiture. Chefferie. Un groupement traditionnel, organisé sur base de relations familiales indigènes et reconnu comme unité administrative par les autorités coloniales.Chicotte. Fouet utilisé pour frapper les Noirs, comme punition, dans le Congo belge.Cité. Quartier d'habitations pour Noirs dans la ville.Comité de village. La direction politique de la résistance dans un village donné.Equipe. Groupe de partisans d'un village donné et dont le nombre variait de 20 à 150. Aussi: un groupe de partisans qui exécutaient ensemble une mission.Evolué. Noir qui avait atteint un certain niveau d'instruction et à qui les autorités coloniales reconnaissaient un certain «degré de civilisation».Flamand. Injure utilisée au Congo belge pour désigner un Belge ou un autre Blanc.Force publique. Nom de l'armée coloniale belge, qui consistait en soldats et sous-officiers noirs, encadrés par des officiers belges.Groupement. Rassemblement d'«indigènes» sur base de relations traditionnelles ou de liens établis par le pouvoir colonial.Hangar. Grand auvent de branches, de feuilles et d'herbe. Kwashiorkor. Maladie de sous-alimentation, causée par manque de protéines animales. Laisser passer. Papier administratif qui permettait certains dé placements.Maquis. Territoire où la résistance armée se regroupait Aussi l'organisation qui menait la lutte armée. Militant. Participant actif au mouvement de résistance. MPR. Mouvement Populaire de la Révolution, fondé le 20 mai 1967 par Mobutu. Le MPR deviendra le parti unique et sera proclamé «Parti-Etat». Chaque Zaïrois en est membre dès sa naissance. Mundele. Blanc, en lingala, une des quatre langues officielles du Zaïre.Pacification. La répression militaire de l'insurrection populaire au Congo (1963-1966), menée par des mercenaires venus d'Afrique du Sud et de Rhodésie, ainsi que des militaires belges et des soldats de Mobutu, était appelée pacification. Pagne. Vêtement africain traditionnel. PNP. Parti National du Progrès. Parti politique fortement conservateur, érigé en novembre 1959 avec le soutien des autorités coloniales belges. Surnommé «Parti des Nègres Payés» par la voix populaire. «Un PNP» est devenu le nom injurieux de chaque partisan noir du colonialisme et du néocolonialisme.Pousse-pousseur. Quelqu'un dont le travail est de transporter des charges sur une charrette qu'il pousse ou qu'il tire.PSA. Parti Solidaire Africain. Parti radicalement anticolonial et nationaliste, fondé en avril 1959 par Pierre Mulele, qui en deviendra plus tard secrétaire-général, tandis qu'Antoine Gizenga y exercera la présidence.Réactionnaire. Partisan du vieil ordre colonial ou néocolonial.Renégat. Quelqu'un qui a trahi ses convictions révolutionnaires.Secteur. Unité administrative coloniale, formée en rassemblant des groupements traditionnels, plus petits.Territoire. Le Congo belge était divisé en provinces, districts et territoires.Wax. Un morceau de tissu de coton, souvent très coloré, avec quel les femmes africaines confectionnent leurs vêtements.Zone. Une division administrative de la zone libérée. Le maquis du Kwilu était d'abord divisé en trois zones, puis en huit.1. 1945-1951 A Malungu et Lukamba - Table de matières Naissance d'Abo, mort de sa mère. Chez le père Awaka et ses quatre femmes. Contes autour du feu. Magie et mystères à Lukamba. L'aristocratie villageoise et l'administration coloniale. Les cinq clans de Lukamba Bozombo. La mère Mabiungu a un serpent dans le ventre. 15 août 1945. Malungu, un grand camp de coupeurs de noix de palme, qui travaillent sur les palmeraies de la Compagnie du Kasaï. Des dizaines de cases en pisé bien alignées. Au loin la rivière Kwilu chantonne. Accroupis dans la pénombre autour des braises du feu, des hommes tendent l'oreille. D'une hutte leur parviennent des gémissements, des pleurs, un bruissement affairé de pagnes. La sage-femme, après avoir coupé le cordon ombilical à l'aide d'une lame de rasoir, saisit entre les doigts une pincée de cendres de bois de palmier et les applique sur la blessure pour stopper l'hémorragie. Elle est contente, la sage-femme. Rarement, elle a délivré une petite fille aussi adorable et robuste. Tout sera pour le mieux si maintenant l'enfant accepte le nom que sa mère lui a trouvé. Labon, la femme qui vient d'accoucher, a fait un songe, il y a quelques mois. Abo, une tante décédée il y bien des années, lui a révélé qu'elle reviendrait bientôt parmi les siens. Chez les Bambunda(1), chaque nouveau-né incarne l'esprit d'un mort. Il importe donc de l'appeler par son véritable nom. Si on lui donne un nom qui ne convient pas, le bébé s'agite, pleure et proteste violemment. Il faut alors consulter le féticheur pour découvrir l'identité exacte de la revenante. Précautionneusement, la sage-femme souffle le mot "Abo" à l'oreille du bébé. Et, malheureusement, l'enfant sourit. Son nom est bien Abo, ce qui, dans la langue des Bambunda, veut dire: le Deuil. Peu après, Labon tombe malade et, de ses yeux fiévreux, voit rôder la mort autour de sa case. Dans son délire, elle est tourmentée par cette horreur qu'on croyait appartenir à un passé révolu. Lorsque, dans un clan, on ne trouve aucune femme qui dispose de moyens pour nourrir un bébé orphelin, on l'enterre vivant avec sa mère. Labon est obsédée par l'idée qu'à sa propre mort s'ajoutera un deuil bien plus déchirant. Heureusement, les esprits des ancêtres veillent à éviter un si grand malheur. Il y a quelques mois, l'oncle Ebul, le chef du clan, a passé, sans raison apparente, quelques jours tourmentés, absorbé dans des pensées noires. Soudain, Ebul a sursauté. En un éclair, il s'est rappelé que le clan avait vendu, il y a bien vingt ans, une fillette à Tutshi, un homme de Lufusi. Ebul s'est souvenu clairement de la nuit au cours de laquelle on a emmené sa petite sœur Kwon Ekwe, dont le nom veut dire en kimbunda: Où irai-je? Des inconnus l'ont fait marcher longtemps, parcourir tours et détours pour qu'elle ne puisse pas retrouver son chemin. A Lufusi, Kwon Ekwe a trouvé une nouvelle famille à laquelle elle n'a pas tardé à s'attacher. Quand elle a atteint l'âge nubile, un Pende de Bondo a payé la dot pour la marier. Dans sa nouvelle famille, Kwon Ekwe s'appelle désormais Mabiungu wa Tutshi. Comme elle se révèle être stérile, ses beaux-parents veulent bientôt s'en débarrasser. Mais Mabiungu s'est attachée à son mari et celui-ci aime sa femme. Elle reste donc. A ce moment arrive à Lufusi une délégation de Lukamba Bozombo, envoyée par Ebul. Elle négocie le rachat de Mabiungu, l'esclave, par son propre clan. Désespérée, Mabiungu se soumet à ce deuxième exil. Mabiungu se trouve depuis quelques jours à peine aux côtés de Labon, que celle-ci sent entrer la mort dans sa maison. D'une voix affaiblie, Labon confie alors à sa sœur ses dernières volontés. - Comme tu ne mets pas au monde, Abo sera ta fille. Puis, heureuse d'avoir pu sauver ainsi sa petite fille d'une mort atroce, Labon expire dans les bras de Mabiungu. La famille porte son cercueil de Malungu à Lukamba Bozombo, le village natal de Labon, où il sera mis en terre. Ses frères et ses sœurs se placent des deux côtés de l'épon , le cercueil en bois de palme où repose la dépouille enveloppée d'un tissu de raphia. Mabiungu et son nouveau mari, Awaka, passent la petite Abo, de mains en mains, neuf fois au-dessus de l'épon. Mabiungu nourrit sa fille adoptive au vin de palme frais. Rien de plus sucré que le premier vin tiré d'un jeune palmier. Elle pile aussi des tiges de canne à sucre et en administre le jus blanchâtre à Abo. Les ancêtres, troublés sans doute par le remords, ménagent alors un bout du paradis pour que la petite Abo y vive quelques années merveilleuses. Et la grand-mère Aney, qui comprend parfaitement les ancêtres pour devoir bientôt les rejoindre, donne à sa petite-fille un second nom: Ndzung a Bwegn, Femme qui fait de beaux enfants. C'est Awaka, le père adoptif, qui a offert à la petite fille un coin de rêve près de la rivière Lukamba. Il y possède une des parcelles les plus spacieuses du village, entièrement clôturée de hautes palissades. De nombreux palmiers, arbres à raphia, bananiers, citronniers inondent de leur ombre rafraîchissante la parcelle au centre de laquelle est blottie la grande maison d'Awaka. Au-dessus des deux entrées, Awaka a fixé Yenkwetye, le fétiche qui protège la demeure contre la foudre. Awaka a déjà trois femmes, au moment où il accepte d'épouser Mabiungu et d'élever la petite Abo. Sa première femme, Anging Ebho, l'a comblé de trois enfants, déjà adultes au moment où Abo entame la reconnaissance de la parcelle paternelle. De temps à autre, elle y tombe sur le fils aîné, Théodore Kipepe, inséparable de son turbulent ami Louis Kafungu. Les deux filles d'Anging Ebho s'appellent Asek et Lasiel. Lasiel a été mariée à Ekwalanga, le chef du hameau Sodome de Lukamba Bozombo. Quant à Apwas, sa deuxième épouse, elle promène fièrement son fils Eimwang. La troisième femme d'Awaka, Yasa, est stérile. Les quatre épouses habitent chacune leur propre case à l'intérieur de la cour. Au fond, il y a une porcherie, une bergerie et une case pour les chèvres. Juste derrière la parcelle s'élève un gigantesque fromagier qui abrite d'innombrables nids d'ayus, des petits oiseaux qui s'abattent parfois par centaines sur l'arbre géant. Au crépuscule, les à la maison, ne sortez pas dans la forêt parce qu'un diable y erre qui pourrait vous manger". Les jours passent et les enfants restent bien sagement à l'intérieur. Mais finalement l'aîné en a assez et s'en va prendre l'air dans la forêt. Quand il a beaucoup marché, il entend un coup: bong! - Qui est là? Le diable fait son apparition et l'enfant lui demande: - Pourquoi es-tu venu? - Ne sais-tu pas que je suis le chef des diables et que je mange les enfants? L'aîné le supplie de le laisser en vie. - Bon, mais qu'est-ce que tu m'offres en échange? - Passe ce soir à la maison, je te donnerai la tête d'un de mes petits frères. De retour à la maison, l'aîné oublie vite ce cauchemar. Mais à la tombée de la nuit, il entend: bong, bong! - Qui est là? Ici, le conteur et les enfants qui l'entourent entonnent la chanson de Yetsh Abong. toi tu as dit que ce soir je vienne prendre une tête. Alors Yetsh Abong attrape un enfant et l'entraîne en forêt Le lendemain soir, le drame se répète. Et chaque soir, le diable vient entonner la chanson de Yetsh Abong. Le père revient au moment où il ne reste plus que l'aîné à la maison. L'enfant lui raconte tout. Le soir, le diable arrive et se met à chanter. Le père se cache derrière la porte, armé de son arc et de ses flèches. L'enfant répond au diable pour qu'il ne se doute de rien. Au moment où le gamin ouvre la porte son père tire une flèche dans la poitrine de Yetsh Abong qui supplie qu'on ne le tue pas et promet de montrer l'endroit où se trouvent les enfants. Après avoir libéré ses enfants, le père achève le diable. A l'issue de ce premier conte, le lecteur doit savoir que le vieux Mumbunda, qu'il vient d'écouter, a parsemé son histoire d'allusions et de messages codés que seuls les anciens peuvent déchiffrer. Il le vérifiera plus tard, quand il suivra Abo dans sa longue marche à travers les maquis du Kwilu. Mais retournons auprès du feu pour une deuxième veillée après une journée fort épuisante. Charlotte Mumputu et Anzawe, deux grandes sœurs d'Abo, sont de passage à la parcelle et ont emmené la fillette en brousse pour une randonnée pleine d'espiègleries. Au crépuscule nous retrouvons Abo, blottie contre son amie Amias, la fille de l'oncle Ebul, de deux ans son aînée, immobile, les coudes plantés sur les genoux, les bras croisés sur la poitrine, les mains cramponnées aux épaules. Qu'il fait bon avoir peur à quatre ans.Un matin, une femme se rend à son champ et laisse ses dix enfants mettre de l'ordre dans la maison. - Quand vous avez fini, rejoignez-moi, dit-elle, mais prenez bien le petit sentier. Car elle sait que sur la grande route, il y a plein de dangers. Mais les enfants ne sont pas obéissants et bien vite, sur la grande route, ils croisent un premier diable. - Où allez-vous? - Nous suivons maman aux champs.Ils rencontrent neuf diables auxquels ils donnent la mêmeréponse. Puis arrive un dixième diable, pourvu de dix ventres, à l'aspect terrifiant. - Où allez-vous? - Nous suivons maman aux champs. - Non, je vais vous cachez ici. Et il montre ses dix ventres. Lorsque la mère revient à la maison, elle ne trouve plus personne. Elle appelle son mari et lui dit que le diable a sûrement mangé les enfants. Ensemble, ils prennent la grande route. Le premier diable qu'ils rencontrent, ils l'éventrent mais ne trouvent rien. Quand ils s'emparent enfin du dixième diable, ils ont beaucoup à tailler à coups de couteau pour ouvrir tous ses ventres. Neuf enfants en sortent vivant mais le dixième a été mortellement blessé par la lame. Le cœur déchiré, la maman jette le cadavre dans l'eau. Des mois plus tard, l'aîné s'assoit près de la rivière, perdu dans de tristes souvenirs. - J'avais une petite sœur mais maman l'a jetée à l'eau. Un bruit étrange lui répond de la rivière. Surpris, l'enfant fixe l'eau et en voit émerger lentement sa sœur. Celle-ci se presse contre lui et le console. - Ne me pleure pas, je me trouve bien là où je suis. Ma plaie est déjà guérie. Viens me voir chaque matin, mais ne dis rien à personne.Mais un jour l'enfant trahit le secret à sa mère. Celle-ci le frappe violemment.- Ne me raconte pas de bêtises!- Viens demain matin avec moi, cache-toi dans la brousse et tu verras.Et le lendemain, la mère voit sa fille surgir de la rivière et elle l'entend chanter.
Maman m'a abandonnée le tam-tam roule roule La mère sort de sa cachette et prend sa fille dans ses bras pour la ramener à la maison. La famille fait la fête toute la journée. Le lendemain, la maman, toute heureuse, prend lechemin des champs. Mais sa petite fille, restée à la maison, voit monter de l'eau autour de ses pieds. Alors, elle commence à chanter. L'eau monte jusqu'à ses genoux, jusqu'à sa taille, jusqu'à son cou pendant qu'elle continue sa chanson.
Quand la mère revient, elle trouve sa maison inondée et sa fille a disparu. Frémissant de peur, Abo court chercher refuge contre le corps de sa mère et s'assoupit dans une paix toute charnelle. Le lendemain commence une nouvelle journée remplie de découvertes. A la fin de l'après-midi, quand le soleil ne fait plus éclater la brousse de couleurs criardes mais s'apaise dans des tons de pastel, la petite Abo emmène ses amies vers la rivière Lukamba qui prend sa source entre Bant-samba et Ingudi. A certains moments de l'année, la rivière se réduit misérablement à un filet d'eau impuissant, mais après l'orage elle se déchaîne et se gonfle de violence. Sur les bras de sa mère, Abo a déjà parcouru les six villages qui constituent Lukamba, et dont une chanson aide à retenir les noms.
Il arrive que vers Misadi, l'eau de la rivière Lukamba soit possédée par des esprits qui la font tourbillonner en une danse diabolique. Alors les grands chefs se dépêchent d'aller jeter des nzimbus et des poulets vivants au cœur de cette force magique et tournoyante. L'argent et la viande apaisent les esprits. Un jour, le chef de village y a sacrifié un poulet tout blanc. Deux jours plus tard, des villageois ont vu sortir de l'eau, exactement au même endroit, un poulet d'un noir d'enfer. Aussi Mabiungu défend-elle aux enfants de se baigner à certains endroits. Un soir Abo et ses amies désobéissent. Après la baignade, une fille sort de la rivière, la joue ouverte de l'oreille jusqu'au menton le sang teintant sa poitrine d'un rouge glaireux. En face'de l'endroit maudit se trouve un petit cimetière. Les morts qui y reposent ne supportent pas qu'on les dérange. De temps à autre, à lourds froufrous d'ailes, un hibou géant descend sur les arbres de Lukamba Bozombo. Ses cris monotones et agaçants annoncent un décès. Dès que son apparition est signalée, les hommes adultes décrochent leurs arcs pour faire la chasse au messager du malheur. - Abo, cette nuit appartient au hibou; celui qui quitte sa case ne verra plus l'aube. Parfois aussi, en pleine nuit, on entend un léopard feuler dans les champs près du village. Or, un véritable léopard ne viendra jamais faire du bruit auprès des maisons. Un jour, un vieillard de Bozombo est décédé et depuis lors, plus personne n'a entendu les feulements étranges du léopard. Les villageois ont compris: c'était le vieux sorcier. Lukamba Bozombo se divise en deux parties: sur les hauteurs se trouve Sodome, en bas Gomorre. Les deux hameaux doivent leur surnoms aux pluies torrentielles, aux vents affolants, aux foudres et aux éclairs meurtriers qui font trembler les villageois, lorsque, surpris dans leurs champs par l'orage, ils se sauvent, la terreur au ventre, ne sachant pas s'ils arriveront vivants à la maison. Anak, une sœur d'Abo, a vu sa mère Okal Olam carbonisée par la foudre. Quand les flammes se sont éteintes, elles ont laissé sur place un coq majestueux aux longues plumes couleur arc-en-ciel. Les villageois prétendent que les gens qui commandent au tonnerre vivent au pays des Badinga, loin de Lukamba. Mais certains pensent qu'Ekwalanga, chef de Sodome et mari de Lasiel, la sœur d'Abo, ainsi que Bakanga, un vieux de Gomorre, possèdent aussi le pouvoir de manier la foudre. Les villageois de Lukamba savent pourquoi Awaka possède tant de bêtes et d'argent: il connaît le secret de Yoyek, le fétiche qui comble tous vos vœux. Ils n'ignorent pas non plus ses pouvoirs de sorcier: il peut tuer des gens pour que, morts, ils surveillent ses bêtes.Régulièrement Awaka égorge un mouton ou un cochon et les gens viennent même de Kimbanda et d'Indele, deux villages situés à six kilomètres, pour acheter la viande'. Chaque jour, la famille d'Awaka peut manger des dindons, des canards, des poulets qui grouillent dans la parcelle. Cette abondance provoque de l'animosité chez tous ceux qui d'ordinaire, doivent se contenter de manioc et de poisson' Quand un cochon appartenant à Awaka ravage le jardin potager d'un villageois, ce dernier aura un plaisir vengeur à tuer l'animal en cachette.A Lukamba Bozombo, Awaka fait partie de cette humble aristocratie villageoise composée de notables de naissance et d'éducation. Le village doit son nom au clan Bozombo, Odzom en kimbunda, qui le dirige. Le plus haut dans la hiérarchie coutumière s'appelle Obung, le chef des Odzom Abuun; il est suivi par Awaka, le chef des Odzom Esal et par Ngeng, le chef de clan des Impat. Chaque fois qu'un Blanc vient honorer le village de sa présence, il revient à Obung, à Awaka et à Ngeng de mobiliser la population comme il convient pour un événement aussi solennel. Mais aux yeux d'Abo, les hommes les plus riches de la planète, ce sont les quatre chrétiens les plus en vue de Bozombo. Louis Labun, Louis Ikuma, l'enseignant, et Louis Mimpia, le chef de secteur de Lukamba possèdent une tenue chic de Blanc, un costume au grand complet, chapeau, veste, pantalon et chaussures; ils roulent à vélo et, raffinement suprême, ils jouent des disques sur un phonographe. Le veston surtout fait impression au point qu'on l'appelle révé-rencieusement kadzak en kimbunda. Le tailleur Ernest Kwanga, oncle d'Abo, atteint presque cet état d'abondance avec son costume, son vélo et sa machine à coudre. Ces quatre nouveaux riches sont chrétiens, ce qui amène les villageois à croire que la sorcellerie chrétienne produit des richesses en pagaille. Un matin, Awaka quitte la parcelle avant l'aube. Toute la journée, Abo, qui pressent quelque drame fabuleux, le suit de loin et épie ses moindres mouvements. En pleine brousse, en un va-et-vient chaotique et nerveux, Awaka dirige la construction d'un espace mystérieux, recouper d'une sorte de baldaquin d'herbes et de grandes feuilles.Le lendemain très tôt, après une tournée au village, Awaka rentre à la parcelle, un grand panier d'œufs à la main et cinq poulets ligotés aux pattes, jetés sur l'épaule. Abo savonnée par sa mère à en perdre sa couleur et presque écorchée à force d'être frottée à la pierre ponce, observe à travers ses larmes le remue-ménage inhabituel devant la cour. Tenue en main par sa mère vêtue de son pagne orange-rouge-blanc à ramages, tenue de fêtes et de solennités, Abo se fait aspirer par une foule agitée. Dans les bras de sa mère, qui a pris place dans les files de femmes et d'enfants, elle trouve de quoi tromper sa curiosité pendant une demi-heure puis, comme en un songe, elle voit son père apparaître marchant gravement à côté d'un géant blanc. Le demi-dieu belge au regard sévère, arrivé sous le baldaquin d'herbes et de feuilles, pose ses fesses sur un grand fauteuil dans un mouvement tellement lent qu'on dirait qu'il va pondre un œuf. Awaka et les quatre autres chefs de clan de Lukamba prennent place sur des chaises, un peu en retrait. Les heures passent, le soleil poignarde l'attroupement. Les adultes perdent leur raideur et leur air endimanché pour s'affaisser, un à un, tels des fêtards éméchés. Les enfants pleurent ou hurlent sous un ciel suintant le feu, tandis que les femmes d'Awaka répandent de l'eau autour du Blanc. Abo ne comprend rien mais remarque que six garçons, l'air penaud, s'attroupent non loin du Blanc, le regard rivé sur les matraques des policiers noirs. C'est le jour du recensement. Chaque chef de clan doit présenter les membres de sa famille dont les noms figurent dans le registre du Blanc. Des agents comptent les dents des garçons pour estimer leur âge et fixer ainsi le montant de l'impôt.- Dans notre propre pays, nous sommes devenus des étrangers, des bêtes domestiquées. C'est ce que lancera, le soir autour du feu, Louis Kafungu. Mais Abo ne comprendra pas. La scène se répète chaque année. Abo voit des hommes, une corde au cou, attachés les uns aux autres. Parfois ils sont vingt, parfois quarante, venant de tous les groupements du secteur Lukamba. Les six agents de police leur ramollissent la chair à la matraque. Les prisonniers n'ont pas paye leurs taxes. Chaque année, il y des têtes dures qui fuient en forêt avant l'arrivée du collecteur d'impôts. Le Blanc prend alors leur oncle ou leur grand frère en otage et attend que le coupable se rende. Le Blanc n'ose pas pénétrer dans la forêt.La petite Abo a été impressionnée par l'attitude fière de son père nourricier, dignement installé à côté de l'administrateur territorial. Mais plus tard, quand elle commencera à découvrir l'inclination cachée de l'âme derrière les gestes, sourires et révérences, Awaka lui dira un secret. En 1931, un mundele sanguinaire, qui semait la mort parmi les coupeurs de noix de palme, devait passer par Lukamba. Nous avions décidé de le trouer de nos lances. Mais les villageois de Kilamba nous ont devancés. Ils ont dépecé le Blanc pour en faire des fétiches. Abo apprend très tôt que son père est le chef des Odzom Esal, mais qu'elle appartient, quant à elle, à un autre clan. Le monde de la petite Abo, pour être réduit à la grandeur d'un mouchoir, ne manque pas de complications: il importe de connaître les six villages Lukamba, les dix villages Matende, les quatre rivières qui parcourent Lukamba, les cinq clans qui vivent à Bozombo. Comment retenir tant de noms? Un professeur hors pair vient au secours des enfants: le célèbre conteur Abong d'Idiofa. Il chante l'histoire des Bambunda, la géographie de la région, les noms des notables et des clans. Abong appartient au même clan qu'Abo, celui des Mbwitsambele, renommé dans toute la région mbuun et dont les membres se retrouvent dans presque tous les villages. Abo apprend que le léopard est le mbil, le totem de son clan. Le roi des animaux symbolise la place de choix qu'occupent les Mbwitsambele parmi les Bambunda. Abo sait qu'elle tomberait malade si elle osait manger du léopard et qu'il lui est interdit de toucher l'animal. L'oncle Ebul est le chef principal des Mbwitsambele à Bozombo. Au fil des ans, les cinq clans du village ont noué de nombreuses alliances. Ainsi, la femme de l'oncle Ebul, Ngwom, appartient au clan des Impat, de même, bien sûr, que sa sœur Ignace Lua*n qui vient souvent en visite à la parcelle d'Ebul. Ngwom a mis au monde trois enfants, Gaspar Ngung, Ntoma et une fille, Amias. Sa sœur Ignace a un garçon et une fille, Pierre et Thérèse Mulele. Tous sont des Impat. A Bozombo, il y aussi les Engul, dont Ekwalanga est le chef, et les Lasang.Comme les autres grands chefs, Ebul est renommé pour ses pouvoirs magiques. Il possède le secret du mpipil, le médicament qui vous rend invisible et de l'ekwet, le produit qui fait chuter votre poids par magie. Vers 1950, l'agent territorial est venu à Lukamba, recruter des jeunes pour la Force Publique. Comme l'armée ne prend que les garçons robustes, elle fait peser les candidats. Fernand Engan, le frère aîné d'Abo, risquait d'être enrôlé. Heureusement, Ebul a eu le temps de lui faire avaler son médicament. Quoique Engan fût costaud et bien portant, la balance a indiqué le poids insignifiant d'un garçon maladif. L'ekwet l'a sauvé de l'armée. Abo n'apprendra cette histoire qu'un an plus tard, au moment de découvrir que sa mère lui avait donné deux frères, Engan, né en 1935 et Isidore Kabwat, venu au monde quatre ans plus tard. Ils ont été élevés chez Enkul Boniface et Abo les rencontre pour la première fois vers l'âge de six ans.Quand Abo accompagne son père et sa mère dans les villages environnants, elle rencontre partout des Mbwitsam-bele. A Mulembe, elle est la sœur de Casimir Malanda et de Pascal Mundelengolo. A Lukamba Misadi, elle appelle Maria Aliam sa maman et Liévin Mitua, son frère. Abo ne réussira jamais à retracer tous les contours du clan des Mbwitsambele qui n'est pas coiffé par un chef suprême.Abo a six ans lorsqu'une question commence à la tracasser. Elle aimerait savoir pourquoi Mabiungu est tellement plus maigre que ses autres mamans. La nuit, il arrive que sa mère serre son pagne autour de son ventre et pleure jusqu'au matin. Aux premières heures, elle prend son panier et part pour les champs. Abo l'accompagne et la regarde travailler. Sa mère gémit, presse ses mains sur son ventre, pousse des cris de douleur et vient s'asseoir à côté de sa fille. Les villageois disent que Mabiungu, lorsqu'elle a été achetée par des gens de Lufusi, a dû y boire un médicament à base de serpent qui sert, traditionnellement, à effacer la mémoire d'un esclave qu'on vient de se procurer. Depuis lors, un serpent habite le ventre de Mabiungu et lui cause des douleurs. Ce serpent l'empêche aussi de concevoir un enfant. Awaka amène sa femme chez les guérisseurs les plus célèbres de la région. La petite Abo se souviendra avec précision de la visite chez Ndzuku, le chef de village de Mungai Busongo. Ndzuku a un ventre ballottant, une toute petite tête et beaucoup de femmes. Il cherche une grande plante et recueille un liquide blanchâtre de ses tiges. Mabiungu boit le remède. Mais si le médicament tue les vers intestinaux, il reste impuissant contre les serpents. Plus tard, à Mukulu, le chef Ngambuun prend une petite calebasse remplie de feuilles de maïs auxquelles il met le feu. Avec une lame de rasoir, il trace quelques lignes sur le ventre, puis il y applique la calebasse contenant les feuilles fumantes. La ventouse colle à la peau et suce le sang. Le chef prétend qu'il peut évacuer ainsi de petits serpents. Mais tout cela ne soulage pas Mabiungu de ses maux. Le chef de Mukulu lui interdit aussi la viande de porc, de poulet, de mouton, des bêtes de la brousse, les œufs et les feuilles de manioc ou d'oseille. Pauvre femme. Abo voit sa mère ne manger que du sel indigène mélangé à l'huile de palme, du foufou — pâte de manioc — et un peu de poisson. Abo part souvent dans la brousse capturer des sauterelles que sa mère cuit dans l'eau bouillante et grille sur le feu. Son plat préféré.Lors d'une tournée avec Awaka, la petite Abo se voit montrer du doigt un homme sortant de la forêt et on lui dit: - Celui-là, c'est ton père.Jusqu'alors, elle ne connaissait pas Ndum Ebat, ce coupeur de noix de palme qui vit à Malungu. Le père embrasse sa fille et lui glisse vingt francs dans la main. Quelques jours après ces retrouvailles heureuses, Aney appelle sa petite-fille pour l'embrasser et la presser contre son corps avec une insistance chaude et triste à la fois. Finalement, après quelques vaines tentatives, elle arrive à exprimer la vérité qui, depuis longtemps, lui pèse sur le cœur.- Mabiungu n'est pas ta véritable mère. Ta maman à toi s'appelait Labon et c'est elle qui t'a donné le nom d'Abo.Abo pleure désespérément, puis court interroaer Mabiungu qui, à son tour, fond en larmes. A six ans et demi Abo fait sa première fugue chez sa grand-mère. Quand Awaka, après de longues recherches, l'y retrouve, la petite Abo lui dit:- Je veux rester chez grand-mère, puisque ma mère est morte.De retour à la parcelle, Awaka hurle à la face de sa femme:- Pourquoi ne m'as-tu pas dit qu'Aney lui a tout révélé? Il frappe Mabiungu avec un gros bâton jusqu'à ce qu'elle tombe à terre, le bras cassé. La mère ne pouvant plus travailler, Abo se rend au champ et fait péniblement quelques mètres carrés de mil dont la récolte sera fort chétive. Les rivales de Mabiungu lui apportent de la nourriture. Au moment de lui révéler la nouvelle troublante, Aney a dit à Ndzung a Bwegn, Femme qui fait de beaux enfants, en pleurant sur un souvenir trop pénible: - Avec ton visage et ton corps, je crois revoir ta mère. Dommage que nous n'avons pas de photo d'elle. 2. 1952-1957, A Lukamba et Totshi - Table de matièresL'entrée difficile à l'école du village. Longues marches pour ramener de l'argile. Les chefs coutumiers et leurs nombreuses femmes. Chansons et proverbes du tribunal coutumier. Le pont damné vers l'école primaire de Totshi. Baptême, éducation et corvées à l'école. Le mariage à douze ans?Sa vie de contes, de mystères et d'escapades, la petite Abo la passe parmi ses mamans et ses amies, voltigeant entre la parcelle et la brousse, enveloppée dans son pagne de raphia, que les cinq tisseurs du village appellent ewas. Au moment de quitter ce monde idyllique pour celui de l'instruction, elle recevra son premier "tissu de Blanc". Ses deux oncles, Jakob Ndulanganda et Ernest Kwanga, chrétiens pour avoir fréquenté les cours des mon-pères, l'inscrivent à l'école de Lukamba pour l'année 1951. Mais une véritable force de la nature se mettra en travers de leur projet: la vieille grand-mère Aney, capable des plus violentes colères lorsqu'il s'agit de défendre la vie de sa petite-fille. Et elle n'en doute pas: l'école des chrétiens, c'est la mort. Indignée, elle crie à la face de celui qui aborde le sujet: - Vous voulez que notre fille disparaisse avec les Blancs? Qu'elle aille mourir là-bas? Et puis, de toute façon, l'école n'apporte rien aux filles. L'institutrice de la deuxième année, Elisabeth Kayembe, dompte des élèves de tout âge. Elle envoie les plus costauds, des garçons de dix-sept ans, cueillir Abo à la maison. Les jeunes guerriers se font insulter et taper rudement dessus par la grand-mère. Ils jettent l'éponge. Au début de l'année 1952, Jakob Ndulanganda, un énorme gaillard, doit personnellement enlever la jeune Abo de son paradis trop bien gardé. Cette fois-ci, la grand-mère ne résiste point. Louis Mimpia, le chef de secteur de Lu- kamba et oncle d'Abo, loge la jeune fille chez lui. ChaqUe matin, Abo part à l'école en compagnie de Sabine Mimpia d'une année sa cadette. Maria Aliam, l'institutrice de première année, belle femme très douce, à la voix veloutée aime les enfants qui à leur tour l'adorent. Sans effort appa^ rent, elle maintient un ordre parfait qui semble fait de calme et de bonheur. La deuxième année, par contre, se déroule comme une marche militaire. Elisabeth Kayembe est une femme trapue aux bras de fer, qui inspire la peur. Les enfants la respectent pour sa force et son courage : Abo ne tarde pas à apprendre qu'elle ose même - audace suprême - battre son mari! Lukamba Bozombo compte deux classes mixtes de deuxième primaire, l'une dirigée par Elisabeth, l'autre par Louis Kafungu. L'école se déroule en plein air et Abo y apprend surtout des choses auxquelles elle ne comprend rien: prières, signes, chants dévots, contes évan-géliques et tout le saint-frusquin. Le temps d'une maladie d'Elisabeth, l'instituteur Louis Kafungu se charge de la classe d'Abo. Avec son bâton, il met fin à toute velléité l'indiscipline. Mais les doigts d'Abo échappent à l'épreuve: depuis qu'il fréquente Théodore Kipepe, Louis la considère comme sa petite sœur. Si les élèves n'apprécient guère l'instituteur Kafungu dans son rôle de dompteur de jeunes rebelles, ils l'aiment comme animateur fougueux du groupe de scouts, inventeur de jeux d'enfants et grand blagueur. Quand Abo rentre, deux mois plus tard, à la parcelle d'Awaka, elle n'est déjà plus une petite fille. Elle s'enhardit et prend place dans le cercle de ses quatre mamans et de sa grand-mère, assises par terre. A l'aide d'une presse traditionnelle, Anak a extrait de l'huile d'une livraison de noix de palme. Maintenant, les femmes cassent les coques, pour en sortir les noix palmistes qu'elles jettent dans des corbeilles. La petite Abo, un caillou dans la main, s'efforce de casser une noix minutieusement déposée au milieu d'une grande pierre plate. Le soir, elle a rempli son minuscule panier. Le lendemain, elle trottine derrière les autres femmes qui se dirigent, à grandes enjambées, vers l'usine de monsieur Frank, sur la rivière Edzim à Kimbanda. Elle prend place dans le rang pour que le Blanc pèse le résulte de son premier labeur. Puis vient le moment de l'enchante-ment: monsieur Frank, à l'aide d'une cuillère argentée, verse de petites perles rouges, jaunes, bleues et vertes dans ses mains jointes en coupe.Il arrive qu'Abo prenne la route de l'école avec Justin Enkulr son compagnon de jeu à la parcelle d'Awaka. Justin préfère parfois se rendre à la rivière pour une journée d'ébats en pleine nature. A cette école buissonnière, Justin et Abo se font surprendre, un matin, par l'oncle Ndulangan-da. Après une verte réprimande, l'oncle Jacob noue une corde autour du cou de Justin, fixe une autre au poignet d'Abo et ramène les deux enfants dans le droit chemin de l'instruction.Rentrée de l'école un vendredi soir, Abo passe une nuit agitée à côté de sa mère: avant que l'aube ne se lève, elle accompagnera pour la première fois sa maman sur les longs sentiers qui descendent jusqu'à Malungu, près de la rivière Kwilu. Arrivée vers dix heures, Abo voit avec appréhension Mabiungu disparaître sous terre. Elle est mangée par un puits profond qui doit certainement cacher des diables : Abo n'ose même pas y jeter un coup d'oeil. Les femmes creusent la terre, enlèvent le sable pour atteindre les couches d'argile. Abo voit ressurgir sa mère, un panier plein de terre rouge, appelée tum, sur la tête. Au retour, le chemin monte lentement, continuellement. Parties vers cinq heures de l'après-midi, les femmes marchent bientôt dans l'obscurité et une lamelle de lune vacille au-dessus de la brousse. Abo marche dans la crainte des ombres et, en silence, pousse de petits sanglots. Son panier rempli de terre lui écrase la tête. Jusqu'à ce qu'elle ne tienne plus et s'assoie pour éclater en pleurs. Quand elle arrive à Lukamba Bozombo au milieu de la nuit, proche de l'épuisement, son corps semble lui échapper, elle se meut comme dans un songe.Plusieurs fois, Abo effectuera cette longue marche vers Malungu. Un jour, deux femmes de Bozombo descendent dans un de ces puits maléfiques. Elles doivent creuser toute la journée avant que la bonne terre rouge se présente. Il est trois heures, un soleil en rage terrorise la brousse, quand les femmes sentent glisser, le long de leurs corps, des ombres froides. Elles viennent d'éveiller des esprits qui tremblent de colère et qui font frémir la terre. Les paroi s'effondrent et étouffent les hurlements des femmes dont violemment, les esprits s'emparent.Les seuls souvenirs heureux qu'Abo garde de ces lonqs calvaires sont les rares rencontres avec Ndum Ebat, son père, qui coupe des noix de palme à Malungu.Mais les souffrances de la marche et du portage lui semblent le prix à payer pour assister à ce spectacle de grand art au cours duquel des mains habiles façonnent assiettes cruches et vases. Emerveillement de jeune fille. Les casseroles abîmées, ses mamans les cassent en petits morceaux puis les réduisent en poussière avec un pilon. Elles mélangent cette poudre à la glaise rouge toute fraîche. Deux villageoises de Bozombo, Nampiel et Ankiel, montrent une dextérité particulière à malaxer l'argile et à modeler les casseroles et les cruches. Elles les laissent sécher pendant plusieurs jours et les placent ensuite au milieu d'un feu de charbon de bois, jusqu'à ce qu'elles soient aussi rouges que le couchant enflammé. Puis elles les immergent dans de l'eau et, à l'aide d'une brosse, les enduisent d'un liquide extrait de la plante akam okiel. Les casseroles prennent ainsi leur couleur noire habituelle. L'eau y garde maintenant son goût et sa fraîcheur. Les autres villageoises achètent leurs ndzung chez Nampiel et Ankiel. Celles-ci, par ailleurs, organisent les femmes et parlent en leur nom, quand des Blancs s'amènent. Dans leur fonction de capita, elles lancent les ordres pour puiser de l'eau, préparer la nourriture, arroser la terre où les maîtres blancs poseront leur pieds fragiles.Une fois par an, le grand chef Ngambuun de Mukulu fait une entrée majestueuse à Lukamba Secteur, sa stature imposante haut levée sur un tipoy que portent quatre serviteurs. Pour une semaine, Awaka, ses femmes et une partie de sa progéniture se mettent au service et à l'écoute du grand sorcier. Le soir, les villageois allument un feu immense autour duquel chefs de village et chefs de clan exécutent des danses mbuun, surpassés dans cet art par ^ volumineux Ngambuun lui-même. Puis, ils s'engagent dan de longues causeries nocturnes. Lors des visites aux autres chefs-guérisseurs des villages environnants, Abo a déjà con staté qu'à Mungai Busongo, Ndzuku possède cinq femmes" Ndzats, l'ami d'Awaka qui règne sur Mungai Mbwitsambe-le, en a également cinq. Le chef Mulikalunga de Mungai Mazinga en compte quatre. Dans de telles quantités, les femmes se laissent encore superviser. Ce soir autour du feu, mais bien à l'écart du chef, Mabiungu initie sa fille aux dangers de la vie:- Ngambuun, le chef de Mukulu, celui-là est à craindre! On estime sa collection féminine à environ trente pièces. Mais il n'en perd pas pour autant l'appétit. Quand, dans un village, il remarque une belle femme du haut de son tipoy, il s'arrange avec l'oncle de la nouvelle proie pour la faire venir chez lui.- Si le chef croise une petite fille très jolie, il peut lui offrir, au vu de tous les villageois, le mwang, le bracelet en cuivre. A ses treize ans, elle appartiendra au chef. La petite Abo se sent envahie par une inquiétude inconnue. Sa grand-mère lui répète souvent qu'elle est très jolie. Les multiples incidents de la vie villageoise font pressentir le grand malheur de naître femme. Un après-midi, Abo trouve trois mamans devant une hutte, les mains sur la tête en signe de désespoir. L'une d'entre elles se lamente: - Elle va tuer l'enfant et pourtant son mari lui a tout donné. Dans la case, une femme assise contre la paroi, porte une lourde pierre sur la tête. Abo entend une voix criarde: - Tu es paresseuse, le bébé va s'étouffer! La scène lui fait pitié et l'effraie mais ce n'est que plus tard qu'elle en saisit le sens. Dès qu'une femme enceinte ressent les premières douleurs, les accoucheuses traditionnelles l'exhortent à pousser. Souvent, la pauvre femme s'épuise complètement, bien avant que le moment de la délivrance ne soit venu et la fête de la naissance se transforme en double deuil. Mais, pour l'instant, ces présages d'un avenir pénible passent presque inaperçus. Rien ne peut troubler l'assurance de la petite Abo. Une flopée d'enfants la considère comme leur chef de bande. Lors des randonnées en brousse, même des garçons de deux ans ses aînés se rangent sous ses ordres. Elle se montre la plus hardie à grimper aux cimes des arbres les plus hauts. Amias est sa rivale; la fille d'Ebul, plus forte, allonge de temps à autre une claque sonore à Abo.De plus, en tant que fille d'Awaka, Abo jouit d'une situation privilégiée parmi les gosses de Bozombo. En effet, les moments d'excitation extrême pour la marmaille de l'endroit se produisent lors des sessions du tribunal coutumier, spectacle total qui tient à la fois du drame et du théâtre didactique, de l'opérette et du bal populaire. Souvent, des affaires judiciaires s'éternisent dans l'enclos d'Awaka. Postée devant la case de sa mère, Abo a tout loisir d'observer les moindres gestes des acteurs principaux, tandis que les autres gamins perçoivent difficilement quelques images à travers un trou dans la palissade. Dans tous les villages mbuun, les juges utilisent les mêmes rites, proverbes et chansons pour dire la justice. Lorsqu'un différend s'envenime, ses protagonistes expliquent leurs points de vue à un vieux, en général le juge de la famille, qui prendra la parole au moment du procès. Il joue le rôle d'avocat. Généralement la bataille se mène entre deux familles mobilisées au grand complet. Après avoir planté dans le sol, en face du juge qui tranchera la palabre, trois ou quatre cannes, les luang, spécialement destinées au tribunal, les familles s'assoient. Lorsque quelqu'un prend la parole, il se tient debout et serre le col de la canne. Souvent on invite des juges d'autres familles et d'autres villages qui peuvent faire valoir leur expérience et donner des conseils. Quand des invités se font attendre, les juges entonnent une chanson fameuse tant pour pleurer un mort que pour rythmer une danse :
Les Mbwitsambele Quand tout le monde est présent, le juge principal chante la formule de bienvenue, reprise par toute l'assistance: Je demande à mes étrangers, êtes-vous bien arrivés? Si, au cours de la palabre, un juge parle à tort et à travers et ne répond pas bien aux questions, la partie adverse lui chantera:
Le mauvais juge S'il craint des bagarres, le juge qui préside peut interrompre cet exercice de bel canto. Mais souvent, lui aussi, aux moments cruciaux de la bataille judiciaire, commence une chanson, reprise par l'assistance.
L'aigle est un grand oiseau Ce qui signifie: si vous voulez réussir dans cette affaire, vous devrez faire preuve d'une grande intelligence. Un autre proverbe chanté communique la même sagesse.
Un palmier de la brousse a des lignes sur son tronc Mais, comme on se l'imagine bien, devant le tribunal, on a moins souvent l'occasion de chanter l'intelligence que la bêtise. Aussi, une des mélodies les mieux connues est celle, plaintive, que font entendre les garçons qui ont engrossé une jeune fille: ïe me label Aïe, je suis coupable Un jour, dans la parcelle de Mwatsj Abuun, le juge de son clan, Abo assiste à une affaire de grande envergure. Il y a quelques années, les gens de Bantsamba et de Kimbanda ont créé une association de chèvres, nkom ontsagn. Le premier village a acheté la femelle, l'autre le bouc. Des chevreaux ont grandi et se sont reproduits, d'autres ont été vendus. Or, sur les gens de Bantsamba, qui gardent les bêtes, pèse la suspicion d'avoir mangé pas mal de cabris Le juge Ewun de Kimbanda a tenu une palabre avec le juge Mbimochegn de Bantsamba, mais ils ne s'en sont pas sortis Alors l'affaire est portée devant Mwats Abuun. Commencé à l'aube, le spectacle ne s'achève que tard dans la nuit, par un jugement dont la sagesse ménage toutes les susceptibilités. Aussi, avant de se séparer, ceux de Kimbanda et Bantsamba chantent-ils en chœur:
Le tribunal des Bambunda Si le tribunal rend la justice grâce à l'expression artistique de toute la communauté, le premier film à Lukamba crée consternation et panique. Avec le développement fulgurant de la sorcellerie moderne, où va le monde? Voilà que les Blancs nous amènent un linceul lumineux dans lequel ils cachent des êtres humains décédés qu'ils ressuscitent à l'instant et qu'ils font marcher, courir et danser dans ce drap ou derrière le drap, qui de nous le dira? La première frayeur passée, Abo et ses amies cherchent à découvrir où se cache, derrière l'écran, cette foule immense qu'on ne croyait pas pouvoir tenir dans un tissu aussi réduit. Mais il n'y a personne, rien. Ils sont trop forts, les sorciers blancs. Les adultes nourrissent des idées plus sombres à l'égard du prêtre-opérateur. Un homme de Lukamba Bantsamba a reconnu sur l'écran son grand-père, mort il y a dix ans et manifestement emprisonné depuis tout ce temps par les prêtres quelque part en Europe. Une vieille femme de Bozombo ne s'est pas trompée sur l'identité de sa fille de quinze ans, mangée l'an passé par les mon-pères pour être réduite en esclavage, sans doute chez eux, en Belgique.Le premier dimanche de septembre 1954, Abo, entouréed'une quinzaine de jeunes filles et de garçons, prend le chemin qui descend vers Misadi et Bondo. Le regard des mamans qui les accompagnent trahit tantôt la solennité tantôt la tristesse du moment. Très élancée pour ses neuf ans, Abo exhibe sur sa tête une véritable corbeille d'abondance: f ouf ou, viande et poissons séchés et bananes, le tout à la démesure de la bonté maternelle. Il s'agit d'assurer la survie de la fille unique pendant deux longues semaines. Abo entre à l'internat de la mission Totshi pour sa troisième année du primaire. Passé le village Totshi Basenji, le sentier de brousse fait une courbe pour déboucher sur une pente abrupte: en bas rugit la Kwilu. Un pont dansant, fait de lianes, relie les deux rives. Son tablier est constitué de planches d'ochegn attachées par des cordes, cinq lianes constituant le garde-fou. En bas, la rivière se déchaîne avec fureur, fouette les dizaines de rochers qui lui tiennent tête et crache ses eaux vers le ciel. Parfois, ses langues d'écume lèchent le pont aux lianes qui se met à trembler d'effroi. A la vue de tant de sauvagerie, la mère Mabiungu commence à pleurer et la plupart des mamans se sentent monter les larmes aux yeux. Elles n'osent pas traverser et leurs pleurs redoublent quand elles voient les enfants, insouciants, passer le pont au pas de danse, sept à dix mètres au-dessus des eaux déchaînées. Au retour vers Lukamba, les femmes se disent leur certitude que les prêtres blancs sont des diables. Pourquoi s'obstinent-ils à construire le pont à cet endroit, si ce n'est pour manger les enfants? Maintenant elles comprennent la terreur de leurs maris. Chaque fois que le pont se casse, les pères réquisitionnent les villageois pour sa reconstruction. Ils commencent par faire des bénédictions dans la langue secrète de la magie des Blancs, le latin. Celui qui oserait désobéir, connaîtrait une mort affreuse. En réparant le pont, chaque villageois sait qu'il sacrifie ses enfants. Les mon-pères choisissent cet endroit dangereux parce qu'il leur garantit de nouvelles proies. Quand la rivière engloutit un enfant, les pères s'emparent de son esprit et le font travailler comme esclave. On ne s'explique pas autrement les richesses accumulées en si peu de temps par les missions.Toutes les deux semaines, Abo rentre chez elle, ramener de la nourriture. Parfois, au retour à l'école, il fait déjà nuit au moment d'arriver au pont de la Kwilu. Les élèves des différents villages s'y attendent: après la tombée de la nuit, personne n'ose parcourir seul le trajet de deux heures jusqu'à la mission. Passé le pont, ils avancent à tâtons sur un sentier qui se tortille jusqu'au sommet de la montagne. Dans l'obscurité totale, chaque petite ombre agrippe la ceinture ou le pagne de la précédente en maintenant ses provisions sur la tête en un équilibre fragile.Bientôt, les enfants, eux aussi, perçoivent le pont comme le symbole de la malédiction des Blancs. Pendant la saison des pluies, l'humidité s'attaque aux lianes et aux cordes. Un dimanche soir, un garçon de Matende se trouve au milieu du pont, quand la rivière, de ses longues dents, avec un bruit fracassant, brise les lianes. Le lendemain matin, tous les élèves descendent le long de la rivière à la recherche du cadavre. Ces dernières années, deux filles et un garçon ont perdu la vie dans des circonstances semblables. Le pont enlevé par la rivière, il faut traverser plus en aval en pirogue. Opération risquée dans des eaux imprévisibles. Trois fois Abo tombera à l'eau, le piroguier ayant perdu le contrôle de son bateau. Ces accidents se passent heureusement près de la rive gauche. Une bonne partie de la nourriture perdue, les enfants de Lukamba se partageront le peu qu'ils ont pu sauver. Les journées à l'école de Totshi sont d'une monotonie toute européenne. A six heures du matin, il y a l'inévitable messe et, à dix-huit heures, les prières du soir. Prise en tenaille entre ces deux moments d'exaltation religieuse, l'école occupe les tranches de sept à onze heures et de quatorze à dix-sept heures, à chacune desquelles succède une heure de travail manuel. Après le repas du soir, à dix-huit heures trente, il reste un mince espace pour jouer et s'amuser puis, à vingt heures, tout le monde doit se trouver au lit. L'église est bien au centre du petit monde de Totshi, séparant l'hémisphère masculin de l'hémisphère féminin. Au quartier Kitadi, réservé aux hommes, on voit les maisons en pierre des prêtres, les cases de terre des enseignants et le camp des futurs mariés qui se préparent au baptême, passage obligatoire à la vie conjugale décente. A une dis- tance sécurisante, se trouve le quartier Mankondo, quartier féminin dominé par les maisons des sœurs et le dortoir des filles, constructions solides de pierre. Dans le même axe se trouvent les quatre classes en pisé. A quelques dizaines de mètres, parallèle au dortoir et à l'école, il y a le sombolo, le hangar où l'on prépare la nourriture. Les filles mangent en plein air assises à même le sol.A Lukamba, grâce aux soins d'Elisabeth Kayembe, Abo a déjà appris à se signer et à réciter des "Je vous salue Marie pleine de glace". A Totshi, elle apprend qu'il faut dire grâce au lieu de glace. Mais elle ne comprend pas mieux, pour autant, de quoi Marie est pleine. Trois années d'initiation la convaincront de l'existence d'un Dieu, un vieillard blanc à longue barbe blanche, qui ne peut pas mourir et qui vit là-haut dans le ciel avec son fils, le dénommé Jésus-Christ. Une photo de la Belgique avec ses palais gigantesques tout en pierre a fixé définitivement dans l'esprit d'Abo l'image du paradis. La Belgique se confond à tel point avec le Royaume des cieux qu'Abo se représente les Belges avec un halo lumineux derrière la tête. Les chrétiens, après leur mort, ne restent pas sous le sol, comme les païens, mais montent au ciel. Bien vite, Abo regarde de haut ceux qui continuent à patauger dans le paganisme. Après trois années de catéchisme, deux cents enfants mbuun et pende peuvent débiter les réponses adéquates aux questions les plus difficiles. En mai 1956, ils sont solennellement baptisés par des étrangers. Impuissantes dans le royaume des ancêtres, la mère Labon perd sa fille Abo et la grand-mère Aney se voit arracher sa petite-fille Ndzung a Bweng que les sœurs blanches désignent désormais sous le nom barbare de Léonie Hortense. Labon apprend que la fille qu'elle a mise au monde a été initiée à une religion de Blancs et qu'elle mangera désormais le corps d'un dieu étranger.Au dortoir, les filles couchent en deux rangées séparées par un couloir. Sur le sol de ciment, elles étendent une natte couverte d'un pagne, couche qui ne se prête pas spécialement à de doux rêves. Le sol s'incline légèrement vers le couloir. Ainsi, à l'inspection du matin, la capita, la surveillante sélectionnée parmi les élèves les plus âgées, remar quera immédiatement le filet d'urine devant la natte des enfants coupables, tremblant déjà d'humiliation et à la per. spective de la punition imminente.Les sœurs s'appliquent, avec un dévouement maladif, à faire connaître les péchés mortels aux jeunes filles. Il ne faut pas tuer. Il ne faut pas voler. Cela n'est pas trop difficile à saisir. Il ne faut pas coucher avec l'homme. C'est mauvais. L'homme est comme un satan. Il vous mène en enfer. Et vous aurez une grossesse. Il ne faut pas causer avec un homme. Il vous provoquera. Vous commettrez des péchés intérieurs contre la chasteté. Et vous ne serez pas saintes, vous ne verrez pas le ciel. Une nuit, Abo quitte le dortoir avec deux amies pour se rendre aux toilettes. Une musique étrange provient de la maison des sœurs. Le cœur au galop, retenant leur souffle, les filles se glissent vers la fenêtre. Avec des gestes lents, un prêtre tourne la manivelle d'un vieux phonographe. Les pères et les sœurs s'élancent pour une danse des initiés qu'on pensait réservée aux sabbats des sorciers et des sorcières. Abo et ses deux amies se sauvent en panique. Viennent-elles de découvrir un grand secret des Blancs? Il y a quelques mois, sœur Gabrielle, que toutes les filles admiraient pour sa beauté éblouissante, est partie pour l'Europe. Les grandes élèves ont chuchoté qu'elle était enceinte et qu'elle ne reviendrait pas avant six mois. Abo se rappelle maintenant un refrain que les grands chantaient à Lukamba.
La sœur met au monde Chaque samedi matin, les sœurs transforment le corps estudiantin en une force de travail féminin bien disciplinée et purement gratuite. Elles manœuvrent les bataillons d'élèves sur deux kilomètres, jusqu'à la carrière de Totshi, où des contremaîtres ont dynamité des rochers. Au premier retour l'allure droite et fière des jeunes filles ne laisse pas soupçonner le poids des pierres et du sable qu'elles portent dans de grandes corbeilles sur la tête. Echangeant à peine quelques mots entre elles, les filles feront cinq fois l'aller-retour. Elles y perdront leur tenue altière. Dès le lundi, après les cours du matin et de l'après-midi, les enfants cassent les grosses pierres en petits cailloux qui, mélangés au sable et au ciment, serviront à construire des classes en matériaux durables. Après trois années de labeur, Abo voit s'achever les travaux de deux bâtiments d'école.Comme de petites serves, les élèves sont encore astreintes à d'autres corvées. Elles labourent les champs de la mission à la houe. Elles ramassent des engrais organiques dans la brousse. Sur la tête, elles transportent des paniers remplis d'excréments de vache. Des matières fécales fraîches, un liquide nauséabond suinte à travers la corbeille et dégouline le long du visage. Odeur pestilentielle, puanteur. Le soir, les filles font une moue boudeuse au moment de remercier leur père qui est au ciel. Les filles sarclent les champs d'épinards et de tomates, les jardins d'orangers. Elles plantent des tiges de manioc Saint-Pierre. Ces tubercules très sucrés sont réservés au personnel blanc. En général, on grille sur un feu de bois le manioc blanc, que l'on ne découvre qu'après avoir ôté une peau brune, puis une peau rouge. Comme le manioc Saint-Pierre est interdit aux élèves, toutes, en une conspiration solidaire, s'efforcent de cacher quelques tiges sous leur pagne. Elles les offriront à leur maman au village. Emerveillée, Mabiungu voit pousser les cinq tiges de ce manioc miraculeux qu'Abo lui a remis. Quelques fois, lors d'une fouille en règle par les sœurs, une fille se fait attraper. Traînée devant les autres élèves, couchée à terre comme un ver, elle reçoit six coups de chicote sur les fesses. La sœur Odrade la frappe avec une liane, sourde à ses hurlements. Abo regarde le spectacle avec des yeux qui ne trahissent pas la moindre émotion.La corvée qui répugne le plus aux filles consiste à creuser, dans le sol, des trous qui serviront de toilettes. En deux rangées elles trouent la terre, chaque fosse sanitaire à moins d'un mètre l'une de l'autre. Le matin, tôt après le réveil une sœur accompagne les filles aux toilettes et toutes doivent prendre place en rang, l'une derrière l'autre. La honte leur serre la gorge. L'opération se déroule en plein air et dans une odeur délétère. Après une nuit d'orage, les trous sont souvent remplis d'eau de pluie, ce qui en augmente l'horreur. Les élèves fuient dans la mesure du possible ces fosses malodorantes. Mais la sœur Odrade, au nez de vautour, inspecte régulièrement la brousse. De temps à autre, elle plonge sur une fille pour la conduire au lieu du crime. Elle l'oblige à ramasser les excréments pour les déposer à l'endroit qui convient. Quand sœur Odrade est réellement fâchée, elle saisit la fille à la nuque et lui frappe le front contre le bord du trou.Un après-midi chaud de 1956, toute l'école s'aligne pour la corvée des toilettes. D'un geste abrupt, un mauvais esprit tire une toile noire sur trois quarts du ciel, ne laissant que quelques raies d'une lumière sinistre à l'horizon. Une pluie impitoyable s'abat sur la mission, le sol tremble sous les coups de tonnerre, des éclats de feu déchirent la nuit artificielle. Paralysées, les filles attendent l'ordre de rentrer. Léonie Ankam se trouve devant Abo à une distance de quatre fosses. La frayeur devant la tempête la pousse à déserter son poste, mais la peur de désobéir aux sœurs la maintient clouée au sol: une double angoisse déchire son visage d'enfant. Une flamme bleuâtre jaillit du ciel tandis qu'un violent souffle, tel un coup de massue, frappe les filles dans la nuque. Puis il ne reste que la nuit et l'averse et cinq corps étendus dans la boue. Abo reprendra conscience sous le hangar. Le lendemain, la famille de Léonie Ankam arrive de Matende Isulu pour récupérer son corps qui, démesurément gonflé, sécrète un liquide blanchâtre. Terrorisées, les filles se demandent qui est à l'origine de tant de cruauté: l'oncle de Léonie Ankam ou les prêtres blancs?Quand arrivent les grandes vacances, Abo s'échappe de uuver éternel de la mission, pour retrouver la chaleur maternelle. Pendant quelques semaines, elle ne quitte plus Mabiungu d'une semelle, inquiète qu'elle est de la voir un peu plus maigre chaque année. Sa fille à la mission la mère souffre seule de toutes ses maladies. Elle n'a plus sa fille pour lui chercher des poissons et pour capturer des criquets dans la brousse. Abo revenue, il ne se passe pas un seul jour qu'elle ne la serre dans ses bras et commence à pleurer, longuement, de la seule joie que la vie lui concède. Elle ne cesse de répéter:- Quand tu es là, ta mère est bien. La nuit, elle ne veut pas dormir, de crainte de perdre une minute avec sa fille. Jusqu'à l'aube, elle raconte les moindres détails de la vie dans la parcelle et au village. Abo rend visite à sa famille et aime rester des journées entières à Lukamba Ingudi chez sa grande sœur Anzawe, qui la choie comme sa propre fille. C'est chez Anzawe que Léonie a appris au cours de l'été 1955, la mort de son père Ndum Ebat, cet homme resté un inconnu pour elle. Pendant les vacances de 1956, des garçons de Bozombo montrent Abo du doigt: - Regarde, la femme d'Innocent.Abo fait semblant de ne rien entendre et, de toute façon, à onze ans, l'annonce de son futur mariage la laisse complètement glaciale. Vers 1930, le clan de Ndum Ebat avait payé la dot pour Labon, prématurément décédée. Comme la famille de Ndum Ebat a perdu la mère, elle gardera la fille, sans être obligé d'offrir une nouvelle dot. Aussi, en toute équité, Abo sera-t-elle donnée en mariage à Innocent Mutanzundu, le fils de la sœur de Ndum Ebat. En juillet 1957, Abo termine l'école primaire de Totshi. Ses douze ans la rendent désormais mûre pour la grande expérience. Le frère aîné d'Innocent, riche commerçant à Kikwit, a déjà fait son apparition à Bozombo, chargé de quinze pièces de wax: chaque tante sera servie. Mais alors arrive la nouvelle qui éclate, c'est bien le cas de le dire, comme une bombe: Innocent est entré à la Force Publique! Abo doit rejoindre son futur mari à la caserne de Thysville! Awaka revoit en mémoire les centaines de cadavres que la Force Publique a semés, en mai 1931, sur toute l'étendue de Kilamba, à deux pas de sa maison. Les Bapende qui ont échappé aux massacres pour se réfugier à Lukamba n ont cessé de raconter, le soir autour du feu, comment l'armée avait égorgé, éventré, dépecé les villageois.Jamais, Awaka ne donnera sa fille à un militaire! Il rrnjote un complot avec l'abbé Ernest Binton. Une nuit, dans le secret le plus total, ils évacuent la future mariée vers l'école d'aides-accoucheuses à Feshi. La famille de Ndum Ebat crie au scandale et au rapt. Awaka se contente de rembourser la dot versée vingt-sept ans plus tôt pour Labon. 1957-1959, A Feshi et Masi Manimba - Table de matièresRumeurs étranges, avant-signes de l'indépendance. A l'école pour aides-accoucheuses à Feshi: péchés et révoltes. A Masi Manimba, accoucheuse à l'âge de treize ans. Les Belges du Cirque De Jong ont dit: macaque!Au moment où Abo s'apprête à rejoindre l'école de Feshi, des rumeurs étranges se répandent sur les villages du Kwilu-Kwango. En accompagnant Mabiungu aux champs, sur la grande route qui traverse Lukamba, Abo capte le bruit lointain d'un moteur. Elle et sa mère se précipitent dans les hautes herbes, se cachent à plat ventre et guettent la voiture. S'il s'agit d'un camion ouvert à l'arrière, il faut fuir à toute allure: le Mundele Ngulu, le Blanc-cochon, leur fait la chasse. Elles ont appris que le Mundele Ngulu s'empare des Noirs pour les obliger à manger du sel magique: les Noirs ne tardent pas à se transformer en cochons. Ensuite le Mundele Ngulu les vend pour être mangés. Avant son départ pour Feshi, Abo est prise à part par son oncle Ernest Kwanga. - Quand un étranger te demande si tu as vu passer Opep, le Vent, tu diras: non, je ne l'ai pas vu. Abo acquiesce. De toute façon, elle n'a pas la moindre idée de qui pourrait bien être Opep. - S'il te pose une question sur Jean Marteau, tu répondras ne pas le connaître.Oui, elle dira ne jamais avoir entendu son nom. A Feshi, elle essaiera de découvrir le secret de Jean Marteau. Elle apprend que c'est un lanceur de tracts!... Mais c'est quoi, un tract? Abo se retrouve avec treize autres filles dans la première classe des aides-accoucheuses et puéricultrices au Foreami, le Fonds Reine Elisabeth pour l'Assistance Médicale aux Indigènes Abo est la seule mbuun parmi quatre filles pende une Mukwese, Henriette Malonga, deux Batchokwe et six Basuku Grande fille dégingandée, Abo se fait surnommer Cinq Mètres et Fil de Guitare; comme elle est leste et rapide sur de longues pattes, ses amies la rebaptisent le Vélo. Située au milieu de plaines désertiques, la bourgade voit, chaque semaine, l'arrivée de quelques broussards faméliques, aux pieds gonflés et aux jambes flageolantes. Comme on trouve peu de viande et de poisson à l'intérieur du pays, des hommes et des enfants atteints du kwashiorkor se traînent jusqu'à l'hôpital du Foreami. Pendant deux semaines, les élèves leur apportent du foufou de mil. Ils reprennent force et repartent. Deux fois, Abo se trouve au chevet d'un enfant squelettique que le kwashiorkor tuera à petites morsures.Les journées comprennent deux heures de pratique dans la maternité et sept heures de cours. Les filles apprennent à soigner — laver, changer, nourrir — les bébés et, encore enfants, elles jouent aux femmes en se consacrant à une dizaine de petits orphelins. Les sœurs donnent les leçons dans une langue incompréhensible, le français, qu'elles traduisent ensuite en kikongo. Ce n'est pas la première rencontre d'Abo avec la langue du malheur. Un jour à Lukamba, elle s'était trouvée face à face avec un Blanc colérique, éructant des jurons à l'adresse d'une boîte en bois d'ébène qui lui répondait d'une voix d'enfer. Selon les dires des villageois, Abo avait vu la planque du diable qui lui avait parlé en sa langue de bois. C'est ainsi qu'Abo découvrit le français et la francophonie. La radio, exorcisée de ses démons, avait ensuite, vers 1956, fait son entrée dans les maisons de Noirs, chefs de secteurs et enseignants. A l'oreille d'Abo, le français faisait toujours comme le bruit de l'eau dévalant sur des cailloux. Le seul intérêt qu elle portait à la radio concernait le programme de disques sur demande. Elle les écoutait chez Pétillon, l'administrateur pende qui utilisait fort adroitement sa boîte à musique pour draguer les filles. On dansait sur la mélodie ae Marguerite:
Laisse-moi me marier avec une muluba, Laisse-moi me marier, c'est plus facile à chanter qu'à mettre en pratique quand on fréquente l'école chrétienne. Ce lundi-là, après un week-end aux sons de Marguerite, les filles sentent le drame dès qu'elles entrent en classe. Sœur Renildis s'y trouve déjà, blottie dans un coin, des larmes brûlantes inondant ses joues trop rouges. Abo, qui n'a jamais vu de Blanc pleurer, la regarde, hébétée: elle doit avoir perdu sa mère. Les mains tremblantes, sœur Renildis sort un papier de sa poche et lit une lettre inqualifiable qu'un élève-infirmier a destinée à Marie, une fille tchokwe, la plus âgée de la classe. Il y est dit: je t'aime et je veux te marier. Entre les pleurs abondants et les plaintes effrayantes dont les filles ne comprennent pas l'enjeu, sœur Renildis place quelques mots comme si elle poussait de petits cris: Vous êtes foutues, vous n'êtes pas de bonnes élèves, vous faites des péchés, je vais mourir, je vais suivre ma mère au ciel, vous faites des bêtises, je vous éduque, Dieu n'est pas d'accord, vous n'irez pas au ciel. Et j'ai déjà envoyé vos noms à Sa Sainteté le Pape. Dieu vous punira! Abo se dit que, maintenant c'est sûr, elle ira en enfer. A l'ombre du péché inconnu, elle tremble de frayeur. (L'autre jour, quand le docteur Ollemans, bedonnant, est entré en classe pour demander: Nani imene mono, ngonda? - traduction au choix: Qui a déjà vu la lune? ou bien: Qui a déjà eu ses règles? -, la petite Abo a quitté la classe pour sonder le ciel. Pas de lune en vue). Puis, sœur Renildis, après plusieurs approches avortées, laisse tomber comme un couperet la question qu'elle répugne à formuler: qui parmi vous a eu des contacts avec des garçons? Marie, la grande pécheresse, donne trois noms, qui à leur tour en dénoncent d'autres. Finalement, presque tout le monde aura son compte. Dans un élan de méchanceté, les filles s'attribuent mutuellement de petits amis qu'elles regrettent secrètement ne pas avoir eus. Dans cette atmosphère où se mélangent envies et effrois, jalousies et médisances, sœur Renildis donne lecture d'un long aveu des garçons et de la liste de leurs liaisons interdites. Abo aurait eu partie liée avec un enseignant mbala, Toma, qu'elle n'a jamais regardé autrement qu'avec la plus grande méfiance: vu de Lukam-ba, la terre des Bambala est le pays des ténèbres...Sous le choc de cet événement apocalyptique, la communauté religieuse de Feshi se trouve dans l'incapacité d'assurer les cours pendant deux jours consécutifs. Les filles sont convaincues que les élèves-infirmiers ont fabriqué la liste pour provoquer les sœurs. Au moment où tombe la décision d'expulser Marie la Mutchokwe et Anselme, son intrépide amoureux, une révolte ouverte se déclare côté garçons; pour la première fois dans leur carrière coloniale, les sœurs se font insulter par des nègres. Elles reculent et tout rentre dans l'ordre. Un premier vent léger vient d'annoncer la tempête. Abo, quant à elle, n'a pas la moindre idée de ce qui se prépare. Son monde s'élargit à coup de petits incidents. Le docteur Ollemans annonce devant toute l'école la mise en route d'un programme de recherche médicale. Pendant une semaine, les élèves se nourriront d'amidon de manioc et d'œufs, la semaine suivante ils mangeront du toutou et du saka-saka, des feuilles de manioc. A intervalles réguliers, le docteur envoie l'urine et les matières fécales de ses cobayes au laboratoire. Tous les deux jours, Abo se rend chez le médecin qui lui enfonce une aiguille dans le bras pour lui aspirer son sang. Elle voit d'innombrables petits flacons se remplir de ce liquide rougeâtre qui lui semble étranger et maléfique. Lentement, deux certitudes surgissent dans toutes les conversations. A petites doses, les Blancs veulent vider notre corps. Il doit y avoir la guerre chez eux et ils manquent de sang. Ni révolte, ni boycott, mais une lourde méfiance rend l'atmosphère irrespirable. Expérience suspendue. Restent des bribes d'idées. Les Belges peuvent-ils se faire la guerre? Jusqu'à ce jour, la guerre et le feu s'assimilaient à l'enfer où brûlaient uniquement des créatures noires. L'image de la béatitude des anges, d'une blancheur sans faille, se superposait à celle des Belges. Mais est-ce que les anges peuvent se faire gicler le sang et s'étriper à la machette? Beaucoup d'interrogations vagues. Le travail ne permet guère de s'y attarder. Une femme en couches se fâche à la présence de fillettes autour de son lit. Que viennent faire ici des petites que nous avons mises au monde il y a peu? Les explications médico-sanitaires des sœurs ne trouvent aucune écoute. La villageoise ne supporte pas la honte de se faire assister par des fillettes impubères. Abo s'en va sans murmures. Ne connaissant rien à la vie, elle sait la valeur de l'instruction et ressent un léger mépris pour ces femmes qui accouchent sur une natte, qui font rouler le nouveau-né dans la terre, qui coupent le cordon ombilical avec des lames Gillette rouillées, qui ignorent jusqu'à l'existence des microbes et qui, leur bébé mort de tétanos, accuseront leur oncle de l'avoir mangé.Mais, comme chaque élève le sait à Feshi, il n'y a pas que les oncles-sorciers qui mangent les enfants. D'un goût plus raffiné, préférant la chair sous ses formes les plus tendres et les plus savoureuses, autour de l'hôpital rôde aussi, la nuit, un Blanc. Les sœurs se sont donné beaucoup de peine à dépeindre ce danger mortel dans les couleurs appropriées. Souvent, un infirmier vient tirer les filles de leur sommeil pour qu'elles assistent à un accouchement. Elles sortent en groupe pour se rendre à la maternité. Sage mesure de précaution. Parce qu'il arrive qu'en chemin, imprévisible comme un animal de la brousse, surgisse l'agent sanitaire, le mâle le plus craint de tout Feshi. Panique, fuite, les filles rebroussent chemin. Intervient alors, tout noir et imposant bien que ramolli par l'âge, Kazan, le chien de garde. Il se rappelle ses devoirs. Il aboie. S'éveillent les sœurs. Et sous bonne garde cette fois-ci, les filles se précipitent voir l'accouchement. On a eu peur. Il va te mettre sur l'épaule et t1 emmener chez lui, avaient dit les sœurs.L'agent sanitaire est belge. C'est le deuxième en grade, à l'hôpital. Chaque fois que la moiteur tropicale lui fait bouillonner le sang, il prend sa lampe torche pour tendre une embuscade auprès du dortoir des filles. Mais il arrive rarement que le service de contre-espionnage des religieu-ses se fasse rouler. Alors une sœur se glisse, avec une gauche allure de conspiratrice, auprès des lits pour chuchoter que la bête rôde dans les parages. Et voilà encore une nuit de gâchée pour le Flamand. Le lendemain, les filles font semblant de ne pas prêter l'oreille aux insultes que leur assaillant profère devant les sœurs: "Est-ce que ces filles sont vos enfants, est-ce que vous les avez mises au monde?"Entre les Blancs, il peut donc bien y avoir de la haine. Comme chaque samedi matin, les quatorze filles, accompagnées par deux élèves plus âgées, partent en camion jusqu'à la rivière située à une quinzaine de kilomètres de Feshi. Les deux monitrices disposent d'un réveil-matin qui sonnera, à cinq heures, le retour en camion. Les filles se dispersent pour prendre des poissons, cueillir des champignons et des tondolos, petits fruits rouges de la forêt. L'après-midi, cinq élèves se baignent les pieds lorsqu'elles voient surgir du néant, à peine à quelques mètres de distance, un homme (un diable, un monstre, qui le dira?) dont l'oeil droit, sorti de l'orbite, pend par quelques muscles sanglants sur la joue. Devant son oeil broyé, il agite un couteau étincelant. Avec des cris d'épouvanté qui glacent les autres jusqu'à la moelle, les cinq filles se sauvent. La classe entière, accompagnatrices comprises, s'égaille en panique dans toutes les directions. Complètement épuisées, certaines élèves arrivent en courant jusqu'à l'hôpital. Plus tard, les hommes du village où habite le pauvre diable passent au peigne fin toute la forêt à la recherche d'assiettes, de casseroles, de vêtements et du réveil-matin... En juillet 1958, Léonie Abo et Henriette Malonga partent dans la Landrover de Kazan pour un stage d'un an à Masi Manimba. (Faites attention à l'agent sanitaire, la nuit, il mord comme Kazan! — et on a fini par l'appeler Kazan, chien de garde, mais chien quand même.) A Masi Manimba les deux jeunes filles partagent une petite chambre à côté de la salle d'accouchement de la maternité du Foreami. Elles sont placées sous l'autorité étouffante de maman Catherine, accoucheuse traditionnelle égarée dans le monde de la médecine moderne. Chaque jour, Léonie et Henriette voient naître une dizaine de bébés. Après deux mois de stage, la nuit leur appartient. Elles font leurs pre miers accouchements seules. Abo a treize ans Quand la naissance s'annonce difficile, elles appellent le médecin qui habite tout près de l'hôpital. Une nuit, une villageoise arrivée à la maternité épuisée et minée par la maladie, meurt en couches avant que Léonie et Henriette n'aient eu le temps de prévenir le docteur. La mort est déjà entrée dans la vie des jeunes filles comme une habituée peu sympathique qu'on retrouve toujours avec étonnement mais sans émotion particulière. Le lendemain matin, devant les sœurs venues s'informer du décès, Henriette affiche un sourire tendre. Une gifle cinglante s'abat sur sa joue. Vous devez montrer du cœur, s'exclame la sœur. Vous n'avez pas bien travaillé. C'est un être humain. Il faut chercher la cause de sa mort pour améliorer votre travail. Dorénavant, Léonie et Henriette s'appliquent plus conscienscieusement à prodiguer les soins.Abo assure le service lorsque, vers trois heures du matin, une femme présente les signes d'un accouchement imminent. Abo se précipite dehors et court vers la case de l'accoucheuse. Dans son excitation, elle n'a guère fait attention aux trois chiens, sortis des ténèbres, dont elle ne sent la masse que lorsque leurs aboiements rauques lui font éclater les tympans. Abo se rappellera uniquement qu'elle a désespérément happé de l'air avant de sombrer. Quand elle revient à elle dans un lit inconnu, une sœur se penche sur elle avec toute la sollicitude de maman Mabiungu. La bonté des sœurs remplit une semaine de maladie.C'est que l'hôpital porte une responsabilité pour l'agressivité des chiens errants. Chaque soir, le travail terminé, les plantons s'en vont enterrer, non loin de l'hôpital, des langes ensanglantés, des tampons d'ouate imprégnés d'urine et de sang et des placentas. La nuit, des dizaines de chiens affamés grattent le sol, déterrent les placentas et s'en gavent. Après l'incident survenu à Abo, l'agent sanitaire organise la chasse aux chiens dès la tombée de la nuit. Il les ligote Pour les noyer dans la rivière Lukula.Des tournées d'inspection sanitaire sont organisées dans les villages de la région à partir de l'hôpital de Masi Manimba. Une sœur conduit l'expédition, accompagnée d'Abo pour seule accoucheuse. Le chauffeur les conduit en camion qui se remplit, au gré des hameaux, de femmes arrivée terme. Dès que le camion s'arrête au milieu des cases, femmes enceintes qui attendent l'équipe, se présentent. villageoises, vivant dans un dénuement effroyable, appOr! tent poulets, œufs, ignames et poissons d'eau douce. Abo" leur distribue un peu de savon, du makayabu - poisson salé - et de l'huile de paraffine. Certaines femmes ne tarissent pas d'éloge pour cette petite qui, si jeune encore, a appris le métier d'accoucheuse. Abo effectue le recensement des femmes enceintes, suit le développement de celles qui figurent déjà dans son cahier et donne les premiers soins comme les purges à l'huile de paraffine.Début juillet 1959, la saison sèche à peine commencée, Abo observe avec émerveillement l'entrée dans les rues de Masi Manimba des premières voitures portant, comme une bannière, l'inscription Cirque De Jong. Un événement à ne pas rater: c'est du cirque et c'est du belge. La jonction si opportune de deux notions dont le lien, à l'époque, ne s'impose pas d'emblée dans une colonie tout imprégnée de sentiments respectueux, exerce un attrait irrésistible sur la jeune Léonie. Elle ira au cirque. L'après-midi elle fait partager son enthousiasme aux autres élèves, lorsqu'une excitation soudaine, et apparemment d'une toute autre origine, s'empare de tous les infirmiers et assistants médicaux noirs. Les Blancs, toutes catégories confondues, restent sur la touche, une interrogation inquiète dans le coin de l'oeil. Voici de quoi il s'agit. Le PSA (ne demande pas à la petite Léonie ce que c'est comme machin) a fait communiquer par messager, par téléphone, par tam-tam et par bouche à oreille, un ordre sans équivoque: personne n'ira au cirque! Un infirmier noir vient expliquer aux élèves que la décision est partie de Kikwit. Il y a quelques semaines, le cirque De Jong s'était présenté au bac de la capitale provinciale. Remarquant le passeur allongé sur le dos, somnolent sous un arbre, les Belges lui ont crié:- Hey, toi, macaque, yak'awa, viens ici! Vous vous rendez compte, ils ont dit macaque! Eh bien, aucun macaque n'ira rire de ces clowneries belges. Pe -sonne n'ira au cirque. Que tous les Noirs se le disent. Les élèves enregistrent. Abo trouve que c'est injuste Elle aim rait tant voir les dresseurs d'animaux sauvages les traDéziî tes, les prestidigitateurs et, surtout, surtout, les clowns.Mais il y a quand même une question qui la tracasse-Pourquoi les Mundele nous appelent-ils macaques? En juillet 1959, Abo retourne à Feshi pour y passer les examens finaux. Elle n'a pas encore quatorze ans quand elle entre dans la vie des adultes, pourvue d'un diplôme d'aide-accoucheuse. 4. 1959-1963, A Kikwit, Mungai et Gungu - Table de matièresMariage arrangé derrière le dos d'Abo. Un meeting pour l'indépendance, panique dans la cité de Kikwit. Mort du chef de la cité, Honoré Kimwanga. La secte des Mpeve, la sorcellerie et la fid élité conjugale. Mort de Lumumba. Accoucheuse à Gungu, premier conflit avec les Belges. Laissée pour morte par un mari jaloux. Assaillie par trois prétendants. Dans la prison de Gungu: entre la Vierge Marie et le commissaire dragueur.Elles sont une bonne dizaine, bras dessus bras dessous, assises dans le camion entre les paniers, les corbeilles, les baluchons contenant leurs pauvres affaires, excitées, tour à tour éclatant de rire, caquetant ou chantant à pleins poumons, sur la longue route de Feshi à Kikwit, des jeunes filles qu'une seule journée projettera de l'école chrétienne dans la vie matrimoniale. Parce qu'il faut le savoir: pendant qu'Abo se penchait laborieusement sur les questions de son examen terminal, d'autres réglaient, sans qu'elle n'en eut vent, les derniers détails de son mariage imminent. Après deux années d'absence du village, Abo a le cœur gros à l'idée de retrouver bientôt sa mère. Mais elle trouvera ce à quoi elle n'a pas pensé un seul instant: un mari. François Mbwangala est un Mbwitsambele, Abo l'appelle grand frère, sans arriver à le situer exactement dans l'arbre généalogique de son clan. Habitant la cité de Kikwit, François reçoit un jour la visite d'un vieux qui lui annonce avoir un neveu à marier. Garçon calme et sérieux, précise l'entremetteur. François informe la famille au village de la démarche entreprise et peu après Abo recevra, dans sa retraite a la maternité de Masi Manimba, une petite photo d'un homme inconnu et une lettre d'un certain Gaspar Mumputu. Qui a l'élégance de se présenter en quelques lignes comme son futur mari. Abo, à qui on a déjà fait le coup avec son cousin Innocent, ne s'émeut pas outre mesure. Pendant que, juchée sur le camion roulant vers Kikwit, elle chante sa joie, l'oncle de Gaspar Mumputu se rend à Lukamba pour apporter la dot et verser le vin. Mariage conclu selon les règles de la coutume. L'heureuse mariée ne se doute de rien. Quand elle rencontre son soupirant à Kikwit, où elle séjournera cinq jours chez François Mbwangala, Abo n'a de pensées que pour Mabiungu et Awaka. Les futurs époux -l'idée même semble saugrenue et loufoque à Léonie — se rendent à Lukamba, puis Gaspar continue le chemin vers Mungai Mazinga, son village natal. Deux semaines plus tard, le 14 septembre 1959, le mariage est célébré a l'église de Kikwit: Abo a l'impression, malgré toutes les danses et chansons de l'association des jeunes mamans, d'assister à une transaction qui ne la concerne pas le moins du monde. La célébration a un aspect d'autant plus étrange qu'elle se déroule au moment du couvre-feu: il est interdit de sortir, de faire la fête — Léonie se demande bien pourquoi — et les oncles ont dû demander une autorisation spéciale.A quatorze ans, sortant à peine de l'enfance, Abo entre dans le lit conjugal avec comme seul bagage les riches enseignements ecclésiastiques à propos de l'homme, — diable, être impur et débauché, affligé d'autant de péchés que le manguier porte de fruits -, et avec la seule obsession de fuir les "tentations de la chair" — notion inculquée par les sœurs sans autre forme de précision. La nuit de noces dure une éternité d'agressions physiques, d'ongles enfoncés dans la chair, de cris, de hurlements, de fuites, de pleurs et de frayeurs mais surtout de sang, de sang maculant les draps, de sang injectant les yeux et, dans la fièvre et le délire, des flots de sang emportant un rêve brisé. Reste la blessure. Reste un goût atroce. La deuxième nuit, la petite Abo serre son pagne autour du corps comme un harnais et prend refuge sur l'extrême bord du lit matrimonial, la respiration suspendue. Elle passera ainsi toutes ses nuits. Pourvu qu'il ne me touche pas. Abo travaille à l'hôpital de la mission Kikwit Sacré-Cœur. Quand elle en sort, Gaspar, caché dans les parages, l'épie. Il la suit à distance. A la maison, il la prend à la gorge: A qui as-tu dit bonjour devant la maison d'Honoré Kendita? Avant qu'elle n'ait le temps de répondre, les coups pleuvent Pas un jour sans que le poing du mari la frappe au visaae' pas un jour sans larmes. Les sœurs n'apprécient guère qu'un homme rôde autour de la maternité. Même dans un but moralement aussi louable que la protection de la vertu d'une femme mariée. Parce qu'elle l'a vertement réprimandé, Gaspar, dans un geste dont il a pris l'habitude à la maison, lève la main sur une religieuse du Sacré-Cœur. La mère supérieure convoque Abo pour la remercier de ses bons services. Sans réagir, sans autre réflexion, Abo s'en va, soumise, obéissante. Partie acheter du saka-saka et des tomates, Abo s'étonne de trouver le marché pratiquement abandonné. Dépassé les rares vendeurs, elle remarque un attroupement au stade. Que se passe-t-il? - Ben, allez voir, c'est Gizenga et Mulele qui tiennent un meeting pour l'indépendance. Et ils ont amené de Moscou une femme blanche qui s'habille en villageoise et qui parle le kikongo. Personne n'a jamais vu une femme pareille. On l'appelle madame Blouin, elle est la femme de Gizenga. Moscou, meeting, Blouin, Indépendance, Gizenga: Abo ne comprend rien à tout cela et n'en retient rien. S'approchant, elle voit des gens danser. - Notre fils est revenu pour nous libérer. - Qui, votre fils? - Gizenga va nous libérer des Belges. Mais qu'est-ce que les Belges lui ont fait à ce Gizenga? Dans le stade on a érigé une tribune. Abo voit une femme blanche, debout, haranguer la foule. On n'a jamais vu ça. Une femme qui lance des ordres à des milliers d'hommes. Elle porte une chemisette et un pagne. - J'ai vu une Européenne habillé en Africaine. Ce sera le seul souvenir qu'Abo retiendra du discours de Madame Blouin. Abo se rend chez Marc Katshunga qui habite quelques rues plus loin. Comme il appartient au clan de Ndum Ebat, elle l'appelle papa. La mère de Marc a l'oreille collée a son Poste de radio. Lorsque Abo lui adresse la parole, elle se tache: Tu ne vois pas que je suis en train d'écouter les nouvelles? Depuis que son fils est devenu un chef du PSA, le Parti Solidaire Africain, la vieille femme s'intéresse aux nouvelles du monde. Abo se dit que cette indépendance, dont on parle tant, doit être une affaire bien grave, pour qu'une vieille maman commence à se passionner pour le langage incompréhensible de la radio.Toute la cité de Kikwit vit sous l'emprise d'une drogue qui irrite les nerfs jusqu'à la déchirure. Un bruit insignifiant prend des proportions gigantesques et pousse des quartiers entiers à fuir. L'inquiétude, la peur, la panique naissent de l'énoncé d'une phrase. Abo est emportée par une vague humaine en fuite. Tout le monde s'arrête. Que se passe-t-il? Personne ne le sait. Il n'y a rien. Et on retourne chez soi. A chaque mouvement de panique, Abo sent que la mort peut la frapper dans le dos. Qui vafla tuer? Elle n'en sait rien. Les gens disent que ce sont les Belges. Abo n'y comprend rien: pourquoi les Belges? Il y a couvre-feu chaque soir. Personne ne peut circuler dans la cité. Les matanga, les retraites de deuil, sont interdites. Plus de rythmes de rumba dans les bars. Toute la vie est déréglée. Parfois, on ne trouve pas de vendeurs au marché. Les gens achètent en grande quantité. La nuit, seul Honoré Kimwanga, le chef de la cité, circule dans les rues pour ramener le calme au moindre signe de désarroi. Un matin, fin novembre 1959, dans la clameur et les hurlements de femmes hystériques qui courent en gesticulant, Abo apprend que les parachutistes belges ont sauté sur Kikwit. Sa maison se trouve au bord de la ville, près de la forêt. Un flot humain se dirige vers la rivière. Des femmes et des enfants sont renversés, piétines. Le bac est pris d'assaut, des grappes de femmes et d'enfants s'y agglutinent, des corps tombent, disparaissent sous l'eau. Des hommes essaient d'arriver à l'autre rive à la nage. Abo traverse la rivière en amont dans une pirogue. Elle dépasse la mission de Kikwit Sacré-Cœur et pousse jusqu'à Mungai, à la maison de ses beaux-parents. Les jours qui suivent apportent des bruits affolants : des soldats belges ont frappé des femmes, leur ont arraché les vêtements et les ont violées en pleine rue. Ils ont placardé sur des arbres des photos de Congolaises nues et hébétées après avoir été prises de force. Plus que les violences sexuelles, l'image de ces photos traumatise les filles du village: la honte et le déshonneur y semblent fixés pour l'éternité. Abo cherche à savoir si c'est vrai. De confirmation en récit détaillé, son effroi s'accentue. Les Noirs demandent maintenant l'indépendance. Les Belges se croyaient ici chez eux, nous leur avons dit de partir. Ils ne sont pas contents, les Belges. Abo enregistre sans comprendre. Pendant six mois, rien ne trouble sa tranquillité à Mungai Mazinga. Puis, le 26 juin, une information bouleversante arrive de Kikwit: Honoré Kimwanga est mort. Qu'allons nous devenir maintenant? Nous sommes damnés! Pourquoi papa Kimwanga nous a-t-il délaissés? Comment est-il mort? Personne ne le sait. Un messager arrive hors d'haleine: Demain, la dépouille de Kimwanga passera par Mungai pour être emmenée à Mukulu, son village natal. Partout, Abo voit des gens courir de maison en maison, transmettre la nouvelle. Le lendemain, hommes, femmes, vieillards et enfants quittent leurs maisons, s'attroupent le long de la route. Des deux côtés, des gens silencieux, tristes, abattus sur deux, trois, quatre rangs. Après des heures d'attente, un flot humain s'approche dans un nuage de poussière. Des dizaines de voitures et de camions de commerçants. Puis un véhicule sur lequel des hommes et des femmes en pleurs entourent le cercueil. Depuis Kikwit, des milliers de personnes suivent le corps à pied. Des gens qui longent la route, aucun ne retient ses larmes. Un cri fuse de toutes parts.
Honoré Kimwanga est parti sous terre. La foule qui marche derrière le cercueil, entonne une chanson en kimbunda.
Qui a crié? En rentrant chez elle, Abo prête l'oreille aux discussions. Kimwanga a beaucoup lutté pour l'indépendance. Mais maintenant il n'aura pas l'occasion de la voir, cette indépendance. Quand des politiciens du PSA venaient de Kinshasa, Kimwanga les recevait à Kikwit. Vous savez la cause de sa mort? Non? Honoré Kimwanga a été empoisonné. Par qui? Par Kamitatu, un politicien du PSA, lui aussi. Il ne supportait pas que Kimwanga soit le chef suprême à Kikwit. Le lendemain, Abo capte un autre bruit enveloppé de mystère. Mulele, un chef du PSA à Kinshasa, est venu saluer le corps de Kimwanga à Kikwit. Il s'est approché de la dépouille, il a mis un objet sur le cadavre et il a conversé avec Kimwanga. Mulele possède une force magique, il peut parler aux morts. Le jour suivant, Abo rentre à Kikwit. Elle y suit une colonne de gens qui quittent la cité pour aller au marché. Tous pleurent et dansent au pas de deuil. Arrivée au marché, Abo constate que presque tout Kikwit s'y est rassemblé. Les Bambala, les Bapende, les Bayanzi, les Bambunda. Chantant et pleurant, les gens tournent en rond sur la plaine. Dans les chants, on demande à Kamitatu pourquoi il a tué Honoré Kimwanga. Kimwanga était gentil avec tout le monde. Le deuil dure plusieurs jours. Abo se rend deux fois à la plaine pour participer à la danse de la mort, du matin jusqu'au coucher du soleil. Puis, un jour à l'aube dans la cité, elle remarque des gens qui ont couvert leur corps de farine ou de cendres blanches, agitant des bouteilles de bière et arrosant la terre en criant: "Indépendance, indépendance!" Tout le monde manifeste une certaine joie pour cette indépendance, joie endeuillée par la mort de Kimwanga. Abo n'a pas la moindre idée de ce qu'indépendance veut dire et elle ne pense pas à questionner à ce propos, le deuil de Honoré Kimwanga occupant toutes ses pensées. L'après-midi, Abo va au stade. Quelques pleureuses y restent même dormir la nuit. Au cours d'un bref séjour à la maison d'Ebul, à Lukamba Bozombo, Abo remarque un groupe de quinze personnes, le corps entier sous la poussière, assis en chantant au milieu de la rue. Parmi ces agités, son grand frère Isidore Kabwat. Quand il aperçoit Abo, Isidore accourt vers elle et lui ordonne d'enlever ses chaussures. - Sœur, il faut aller pieds nus. Si tu as de l'argent, il faut le jeter. Tout à coup, comme si le diable s'emparai| de lui, il commence à crier et pousser des aïe aïe aïe stridents. Puis il court, entre d'un bond dans une maison où il se met à creuser la terre. Il découvre une bande de peau et une corne d'antilope. Des fétiches. En rage, il les détruit. Le grand frère est avec les Mpeve et les Mpeve sont partout. Dans chaque village, ils se réunissent chantent, battent des mains autour d'un adepte entré en transes. La nuit, ils se rendent au cimetière qu'ils appelent Mput, l'Europe. C'est quoi le mpeve'? Ça vient d'où? Est-ce une maladie? Oui, c'est certainement une maladie. Isidore me dévisage avec des yeux écarquillés, brûlant de folie. Normalement, un homme ne fait pas de bêtises devant sa sœur. C'est donc une maladie. On dit pourtant que les mpeve, c'est-à-dire les esprits, sauvent les gens. Les ancêtres les envoient pour nous sauver des sorciers. Et en effet, ces maîtres du malheur tremblent et se cachent: les mpeve font la guerre à leurs fétiches. Olotsh ngi ngang baba, dit un proverbe mbuun: le sorcier et le guérisseur sont les mêmes. Le premier te maudit, l'autre te guérit. Mais ils se partagent l'argent et leur commerce prospère par soutien mutuel. Le mpeve balaie tout. L'église catholique se vide entièrement. Presque plus personne ne veut obéir aux prêtres blancs, les plus dangereux des sorciers, c'est bien connu. Des chrétiens traînent un jeune mpeve, Emiel, devant le père Delhaze de la mission Matende Iwungu. Avec emphase, le Blanc dit: Mono ikele nganga nzambi, je suis le sorcier de Dieu! Oui, attends voir. Parce que, vraiment, plus personne ne se sent encore en tranquillité avec tous ces médicaments occultes et secrets que magiciens blancs et noirs vous administrent: hosties, sang du Christ, potions et surtout nkanya. Avant son mariage, Abo a écouté avec incrédulité les explications de ses copines. Mais après les cas récents advenus à Kimbanda, qui pourrait encore avoir des doutes? Nkanya, c'est la grande conspiration des sorciers contre les femmes. L'homme boit le nkanya chez le féticheur et au moment de coucher avec sa femme légitime, il lui transmet ce médicament secret à l'insu de la bénéficiaire. Quand la femme ouvre ensuite la porte à son amant pour quelques prouesses de lit, ses moments d'extase charnelle se termineront par la découverte que l'attribut masculin s'est collé de façon indissociable à sa chair. Te voilà prise au piège, c'est bien le cas de le dire. Dans cette position spectaculaire, la fuite ne pourrait guère passer inaperçue, vous pensez bien. Donc, dans cette pose ridicule, il ne te reste qu'attendre le retour du mari qui, d'un ton innocent, te demandera: "Mais que diable se passe-t-il ici?" Puis il faut faire venir le féticheur pour te délivrer de la présence trop insistante de ton amant. Un effet quelque peu différent du nkanya s'est manifesté dernièrement à Imbongo. Dans cette variante, en tant que femme tu t'en tires encore plus ou moins convenablement, mais ton galant, les ébats du lit le laissent complètement désarmé. Au moment de se lever, béatement satisfait, un choc terrible le frappe quand il constate que l'objet de sa fierté ne figure plus à sa place habituelle. L'homme d'Im-bongo a vu au plafond un grand rat emporter son sexe dans sa gueule. Léonie fait sienne la conclusion de cette histoire vraie: il vaut mieux se tenir tranquille. Quelques mois plus tard, au retour du marché, devant la parcelle de l'oncle de Gaspar, Abo tombe dans les bras de sa mère Mabiungu, venue lui rendre une visite surprise. Les deux femmes entrent chez l'oncle. La maîtresse de la maison leur prépare un copieux repas. Le bonheur de retrouver sa mère fait oublier à Abo les terribles colères de son mari: il lui est interdit d'entrer où que se soit. A vingt-et-une heures, au moment de franchir le seuil de sa propre maison, Abo se fait empoigner et entraîner à l'intérieur. La porte claque au nez de l'oncle et de la mère. Puis fusent les coups, les cris, les hurlements. L'oncle enfonce la porte, et lance son poing en plein dans la face de Gaspar. Bagarre, jurons, taches de sang jusqu'à ce que Gaspar saisisse un couteau et que l'oncle prenne ses jambes à son cou. Pendant ce temps-là, la mère et la fille se sont éclipsées chez un parent. De là, elles iront à Lukamba. Songeur, Awaka secoue la tête. Abo s'installe dans le mariage comme dans un puits d'oubli. Les mois passent. Une clameur s'élève de Kikwit: "Lumumba est mort! Ils ont tué Lumumba." Ce Lumumba, c'est qui? C'est lui qui a obtenu l'indépendance. Kasavubu est complice des Blancs. Ah bon! Puis Abo continue sa route vers la rivière pour y laver des vêtements. Le jour suivant, elle entend dire que Lumumba a été coupé en morceau au Katanga. Pourquoi est-il parti au Katanga? Les Belges l'y ont amené. Les Belges sont restés les maîtres au Katanga. Ils veulent garder les mines de cuivre. Le cuivre, c'est quoi? Le seul objet en cuivre que Léonie connaît est le mwang, le bracelet. Elle sait que le chef Ngambuun attache le mwang au poignet des petites filles qu'il désire avoir. Fin 1961, Abo reçoit la visite de Mono Endan, le fils d'un oncle paternel. Commerçant à Gungu, il s'étonne de ce qu'Abo, qui a fait des études, reste chômer à la maison. Il s'engage à lui trouver du travail à l'hôpital de Gungu. Peu après, Abo part, entraînant son mari qui fait la gueule. Chômeur, il aura plus de problèmes à surveiller une femme qui travaille qu'une ménagère en résidence surveillée. Les praticiennes traditionnelles travaillent à la maternité sous la surveillance d'une sœur. Dès que cette dernière a tourné les talons, les sages-femmes font n'importe quoi, faisant fi des règles élémentaires d'hygiène et d'asepsie. Les jeunes filles instruites leur font discrètement la leçon. Engueulades: Vous, des petites enfants, qu'y connaissez-vous? Abo subit les insultes en silence. Si elle prévient la sœur, la praticienne recevra une bonne réprimande mais ensuite sa vengeance tombera sur les aides-accoucheuses. Une petite brousse d'un kilomètre sépare l'hôpital de Gungu du camp des infirmiers où le ménage Gaspar Mum-putu a pris ses quartiers. Vers trois heures de l'après-midi, Gaspar se cache dans l'herbe pour qu'aucun sourire, aucune poignée de main, aucune rencontre coupable de sa femme ne lui échappe. Et à la maison, les coups tombent de plus en plus fiévreusement. Gaspar, les nerfs lui grignotant la santé, amaigri, concentre toute son énergie dans la violence de ses poings. Souvent des infirmiers du voisinage accourent pour le maîtriser et pour l'assurer que sa femme se tient tranquille. Pâques 1962. Au moment où tout le monde célèbre la messe à l'église, une sœur trouve Abo à l'hôpital. - Tu n'es pas à la grande messe? Tu es devenue folle? - J'ai prié chez moi à la maison. Dieu est présent partout. L'idée lui est venu sans réfléchir. Les messes, les vêpres et les litanies ont simplement fini de susciter le moindre intérêt chez elle. Le crime ayant été dénoncé en haut lieu, la mère supérieure convoque Abo. - Est-ce le diable qui t'a poussée? Nous ne comprenons pas, tu étais si bien éduquée et si obéissante. De retour au travail, Léonie empoigne la sœur dénonciatrice à la gorge, sa victime se raidit et, rouge piment, se crispe d'effroi. Des mamans accourent pour empêcher un malheur. Les religieuses évitent désormais d'adresser la parole à celle qu'elles considéraient, hier encore, comme leur fille. Une amie de Léonie part chaque week-end voir son amant à Totshi. Rien de spécial, sauf que l'élu de son cœur, Etienne Nioka, se drape dans la dignité sacerdotale. Il ne faut jamais aimer un militaire, dit la sagesse populaire. Il ne faut pas aimer un militaire ou un prêtre, dit la version améliorée des mon-pères qui aiment souligner que l'homme de Dieu ne connaît pas de femme. Mais à voir ce qui se fricote à droite et à gauche, c'est à douter de l'existence même de Dieu le Père, du Fils et du Saint-Esprit. Abo se souvient alors qu'à Lukamba, le bruit courait déjà que l'abbé Ernest Binton avait convolé en injustes noces avec l'institutrice Elisabeth Kayembe, femme de caractère, hors de portée du premier venu. A l'école de Totshi, au moment des vacances au village, Abo avait entendu une histoire invraisemblable et compliquée qui disait en résumé que sa cousine Marguerite Mimpia était enceinte de l'abbé Nioka. A Totshi une rumeur, circulant avec obstination parmi les grandes élèves, attribuait d'innombrables conquêtes amoureuses à l'abbé Emmanuel Kuwambika. Apparemment, de nombreux prêtres noirs étaient arrivés à la conclusion que les Blancs leur avaient raconté un tas de sornettes. Et la sympathie d'Abo penche vers les abbés noirs. Lors d'une consultation prénatale, une villageoise veut monter sur la table. Son pied glisse, elle tombe. La sœur Wilhelmina s'écrie: "Fais attention!" et dans un même élan, de sa paume droite, elle frappe la femme au visage. Abo fixe un moment le sang qui perle lentement au coin de la bouche de la femme. Sans autre réflexion, Léonie gifle à son tour la sœur Wilhelmina. Sidérée, celle-ci se rend chez le numéro deux de la hiérarchie, Anatole Mupanza. Qui essaie de calmer le jeu. Une semaine plus tard, Anatole Mupanza se rend à l'hôpital sur un vélo flambant neuf. Il appelle Abo pour lui annoncer que ce bijou de la marque dernier cri, Ndeke Luka, lui appartient. A l'école de Totshi, Abo avait secrètement caressé deux rêves majeurs: manger du pain et rouler à vélo. Rien de plus fou qu'un mari jaloux. Gaspar, qui a passé jusqu'à présent des journées bien remplies à exercer une surveillance rapprochée sur sa femme, reçoit un travail comme chauffeur-mécanicien au garage administratif du Territoire de Gungu. Grand malheur. Mais Gaspar, qui trouve insupportable l'idée que sa femme puisse causer dix minutes avec un homme étranger, ne résiste pas à la tentation de se vanter, devant ses nouveaux compagnons, rivaux potentiels, de la beauté extraordinaire de sa jeune épouse. Aussi, François Mangala, administrateur principal de Gungu, apprend-il de son chauffeur l'existence d'Abo, une jeune Mbuun éblouissante d'après les dires de son mari légitime. Mangala resserre fort adroitement les liens d'amitié avec son subordonné et lui fait l'honneur de visiter sa maison avec une assiduité surprenante. Faisant montre d'une grande largesse, François Mangala remet régulièrement de l'argent à son serviteur pour qu'il aille chercher de la bière. L'administrateur principal profite de ces exquis moments de tête à tête pour avancer quelques pions. Jusqu'au jour où, tout sourire, il dit à Abo sur un ton anodin: - Je veux te prendre comme ma femme. Je sais que tu ne peux pas accepter tout de suite, mais nous en reparlerons. Sur ces mots, Gaspar entre, les mains pleines de bouteilles. Abo l'observe avec des yeux qui pour la première fois lui semblent réellement siens. Le brouillard de la soumission se dissipe lentement. Un matin, Delphin Mbumpata rend visite à sa sœur Abo. Il fait le tour de la maison, apparemment délaissée et, jetant un coup d'oeil par une fenêtre, voit sa sœur allongée sur un lit. Il enfonce la porte, trouve Abo inanimée, la salive et le sang lui coulant de la bouche. Il la porte sur un camion, la conduit à l'hôpital. Au retour, une maman du voisinage lui raconte le drame. La veille, elle a accueilli chez elle la jeune femme, échappée d'un passage à tabac particulièrement violent. Une demi-heure après, Gaspar a fait irruption dans sa maison pour traîner sa moitié comme un sac de charbon en direction du domicile conjugal. A l'aube, après une nuit d'enfer, il a serré sa femme à la gorge pour la laisser à moitié étranglée sur le lit. Et il a pris la fuite. - Il allait tuer cette enfant, s'exclame la maman. Abo reste trois jours à l'hôpital sans reprendre conscience. Delphin Mbumpata appelle à la rescousse un des oncles, Louis Mimpia. L'incident sera porté devant le tribunal et jugé fort judicieusement, on s'en doute, par François Man-gala. Le juge opte pour un verdict sévère mais l'oncle Mimpia préfère la clémence : - Non, ce sont encore des enfants, on ne peut pas casser ce mariage devant le tribunal, il faut que cela s'arrange entre les familles au village. Entretemps, le planton de Rémy Makoloni, administrateur territorial à Kandale, a eu vent du calvaire matrimonial d'Abo, fille de Mabiungu de Lukamba. - Comment un Mumbala peut-il faire souffrir notre sœur? a-t-il murmuré devant son patron. Gaspar Mumputu est Mbuun, mais au village de Matende Mazinga, où Rémy Makoloni a vu le jour, les Bambala jouissent d'un préjugé défavorable à cause de leur art culinaire douteux. Ce qui explique la légère distorsion de la vérité commise par le planton qui sait fort bien où il veut en arriver. Son patron cherche une femme. Rémy Makoloni se rend à l'hôpital de Gungu pour y rencontrer Abo, à qui il expose sans détour l'objet de sa visite: "Je cherche une femme." Puis il dit être au courant de ses souffrances, le mariage ne doit pas devenir l'enfer sur terre pour la femme, un amour véritable peut lier la femme et l'homme et ainsi de suite, tout un chapelet de banalités qui impressionnent et troublent la jeune Abo au plus haut point. Tout ce qu'elle entend lui semble d'une nouveauté et d'une fraîcheur insoupçonnées. Lors de sa troisième visite, Rémy offre l'argent nécessaire pour que les parents d'Abo puissent rembourser la dot et casser le mariage avec Gaspar. Le lendemain Rémy partira à Kandale. Abo a dix-sept ans. Pour la première fois, l'idée lui vient de fuir avec un homme qu'elle aime. Tenaillé par la jalousie, Gaspar se rend furtivement à la mission de Matende afin d'y négocier un emploi pour sa femme. La proposition enchante l'abbé Rémy Mukitshi. Gaspar annonce à sa fidèle épouse qu'ils partiront pour Matende, tout près de la maison maternelle. Le deuxième responsable de l'hôpital, Anatole Mupansa, à qui Abo annonce son prochain départ, exprime ses regrets. Comme il connaît le caractère violent de Gaspar, il se pourrait bien que l'affaire tourne mal à Matende. Si Abo voulait rentrer à Gungu, elle serait toujours la bienvenue à l'hôpital. D'autant plus que lui, Anatole, est justement à la recherche d'une petite amie. Le 20 juin 1962, Abo rentre chez elle au moment où l'on charge ses derniers meubles sur le camion de maman Rosé, en partance pour Matende. Le ménage Mumputu, dans l'ambiance morbide que le lecteur imagine sans peine, débarque à la mission de Matende Iwungu à onze heures de la nuit. Le matin, Abo a pris la ferme décision de ne plus vivre sous les diktats d'un mari imposé et, par conséquent, de refuser le travail qu'il lui a trouvé pour mieux l'enchaîner. Elle rentre chez ses parents à Lukamba. Mais d'abord elle passe chez sa grande sœur Anzawe à Lukamba Ingudi. Il va te tuer, dit Anzawe après avoir écouté le récit d'Abo, nous n'avons pas beaucoup de femmes dans la famille, tu dois faire des enfants pour régénérer la famille. Une semaine plus tard, Gaspar vient se plaindre auprès d'Awa-ka: La femme ne m'obéit pas, elle ne me donne pas à manger. Ebul et Ernest Kwanga sont convoqués pour tenir une palabre avec Gaspar. Elle se termine sur une dispute. Gaspar rafle tous les habits de sa femme et claque la porte. Quelques jours plus tard, Rémy Makoloni emmène Abo à Kandale. Ils y passent ensemble les mois d'août et de septembre. Début octobre, Rémy est muté à Kilembe comme administrateur territorial. Pendant ce temps, à Gungu, François Mangala souffre de l'intense douleur du soupirant repoussé. Mais il ne s'avoue pas vaincu pour autant. Il souffle à Gaspar un conseil judiciaire particulièrement judicieux: puisqu'Abo est toujours ta femme légitime, tu peux les accuser, elle et son amant, de relations illicites. Tu gagneras le procès, je te le jure. Heureusement que l'amitié vraie existe encore, se dit Gaspar en déclenchant d'emblée la procédure. Convoqués au tribunal de Gungu à la mi-novembre, Rémy et Léonie acceptent l'invitation à dîner chez François Mangala. François et Rémy sont des amis de longue date et ils jouent une partie de bras de fer dans une ambiance de politesses et de convenances. En l'absence du mari, le procès est reporté. Rémy ordonne à sa bien-aimée de se rendre au village, tandis que François décide que l'objet de sa flamme restera à Gungu. Quand Abo a déjà pris place dans le camion pour Lukamba, deux militaires l'en font descendre de force. Abo s'agrippe à leurs bottes, pousse des hurlements, utilise ses ongles comme des griffes de chat. Les badauds s'attroupent, les maisons se vident. Rémy s'en prend à François: "Regarde ce que tu as fait." Et François, de guerre lasse, s'adresse aux militaires: "Laissez-la." Deux semaines plus tard, tous les acteurs de ce drame sentimental comparaissent devant le juge, un peu embarrassé dans son double rôle. Rémy et Léonie écopent d'un mois de prison. Rémy, qui vient de recevoir une nouvelle affectation comme administrateur territorial à Idiofa, paie une caution tandis que sa tendre aimée disparaît pendant quatre semaines derrière les barreaux, drapée dans l'étoffe rude et dure réservée aux prisonniers. Quand Léonie se déplace, son pagne bleu fait le bruit d'un chariot roulant sur un chemin de gravier. A l'approche de ses dix-sept ans, Léonie commence à se faire une opinion sur le sort de la femme noire en milieu indigène. Le labeur et la souffrance lui sont imposés tout aussi naturellement que l'obéissance aux décisions des oncles, des neveux et des maris. Comme pour conjurer le mauvais sort que lui semblent jeter tous les hommes qu'elles croise sur son chemin, elle mémorise une incantation à laquelle elle n'a rien compris dans le temps mais qui, aujourd'hui, la rassure vaguement. - Vierge Marie, épouse immaculée de l'Esprit Saint, Mère du Corps Mystique de Jésus, protège-nous, nourris-nous, élève-nous, garde-nous du mal, nous, tes plus faibles, tes derniers-nés. Ce texte est de la plume de sœur Constance-Marie. Abo n'y a jamais rien compris. Mais elle comprend encore moins aux hommes. Elle sait seulement que c'est à leur propos qu'on implore la Vierge: garde-nous du mal. Eh bien, maintenant, à la prison, elle aura un mois de loisir pour méditer l'énigme de l'homme. Elle a à peine conçu ce dessein qu'elle se découvre la seule jeune femme enfermée dans le bagne. Et à voir l'insistance avec laquelle tous les militaires louchent vers elle, Abo comprend que chacun est convaincu qu'il couchera bientôt avec la plus belle des prisonnières. Vierge Marie, épouse immaculée de l'Esprit Saint, pourquoi m'avoir abandonnée? Mais non, ce manque de foi est déplacé, la providence lui envoie dare-dare un sauveur. Abo se trouve tout à coup face à son frère Félicien Ngondo, policier de son état et affecté à la prison. Il avertit le personnel de surveillance : - Léonie est ma sœur, personne ne doit faire de désordre avec elle! Passent deux semaines de tout repos. Puis le commissaire de police arrive à la prison pour un tour d'inspection. Le lendemain, un planton apporte des pigeons grillés et un casier de bière. Avec les salutations du commissaire. Abo prend bien soin de ne rien boire ni manger. Elle ne doute pas un instant que le commissaire a mis de l'okomin dans ses victuailles, une substance magique qui oblige une femme à suivre un homme qu'elle n'aime pas. Deux jours plus tard, le commissaire en personne, accompagné de sa femme luba, lui apporte des vivres. Le quatrième jour, à minuit, elle est appelée au bureau du commissaire. Abo fait son apparition, entourée de quatre policiers. - Assieds-toi. Aux policiers: - Vous pouvez disposer. Le commissaire se présente. Il vient de Banda-Sembo. Dans sa vie, il a commis une grande bêtise, il a marié une Muluba et tu sais bien comme ces gens sont voleurs. Elle détourne tout mon argent. Le commissaire assortit son discours d'une expression imagée sur les regrets qu'il éprouve de voir une si charmante personne dans une tenue aussi peu avantageuse. Mais il se dit aussitôt convaincu de pouvoir bientôt admirer sa beauté dans un tissu qui l'honore. Et le mot de la fin: Tu sais, depuis le premier jour, mon cœur t'appartient. Abo n'en croit pas ses oreilles et reste bouche bée. Elle se dit: Voilà, je suis devenue un jouet. Et elle s'étonne du bon usage du tribalisme anti-Baluba. Elle répond à son interlocuteur: - Je t'ai bien compris. Mais comprends-moi à ton tour, je suis en prison. Le moment est mal venu de me tenir de tels propos. Nous en reparlerons quand je serai libre. Cette nuit-là, elle ne dort pas et sa décision prend forme: je dois retourner chez l'homme pour lequel je me trouve en prison. Le jour où Abo retrouve la liberté, le commissaire lui offre une petite réception où sont invités son frère policier et son grand frère Isidore Kabwat. Le lendemain, elle utilise tout son art pour échapper à la vigilance du policier Félicien Ngondo qu'elle soupçonne de complicité avec le commissaire. Il pourrait bien, en deux temps, trois mouvements, la "vendre" en mariage. Abo dépêche Kabwat voir le commissaire. Abo restera à Gungu, dit Isidore, moi je me rends à Lukamba pour voir ses oncles et arranger avec eux votre mariage. Au même moment, Abo, par un petit sentier de brousse, fuit un nouveau bonheur conjugal. Pour ne pas avoir flairé l'astuce, le frère Félicien aura trois jours de cachot. Le commissaire envoie une expédition de policiers avec ordre de lui ramener de force sa promise. Ils s'entendront dire par l'oncle Ebul que l'enfant n'est pas un ballon. Début janvier 1963, Abo s'installe chez Mabiungu. En mars, Rémy Makoloni la ramène à Matende Mazinga où les amoureux connaissent trois mois et demi de tranquillité et de bonheur. En juillet Rémy se rend à son poste à Idiofa. Je reviens dans quelques semaines. Tendre au revoir. 5. 7 août - 20 septembre 1963, A Esiet Lankat, Nkata et Mulembe - Table de matières Abo, entraînée au maquis par un mensonge. Les premiers partisans. Une leçon politique: connaître l'histoire, haïr le colonialisme. Dans la forêt de Nkata, le premier espion. Aftluence au camp de Mulembe, mariage d'Abo et Mulele. Première attaque des militaires. 7 août 1963. Abo travaille dans les champs de ses futurs beaux-parents, le cœur léger à l'idée que dans une semaine, l'homme de sa vie viendra la conduire vers un destin de rêve à Idiofa. Ce jour-là, son oncle Ernest Kwanga passe en trombe à Matende Mazinga et laisse un message énigmatique chez les Makoloni. Que Léonie n'aille pas aux champs, demain. Qu'elle vienne à Lukamba. Son grand frère François Mbwangala a été foudroyé par une maladie inconnue et son état s'aggrave. C'est ainsi qu'Abo, après une nuit de supputations inquiètes, part de Matende Mazinga, le 8 août à 15h pour arriver à Lukamba Secteur à la tombée de la nuit. Son frère Embwang Ono-zim, un large sourire au visage, vient à sa rencontre. Abo s'indigne. - Ça t'amuse, que ton frère soit malade? - Folle! Il n'en est rien. François se porte à merveille. Dans la famille, il ne peut pas y avoir de mensonges entre frères et sœurs. Du coup, Abo pressent qu'elle est entraînée dans un jeu sinistre, un complot, une combine perfidement montée pour la séparer de l'homme qu'elle aime, Rémy Makoloni. Elle se jette à terre en pleurs. Des gens s'attroupent. A ce moment, l'oncle Ernest Kwanga arrive à vélo et la rassure: Ne t'en fais pas, viens, nous allons retrouver le grand frère à Bukundu où il se fait soigner chez un féticheur. En chemin, Abo croise Mbalan Etang qui lui dit: - Tu es finie. Ton oncle Ebul t'a vendue chez nous. Tu resteras là où tu vas. - Toi tu parles sans rien connaître. Je ne suis pas l'enfam d'Ebul comment pourrait-il me vendre? - C'est notre frère Pierre Mulele qui t'a appelée. - Celui-là, est-ce qu'il me connaît? Comment pourrait-il m'appeler?- Nous lui avons parlé de toi. Tremblant d'une peur panique, Abo suit son oncle et Mbalan Etang en direction de Bukundu. Juste avant l'entrée du dit village, Abo acquiert la certitude qu'elle sera vendue à un étranger. A l'improviste, son oncle l'arrête, lui fait tourner le dos à la route et lui couvre la tête d'un pagne. Il vaut mieux qu'Abo ne voie pas le chef de secteur de Lu-kamba, Valère Mukubu et ses notables, se rendant d'un pas grave à un rendez-vous important. Arrivée à Bukundu, Abo entre dans la maison de Gaspar Ngung, le fils d'Ebul, au moment même où, dans une chambre séparée, Mulele tient conseil avec Valère Mukubu et les chefs de village. La nuit est déjà avancée lorsque Mulele sort en compagnie de Théodore Bengila. Désignant Abo d'un léger mouvement du menton, un garçon dit à Mulele: - C'est celle-là. Mulele s'approche.- Où as-tu fait tes études? - Quand on veut causer, on s'assoit d'abord. Mulele à Gaspar: - Cette femme est vraiment difficile! Puis il dit à Abo qu'il a besoin d'elle pour soigner ses soldats. Je suis seulement de passage pour le Katanga. Avant de partir, je te remettrai un message pour mon petit frère Rémy Makoloni.Légèrement rassurée, Abo voit Mulele retourner chez les chefs de village. Elle dort quelques heures sur le bois de chauffage, dans un coin. A minuit, le camion d'Innocent Ndumbu l'éveille en arrivant à grand vacarme. Mulele et Bengila montent par derrière où se trouvent de jeunes garçons. Abo entre dans la cabine. Après un trajet d'une demi-heure, tout le monde descend à la bifurcation Kikwit-Imbogo et marche à la file indienne, par des sentiers de brousse. Abo derrière. Ntoma, le fils d'Ebul, la provoque:- Et tu crois vraiment qu'il te laissera un jour retourner au village? Le groupe s'arrête à une savane où sont plantées, incongrues, deux tentes de couleur verte, assez grandes pour abriter une quinzaine de personnes. Abo fait la connaissance de Félix Mukulubundu, un ancien militaire et de Daniel, le grand frère de Bengila. Cette nuit-là, allongée dans la tente à côté de Mulele, Abo ne ferme pas l'oeil, tenaillée par la peur que Mulele, d'un instant à l'autre, se rende invisible. Anxieuse, elle se demande comment cela se produira. Et elle se dit: peut-être il me rendra invisible, moi aussi, et que m'adviendra-t-il alors? Le lendemain matin, elle reconnaît Valère Etinka, le petit frère de Bengila, Elil et son ami Kambulu, originaires de Kimbanda, tout comme leur ami Ekwomo. A l'aube, Marc Katshunga arrive au camp et s'efforce de consoler la petite Abo qui pleure à chaudes larmes et ne parle que de retourner chez Rémy. Avant qu'il ne s'en aille, Abo lui remet quand même une liste de médicaments, antibiotiques, pilules contre le paludisme, et de matériel comme des pinces et des ciseaux. Katshunga enverra le tout de Kikwit. Au camp, Abo se tient à l'écart et refuse de parler à qui que ce soit. Les garçons déblayent le terrain pour construire des bivouacs et préparent à manger. D'autres jeunes arrivent: Kandondo, qu'elle connaît de Lukamba Bantsamba, Rémy Ndambila, un infirmier d'Imbongo et Delphin Mbumpata, son propre frère. Abo passe son temps au bord de la rivière à regarder les poissons dans l'eau. Ils sont libres, eux. Bengila vient lui tenir compagnie et raconter des blagues. Elle lui refuse obstinément le moindre sourire. Au cinquième jour, le camp perd un peu de son aspect austère sous les rires roucoulants de quatre jeunes demoiselles fraîchement converties en maquisards. Parmi elles Monique Ilo d'Inkasambu, Rosalie Ngondo de Lukamba Bantsamba, une fillette de treize ans, e* Soulié de Banda Yansi. En leur compagnie, Abo retrouve la parole. Ensemble, les cinq jeunes filles, amazones en herbe, vont à la pêche. Une vingtaine de garçons ont désormais établi leur résidence sous les arbres et Félix com-mence les exercices physiques et militaires. Abo refuse dy participer, reste assise à distance, et de ses grands yeux indifférents, regarde ces étranges rites d'initiation. Le camp se trouve non loin de la source de la rivière Luem. Une rangée d'arbres longe l'eau sur dix à quinze mètres. La lisière de cette petite forêt est séparée de la savane aux arbres clairsemés par une petite plaine nommée Esiet Lankat.Mulele fait une causerie à trente jeunes, assis autour de lui. - Nos ancêtres étaient libres et indépendants dans leur pays. Un jour, les Blancs sont venus pour les coloniser. De village en village, ils ont distribué du sel et du poisson salé pour les acheter. Mais nos ancêtres refusaient. Puis, les Blancs faisaient tonner le fusil. Avant d'entrer dans un village, ils tiraient un coup de canon au milieu des huttes. Les Noirs arrêtés l'arc ou la lance à la main étaient fusillés sur place. Les Blancs nous contraignaient à payer des impôts et à exécuter des travaux forcés. Puis, comme nous rechignions à la besogne, ils envoyaient des prêtres avec mission de nous convaincre de travailler pour eux. Nous ne voulions même pas les écouter. Ils arrachaient alors des petits enfants à leurs mères, en prétextant qu'ils étaient orphelins. Ces enfants travaillaient durement dans des fermes pour y apprendre la religion des Blancs. Petit à petit, ils nous ont imposé leur religion. Que nous raconte-t-elle? Elle nous apprend qu'il ne faut pas aimer l'argent, il faut aimer le bon dieu. Mais eux, n'aiment-ils pas l'argent? Leurs compagnies, comme les Huileries du Congo Belge, gagnent des dizaines de millions grâce à notre sueur. Ne pas aimer l'argent, c'est accepter un travail d'esclave pour un salaire de famine. Ils nous interdisent aussi de tuer. Mais eux, est-ce qu'ils ne tuent pas? Ici, à Kilamba, en 1931, ils ont massacré un bon millier de villageois. Ils nous interdisent de tuer, simplement pour nous empêcher de combattre l'occupant. Les prêtres nous défendent aussi de voler. Mais eux, ils nous ont volé notre pays, nos terres, toutes nos richesses, nos palmeraies. Quand un homme vole chez un Blanc, il doit aller le dire à confesse. Alors le prêtre court prévenir le patron blanc et le Noir sera chassé de son travail et mis en prison.Abo écoute sans comprendre. Elle s'entendait bien avec les prêtres et les sœurs. Quand elle était malade, une reli gieuse la soignait comme une maman. Les sœurs empêchaient les hommes de faire du désordre avec les filles Léonie en conclut que Mulele est mauvais.A toutes les jeunes filles, Mulele distribue un pantalon de couleur vert foncé et un tricot. Cela suscite l'étonnement, on n'a jamais vu des femmes porter des vêtements d'homme. Abo reçoit aussi une montre. Honoré Kendita, le fils de Benoît Mulele, demi-frère de Pierre, qui est commerçant à Kikwit, apporte régulièrement de la nourriture au camp. Dans les villages où il cherche du manioc, il fait une propagande tapageuse pour le maquis. - Mulele est venu par magie de Moscou, accompagné d'une femme. Elle sait tout faire. Elle possède une montre et quand elle y regarde, elle voit l'endroit d'où approchent les militaires et prévient Mulele du danger. Elle distribue des médicaments qui vous permettent de tout connaître. Selon Mulele, ce que l'homme peut faire, la femme le peut aussi. Les filles doivent aller chez lui pour apprendre à fabriquer des assiettes, des verres, des casseroles. Nous allons bâtir nos propres usines et tout fabriquer nous-mêmes. Les jeunes filles qui arrivent au maquis sont convaincues que, désormais, les Noirs construiront eux-mêmes leurs usines et fabriqueront ce dont ils ont besoin. Convaincues que Mulele, grâce à sa force magique, résoudra bien des problèmes en un tour de main, elles ne se rendent pas compte des délais et des efforts qu'exigera la réalisation de leurs rêves.A Esiet Lankat, Mulele donne une deuxième leçon.- Nous allons faire une révolution pour chasser les Blancs et pour nous occuper nous-mêmes de notre pays. Mais, pour comprendre la révolution, il faut d'abord connaître les cinq étapes de l'humanité. La société n'est pas immuable, l'humanité progresse par étapes.D'abord, l'homme a vécu dans la société primitive. Les gens vivaient ensemble, à peine séparés des animaux^ Ils n'avaient de force qu'en se regroupant. Ainsi, en bandes, ils luttaient contre les animaux, allaient à la pêche et a la . Ils étaient encore sauvages, presque des animaux, mais ils avaient l'intelligence. Il n'y avait pas de différences de classe tous faisaient les même travaux. Ils ont inventé le feu et les instruments de la chasse, en pierre et en bois. Après, ils ont commencé à travailler la terre et à produire beaucoup de nourriture. Il y a eu une division de travail.A ce moment a surgi l'inégalité, la haine et la jalousie. Il y avait des chefs qui dominaient les autres. Puis les différentes bandes ont commencé à se faire la guerre pour prendre des esclaves qu'ils faisaient travailler pour eux. On a vu la classe des seigneurs qui possédaient tout et la classe des esclaves qui n'avaient aucun droit. Les riches ne travaillaient pas, ils avaient le temps pour organiser une armée afin de mater les esclaves. Ils trouvaient aussi le loisir d'apprendre à lire et écrire et d'étudier les secrets de la nature. Ils ont inventé le métier à tisser et des instruments pour labourer la terre. La société produisait maintenant beaucoup plus de richesses. Mais les esclaves ne cessaient de lutter contre les tyrans pour qui l'esclave n'était qu'une bête. Finalement, les esclaves refusaient de travailler et la production régressait. Alors les maîtres ont dû accorder la liberté à leurs esclaves et leur permettre de travailler un lopin de terre. Mais les seigneurs féodaux continuaient à posséder la terre et les instruments de travail. Les gens étaient devenus des serfs, ils n'étaient plus esclaves, ils avaient une certaine indépendance mais ils devaient livrer une partie de leur récolte au seigneur. Dans cette société féodale, la connaissance des hommes a progressé. On a inventé la charrue de fer, la forge, la roue hydraulique, les hommes ont commencé à apprendre le métier de tisserand, d'armurier, de meunier, de cordonnier. On a créé des villes et le commerce s'est développé avec des pays lointains. Mais souvent, les paysans et les artisans se sont soulevés contre leurs exploiteurs. Quand les marchands avaient amassé beaucoup d'argent, ils ont inventé les machines. Les riches ont créé des usines et les pauvres, qu'on chassait de leur terre, étaient obligés de se vendre aux riches pour aller travailler dans leurs usines. Ainsi on a eu des capitalistes qui exploitent des ouvners. C'est comme les Huileries du Congo Belge où vous allez travailler durement pour un petit salaire. Les usines créent beaucoup de produits différents en grande quantité, mais tout appartient au capitaliste. Au Congo, les capitalistes belges possèdent les usines, les machines et les richesses du sous-sol. Ils sont venus razzier les Noirs dans leurs villages, même ici, au Kwilu, pour les déporter au Katanga où ils peinent dans les mines.La révolution socialiste, c'est les travailleurs et les pauvres qui s'emparent des usines, chassent les capitalistes et font tourner les usines au service de la population qui travaille. Les partisans écoutent la leçon. Personne n'y comprend rien. Mulele et Bengila la répètent le lendemain. On en retient quelques idées, quelques explications. Les capitalistes sont venus razzier des gens à Lukamba. Ils les ont déportés pour travailler comme des esclaves au chemin de fer du Katanga. Mais le panorama historique des cinq étapes de l'humanité reste enveloppé de traînées de brouillard. A l'école, Abo a appris l'existence de deux pays: le Congo et la Belgique. Mais, seule, elle a découvert Moscou: c'est le nom d'une danse qui a fait fureur au moment de l'indépendance. Mulele lui explique qu'il y a des pays africains qui entourent le Congo, par exemple l'Angola, l'Ouganda, le Soudan. Au cours des leçons de géographie, les futurs maquisards apprennent aussi à nommer et à situer les pays socialistes. Moscou est donc la capitale d'un pays socialiste.Pascal Mundelengolo, l'instituteur, et Casimir Malanda, propriétaire d'une plantation, tous deux de Matende Mulembe, arrivent à Esiet Lankat avec deux fusils de chasse. Ils sont du clan d'Abo, des Mbwitsambele. Deux jours plus tard, Pascal Mundelengolo donne sa première leçon politique. Juge au village, il utilise adroitement les chansons du tribunal, les proverbes et contes et fait rire les partisans en imitant les gestes du tribunal coutumier et en exécutant les pas de danse de mise le jour du jugement.Après dix-neuf jours à Esiet Lankat, le camp compte 150 jeunes dont une vingtaine de filles. Le long de la petite route Mungai-Nkata, on peut constater que la brousse a été Piétinée par un déplacement important de personnes. Des collines environnantes, les villageois voient le remue-ménage des partisans dans la savane. Pas l'endroit idéal Pour une activité qui se veut clandestine. Le 27 août a quatre heures du matin, nervosité affairée parmi les cent cinquante campeurs. Répartis sur un large éventail, pour ne pas laisser de traces, ils se dirigent vers la route. Après une marche de deux heures - on s'est déjà entraîné aux déplacements de nuit, la seule peur est celle des serpents - on reforme l'éventail en sortant de la brousse.Soudain, on se trouve au bord d'une grande vallée couverte d'une forêt dense. On pénètre dans la forêt de Nkata. L'après-midi, les filles vont en groupe cueillir des champignons dans la forêt et pêcher des poissons dans la rivière. Le soir elles causent et Abo présente les contes qu'elle a appris au village. A Nkata, toutes les jeunes filles sont pour la première fois regroupées dans un peloton. Six filles sont dirigées par un chef d'escouade. Deux escouades forment une section et trois sections, c'est-à-dire trente-six filles, constituent un peloton. Abo effectue bien les exercices militaires. Les autres filles lui trouvent du courage. - Oui Abo, tu seras chef du peloton, c'est toi qui as un peu de courage. Mukulubundu lui explique comment exercer le commandement. Abo est fort gênée, elle a une voix douce qui ne parvient pas au dernier rang. Le rassemblement se fait dans une grande clairière, au milieu de la forêt. En tant que chef de peloton, Léonie connaît toutes les filles de son groupe. Chaque matin, elle fait son rapport, donne les noms des absentes, des malades et des nouvelles venues. Les exercices militaires ont lieu après le salut au drapeau rouge : courir, ramper, marcher, repos, garde-à-vous, portez armes. Ensuite, on retourne à la place du rassemblement, on forme à nouveau les rangs et on s'assoit pour la leçon politique. Finalement on distribue les tâches : chercher du bois ou de la nourriture, faire la cuisine. En tant que chef de peloton, Abo doit mettre chaque fille au travail, surveiller et diriger les différentes activités. Comme Nampiel et Ankiel, qui dirigeaient les villageoises, au temps où les Blancs commandaient à Lukamba... Un matin, aux exercices, Rosalie Ngondo tombe en syncope et Abo lui administre des calmants. C'est ainsi que débute son activité d'infirmière au maquis. Avec Rémy Ndambila, elle soigne la toux, la fièvre, les blessures, la diarrhée ou la constipation. Elle s'est résignée à l'idée de devoir rester dans la forêt pour faire la révolution. Elle a compris, tant bien que mal, que les colonialistes se sont imposés au Congo par la force de leurs armes. L'indépendance du Congo n'est qu'apparence. Pour obtenir une indépendance réelle du pays, il faut chasser les dominateurs blancs par la lutte armée. Tout le monde lui dit qu'elle fait de grands progrès. Mulele la taquine. - Ils disent que tu es ma femme. Les villageois croient que tu es venue avec moi de Moscou. Elle ne répond rien. Elle a déjà compris que, la nuit, il ne se transforme pas en serpent ou qu'il ne se rend pas invisible. En fait, c'est un homme comme les autres. - Tu resteras avec moi en forêt. Tu seras ma femme. Abo se lève et s'en va sans un mot, troublée. A Nkata, les premiers partisans écoutent les leçons politiques pour la quatrième fois. Mulele demande à certains de répéter une leçon devant l'assemblée. Les plus courageux, une fois les leçons bien assimilées, sont renvoyés dans leurs villages en groupes de trois ou quatre. Ils contactent le chef qui convoque son monde pour écouter la première leçon. Abo reçoit la garde d'un grand sac de voyage, fabriqué en étoffe épaisse, couleur militaire. Il contient les habits de Mulele, une radio et quelques livres emmenés de Chine. La peur a cessé. Quand Mulele lui parle, elle ose émettre une réponse. Elle va lui chercher de l'eau. Mulele se moque de sa voix timide et il rit des efforts de Mukulubundu pour la transformer en capitaine de guerre. La nuit, à la lumière d'une lampe à pétrole, Mulele lit ses livres. Des centaines de jeunes, de tous les villages du secteur Lukamba, se mettent en route à la recherche de Mulele, un sac de raphia et une petite natte enroulée sur le dos. Chaque jour, ils sont cinq, dix à le trouver. Jean Mimbu, un natif du village Nkata, arrive au camp. Le service d'accueil vide son sac à dos. Outre l'accoutrement de tout partisan, on y trouve... un uniforme de policier au grand complet, casque y compris! Nestor Mutunzambi a donne ordre a ses policiers d'infiltrer les groupes de jeunes en partance pour le maquis. Policier à Kikwit, Jean Mimbu n'a pas eu de peine à se lier damitié avec les jeunes de son village. Demain, avaient-ils chuchoté, nous irons chez Egnang Lamvul La garde traîne notre agent secret gaffeur devant Mulele, assis pour une causerie. On place Mimbu devant un grand arbre en face de Mulele. L'homme tremble, la sueur ruisselle de son visage. Celui qui l'a arrêté lui dit: - Tu es venu découvrir l'endroit où se cache Mulele, eh bien, le voilà!A ces mots, Mimbu commence à trembler violemment de tout son corps avant de s'effondrer. Un partisan le ligote à la commande, jambes et bras attachés derrière le dos, et l'interroge. Il avoue immédiatement que Nestor Mutunzambi et Macair Kawanda l'ont envoyé à la recherche de Mulele. Par mesure de précaution, cette nuit, il faudra quitter le camp de Nkata. A quatre heures du matin, les partisans traversent la brousse de Mungai. Des villageois viennent informer Mulele que Macair Kawanda, qui est de la région, y a recruté des espions. Ils indiquent une maison où se trouvent deux d'entre eux, Macaire Edzung du village Kimbanda et... Gaspar Mumputu, le mari d'Abo. A l'intervention des partisans, Mumputu prend ses jambes à son cou mais Edzung est arrêté. Cette journée, la colonne reste dans un petit bois près de Mungai. Avant d'y pénétrer, les partisans ont surpris une antilope dans la brousse. Ils l'ont encerclée et sont arrivés, en un terrible corps-à-corps, à la maîtriser et la tuer. La nuit suivante, Mulele et Abo passent à la maison de Casimir Malanda; c'est chez lui que Mulele et Bengila sont descendus en voiture, à leur arrivée de Kinshasa.Casimir Malanda conduit les partisans à Mulembe à un endroit sûr. On y arrive le 10 septembre. La rivière Labue se divise en deux pour former au milieu une petite île, couverte de forêt et que l'on appelle Esang Osut Les partisans y construisent leurs bivouacs. Aux alentours, il y a une brousse parsemée de grands arbres. Pendant la journée, Mulele reçoit trois, quatre chefs de village et des notables,venus lui donner les dernières nouvelles. En les saluant Mulele chante:
Je demande à mes étrangers, En réponse, les chefs reprennent le chant. La nuit, par groupes de dix, les villageois apportent du iouiou, du poulet et des légumes. Certaines nuits, on voit arriver jusqu'à cinquante jeunes, quelques-uns restent, d'autres repartent emportant les paniers vides.Chaque famille considérerait comme une honte de ne pas avoir un enfant chez Mulele. Un père dira à Mulele, avant de retourner au village: - Là où tu vas mourir, mon enfant mourra. Et une mère :- Prends bien soin de ma fille, elle est maintenant ta femme. De toute jeunes filles de onze, douze ans, sont au centre de petits drames. - Tu as bien fait de l'amener, dit Mulele, mais elle est encore très petite. Il va y avoir beaucoup de difficultés: les militaires, la faim, la pluie, les longues marches à travers la forêt. Elle reviendra un peu plus tard. Les parents reçoivent ces paroles comme une insulte: - Mon enfant n'est pas bon? Bientôt on compte cinq cents jeunes au camp de Mulembe. Les chefs de village y introduisent quantité de fétiches. Des chefs tchokwe, mbuun et pende, après de longs voyages, arrivent à Mulembe. Ils sont particulièrement fiers d'une poudre d'une puissance extraordinaire qui s'applique sur le front. Les militaires qui s'approchent ne vous remarqueront pas, mais ils verront des lions et des léopards et prendront la fuite comme des gazelles. Mulele remercie les chefs de leur confiance. Après leur départ, il dit aux jeunes: - Je ne peux pas mettre mon esprit derrière un arbre. Ce n'est pas une poudre, fabriquée avec des plantes et des feuilles, qui peut nous protéger. Pour se protéger, il ne faut compter que sur la tactique militaire. A Mulembe, Abo retrouve son frère Liévin Mitua, l'enseignant de son clan et Kafungu, l'instituteur de son village. Eugène Mumvudi, un Mukwese, ex-militaire, leur tient souvent compagnie, tout comme Théotime Ntsolo, un ancien instructeur de l'Armée Nationale Congolaise. Abo remarque que depuis deux semaines, Mulele se tient souvent à l'écart avec quatre partisans luba à qui il donne des leçons parti-cuhères. Enfin, elle voit les quatre partir pour une mission au Kasaï.Le 15 septembre, Mulele envoie ses frères Gaspar Ngung et Mbalan Etang à Lukamba pour sceller son mariage avec Abo. Awaka, le père, Ebul et Ernest Kwanga, les oncles, reçoivent la dot. Mais le mariage est à prix réduit puisqu'il se passe en famille. En effet, Ebul est marié à Ngwom, la sœur de la mère de Mulele. Abo pense toujours épouser Rémy, mais personne ne lui demande son opinion. Elle a déjà suivi quelques leçons politiques sur l'égalité de l'homme et de la femme, sur son droit à choisir son mari et à apprendre un métier comme les hommes. Mais le sens de toutes ces révélations ne lui est pas encore parvenu. Le 20 septembre, un délégué du PS A prévient Mulele que quarante militaires sont arrivés à Mulembe et qu'ils s'apprêtent à attaquer le camp. Dès l'aube, Mulele conduit les partisans vers la savane entre Mulembe et Yassa Lokwa. Bengila, Abo et Amek, une fille de Bozombo, restent au camp pour s'occuper des derniers bagages. Entre l'îlot et la rive droite, il n'y a qu'une petite rivière peu profonde, large d'une dizaine de mètres. Bengila fait des va-et-vient à travers l'eau pour passer les dernières affaires. Le travail terminé, tous les trois cherchent des plantes mbwil-a-mbaam, une liane rampante qui s'enroule autour du pied des arbres. D'une longueur de plusieurs mètres, elle porte de grandes feuilles vertes. Les trois partisans s'en camouflent les jambes, le corps et la tête, puis descendent en courant la petite plaine qui longe la rivière et grimpent la colline où se sont disposés Mulele et les partisans. C'est à ce moment-là que les militaires font leur apparition sur les collines d'en face, séparées de Mulele par une petite vallée. Ils remarquent les trois partisans en tenue de camouflage. Puis ils voient Mulele et ses hommes, assis. Les militaires leur crient: Est-ce que nous pouvons tirer? Abo entend les partisans répondre:- Bula, bula, bula! Tirez! - Beto bula? Est-ce que nous pouvons tirer? - Bula! Puis de nombreux partisans se lèvent et s'exclament, les bras en l'air:- Nous allons vous prendre avec nos mains! Mulele crie:- Couchez-vous! Ils n'écoutent pas. Mulele se jette au sol et la plupart des hommes l'imitent. Certains restent debout au moment où la salve part. Ce bref affrontement assez symbolique terminé, tant les partisans que les militaires prennent la fuite. Un partisan d'Inkasambu est gravement blessé à l'articulation du bras et sera évacué vers Kikwit. Donatien Nzoz a reçu une balle dans l'épaule. Abo lavera sa plaie à l'alcool, y mettra du mercurochrome puis de la poudre de sulfamide, suturera la plaie avec une pince et du catgut et lui fera des injections d'antibiotiques. Au premier sifflement de balle, certains partisans ont démarré pour une course de fond qui les a amenés, vingt-cinq kilomètres plus loin, à Musenge Munene. De ceux-là au moins on ne dira pas qu'ils ont entamé le maquis dans de mauvaises conditions physiques. Par la suite, les militaires raconteront qu'ils avaient encerclé Mulele en personne avec sa femme et que, tout à coup, ceux-ci se sont métamorphosés en serpent arc-en-ciel, le mbweng esasj aux couleurs blanc-rouge-noir. Un proverbe mbuun dit:
Celui qui voit mbweng esasj,devra attendre une année pour le revoir. Les soldats ont vu disparaître les serpents dans la broussaille. - Il ne faut plus nous rapprocher trop de Mulele. Il pourrait se transformer à nouveau en mbweng esasj et alors un grand malheur nous frappera. 6. 20 septembre - 16 novembre 1963 Bêla Borna, Iseme et Bembele Busongo - Table de matières Leçons de la première victoire symbolique sur l'armée. Le camp d'Iseme et ses jeunes téméraires. Les femmes dans la révolution. Extension du mouvement sur le territoire du Kwilu. Attaque surprise de l'armée, dispersion des partisans.Quelques heures après l'attaque des militaires à Mulembe, trois cents partisans se retrouvent autour de Mulele dans la savane de Bêla Borna. Pas le temps de construire des bivouacs. Nuits sous les arbres, nuits sous les astres. Pas d'exercices militaires le matin, Mukulubundu, l'instructeur, se planque à Musenge Munene. Rassemblement général, le commandant en chef donnera une leçon politique. - Vous ne m'avez pas cru, quand j'ai dit que les militaires nous attaqueraient, commence Mulele. Moi, je ne leur ai rien fait. Pourtant, ils nous attaquent et ça continuera. Vous avez vu que deux camarades ont été blessés par balle. Les chefs coutumiers vous ont apporté des médicaments et des fétiches pour vous prémunir des balles. Je n'ai pas voulu les décourager. Mais vous constatez que ça ne marche pas. Notre fétiche, c'est la tactique militaire. Nous devons nous cacher, tendre des embuscades, attaquer l'ennemi à l'im-proviste. Donc, vous devez vous initier à la tactique du combat, vous montrer assidus et diligents lors des entraînements militaires. Pourtant, pour le moment, nous n'allons pas nous battre avec les militaires. Il faut d'abord bien comprendre pourquoi nous luttons et contre qui. Chaque jour, les partisans se déplacent dans la brousse entre Bêla Borna et Mulembe pour éviter d'être découverts Par les militaires. La peur et l'émoi passés, par petits grou-Pes, les jeunes dispersés rentrent au camp. Bengila donne une causerie politique. - Il y a un bon mois que nous nous trouvons en forêt. Vous êtes déjà plus de six cents à nous avoir rejoints. Tous les villageois vous soutiennent pour lutter contre l'injustiCe Nous ne possédons pas d'armes, mais vous avez constaté que nous faisons peur aux soldats. Ils ont tiré et, comme ils ont vu que cela ne nous effrayait pas, ils ont pris la fuite. Les soldats tremblent. Ils racontent dans les villages qu'ils ont vu de tout petits hommes, pas plus hauts que les genoux des nains, que les balles ne peuvent pas atteindre. Vous pouvez en conclure que notre révolution est bien forte.Après avoir erré dix jours dans les hautes herbes autour de Bêla Borna, pratiquement tous les partisans sont revenus. Désorientés devant l'âpreté de la lutte, certains ont pris la fuite pour se tapir dans la tranquillité du village. Mal leur en a pris. Les militaires font des razzias sur les villages pour y arrêter et torturer les jeunes qui se sont rendus chez Mule-le. Bouleversés, perdus, feignant un courage à toute épreuve, ils reprennent le chemin du maquis. Trois policiers, un Mumbunda du nom de Séraphin Mbwantsam, un Mumbala et un Muyanzi se glissent parmi eux. Lorsque les gardes du camp se préparent au contrôle de routine, les trois mousquetaires se mettent à trembler comme des sarments dans la tempête. Ils ont entendu tant d'histoires sur la force magique de Mulele que des spasmes secouent leur corps à l'idée que Mulele a déjà regardé dans leur cœur et y a découvert leurs mauvaises intentions. Les partisans se ruent sur les flics, découvrent dans leurs sacs des uniformes bleu foncé à raies rouges et des casquettes. Ils les tabassent à mort. Abo lavera encore leurs plaies et leur mettra des bandages, mais en vain. Avant de rendre l'âme, les trois policiers avouent qu'ils dépendent de Nestor Mutunzambi qui circule dans les environs.- Je sais que vous êtes en rage depuis l'attaque des militaires, dit Mulele à ses hommes, mais si vous tuez les espions, ils ne pourront plus nous renseigner sur leurs commanditaires. Papa Pascal Mundelengolo, instituteur et juge de village à Mulembe, donne une leçon. - Mulele vous a dit qu'un jour, les militaires viendront le chercher en forêt. Pourquoi les militaires? Le gouvernement en place voit que ses intérêts sont menacés. Il constate que tous les villageois se rendent dans la forêt pour écouter Mulele, Mulele qui leur dira la vérité sur tous les mauva" actes de ce gouvernement. Il y quelques années, nous avonl demandé notre indépendance. Maintenant, des Noirs nous gouvernent, mais ce sont justement ceux qui s'étaient opposés à la lutte pour l'indépendance. Ils veulent que les Blancs restent pour nous dominer. Ces Noirs craignent que la population ne les suive plus après avoir entendu Mulele. Ils envoient leur militaires pour nous faire la criasse. Derrière les Noirs du gouvernement, se cachent les Blancs qui possèdent les compagnies comme les Huileries du Congo Belge, la Compagnie du Kasaï, la Compagnie Jules Van Lancker. Ils s'inquiètent. Leurs ouvriers ne leur obéissent plus. Leurs usines risquent de s'arrêter. Donc, la lutte sera dure, nous aurons encore des attaques. Qu'en pensez-vous? Pourriez-vous supporter toutes ces difficultés?- Nous voulons continuer la lutte quand même. - Si certains pensent que c'est trop difficile, ils peuvent partir.Personne ne se manifeste. Mais le lendemain quelques partisans manquent à l'appel. Le camp se déplace, les fuyards pourraient renseigner les militaires. Abo, Mulele et un groupe de partisans marchent le long de la route entre Mulembe et Banda, lorsqu'ils entendent le bruit d'un camion. Des militaires, avançant si lentement que leur voiture semble trembler sur ses quatre roues. Mulele et ses hommes sont à plat-ventre à dix mètres de la route.- C'est vraiment trop dangereux, entendent-ils de la bouche d'un soldat. - Impossible de les voir. - Et ils peuvent nous tuer d'un moment à l'autre, dit une troisième voix. Dans un état de grande excitation, Abo relate cette rencontre au camp: c'est la première fois qu'elle ressent la force de la masse qui n'a rien dans les mains, mais qui effraie des soldats armés jusqu'aux dents. Et c'est ainsi qu'Abo commence à saisir le sens d'un proverbe qui circule dans tous les villages. Ngo wo ngo aton, disent les vieux parlant du commandant en chef. Ce léopard se distingue par ses taches, ce léopard est très spécial et mystérieux. Le proverbe signifie que Mulele a insufflé une force insoupçonnée à la population.Ngo, le Léopard, est devenu 1 appellation la plus populaire du camarade en chef. Les villageois parlent aussi d'Ebun Emvul, le nuage qui porte la pluie. Pour ne pas trahir les partisans devant des oreilles ennemies, même inconsciemment, personne ne prononce plus le nom de Mulele au village. Frère, je pars chez Egnang Lamvul, la Goutte de Pluie. Ma fille se trouve chez Nga Bul, le Chef du Pays. Le papa est content d'avoir écouté Nga Maan, le Chef de Terre. Les villageois comprennent parfaitement à qui on fait allusion. Le 30 septembre vers vingt-deux heures, répartis sur une longue distance, les partisans quittent la brousse de Bêla Borna pour se regrouper sur la route qui mène à Iseme. A cinq heures, en pleine forêt, Abo découvre un mutambu, un piège pour animaux sauvages. C'est un couloir étroit. Les animaux qui s'y engagent cassent un fil qui déclenche un mécanisme leur balançant un lourd tronc d'arbre sur la tête. Et un boloko, l'antilope célébrée dans nombre de contes pour son intelligence, n'a pas eu assez d'esprit, cette fois-ci, pour déjouer la perfidie de l'homme. Les maquisards construisent le bivouac qu'ils nomment le camp boloko d'Iseme. La défaite symbolique de l'armée à Mulembe, transmise de bouche à oreille, véhiculée de village en village, se charge de mystères et de signes magiques et un enthousiasme fiévreux s'empare des jeunes qui affluent de plus en plus nombreux au maquis. Pour refroidir les nouveaux-venus, on leur parle d'abord des difficultés. Marcher sous la pluie torrentielle, parcourir la forêt pendant toute la nuit, souffrir de la faim, être pourchassés par les militaires, attaquer les soldats et affronter leurs balles. Si tu te sens de taille à affronter ces terreurs, tu restes.Un après-midi, à l'heure de la sieste, une tranquillité de rêve. Soudain, un cri éclate, fait sursauter tout un chacun. Félix Mukulubundu hurle: - Avion wana! Quand un avion surgit dans le ciel, il faut se coller contre le tronc d'un arbre. Félix l'a répété souvent à l'entraînement militaire. Voilà l'heure de la pratique arrivée. Les partisans se moquent de Félix. Ils n'ont pas la moindre idée de ce qu'est la guerre. Presque gamins encore, ils trouvent leur expert en armes fort peureux. Dans quelques mois, ce sera la victoire, on n'en doute pas. Du pays, les jeunes connaissent une douzaine de villages. Les plus fortunés ont fait de longs voyages jusqu'à Kikwit, Gungu, Feshi, Kahemba, Mangai. Ils ont de la peine à imaginer où se trouve le mauvais gouvernement, de quelles forces il dispose, de quelles tactiques il usera. Oui, on souffre, on chôme, ils nous prennent pour moins que rien, ça ne peut plus durer, il faut lutter. Pourtant, rien dans les souvenirs, ni la chasse, ni les escarmouches entre clans ou villages, ne permet de se faire une idée de ce que lutter veut dire. Mais la victoire est certaine.Monique Ilo est devenue la meilleure amie d'Abo. Monique parle de son ami, de ses inquiétudes aussi: - Peut-être mourrons-nous dans cette forêt? Abo s'est déjà habituée à l'idée qu'elle restera longtemps en brousse et en forêt. En quelques semaines, sa vie a pris un nouveau pli.- Si c'est la mort, ce sera la mort pour tout le monde. Oui, en moins de deux mois, Abo a vu se retourner pas mal de vérités établies et s'affirmer de nouvelles. Les prêtres blancs sont mauvais. Il ne faut pas que des étrangers dictent la loi dans notre pays. Nous devons avoir le courage de mourir pour que le Congo soit libre. La femme sera l'égale de l'homme. Bengila aime broder sur ce thème. Il répète que la femme ne se rend même pas compte qu'elle est l'esclave de l'homme. Elle est trop obéissante. Si son cochon a ravagé un champ, on ne la jugera pas, on viendra chercher les hommes qui sont derrière elle, l'oncle, le père, le frère. Si elle a blessé ou tué quelqu'un, elle expliquera tous les détails du drame à son oncle qui, devant le tribunal, prendra la Parole pour elle.Aujourd'hui Mulele parlera des femmes. - Les femmes mettent les enfants au monde; pourquoi doivent-elles laisser la lutte aux seuls enfants et rester derrière eux? Elles souffrent avec les enfants, elles doivent lutter avec les enfants, mourir ensemble ou connaître le bonheur ensemble. Les femmes connaissent beaucoup de choses. Elles ont l'habitude de bien réfléchir, elles peuvent nous donner conseil. Si les hommes agissent seuls, ils feront des bêtises. La mère de Marc Katshunga, à l'indépendance, était déjà très vieille, mais elle écoutait chaque jour les nouvelles à la radio. La femme doit s'intéresser au sort du pays. Sinon, elle ne comprendra pas pourquoi son enfant lutte, elle dira qu'il est bandit. Les femmes sont toujours avec les enfants, elles les éduquent. Si la femme ne connaît pas les misères du pays et ne sait pas comment lutter, les enfants ne l'apprendront pas non plus. Il y a des pays où les femmes ont lutté à côté des hommes. Angela Davis est une Noire américaine qui a beaucoup lutté. Valentina Terescova a été la première femme astronaute. Vous voyez ce que les femmes peuvent faire dans les pays socialistes. En Chine, j'ai vu des femmes travailler comme ingénieur, directeur d'entreprise, pilote d'avion, j'en ai vu commander dans l'armée, conduire des chars. Avant la révolution, la femme chinoise ne pouvait pas sortir de sa maison. Dès l'enfance, on lui bandait les pieds pour qu'ils restent petits, atrophiés. Sur ses pieds déformés, la femme ne pouvait pas s'enfuir. C'est le président Mao qui a combattu tout cela.Un petit détail intrigue les jeunes. Mulele a séjourné presque une année entière en Chine. Pendant tout ce temps, il n'a pas connu une seule femme chinoise, d'après ses dires. Il y a la discipline là-bas. Oui, bon, on veut bien. Mais quand même, toute une année, camarade en chef, c'est vraiment difficile. Quand vous ne faites pas ce travail, les vieux disent que vous devenez malade à la colonne vertébrale. On s'étonne. Est-ce que les Chinois vous avaient donné des médicaments pour ça?- Ecoutez, quand on est en guerre, il ne faut pas trop vous occuper de ça. Il y a autre chose à faire. C'est encore leur président Mao qui les a éduqués dans ce sens.Oui, c'est vrai, tu as encore raison, camarade en chef, nous sommes en guerre. Il fallait y penser. Mais comment peut-on faire la guerre si l'on n'a pas de bonnes armes?Personne n'en a la moindre idée. La réponse dans la leçon de demain.. Nous nous trouvons les mains vides. Nous cherchons des armes. Qui va les apporter? Ce sont les militaires qui transporteront nos armes jusqu'au maquis. Nous devons apprendre comment nous, qui avons les mains vides, pourrons obtenir des armes des mains de nos ennemis. Nous apprendrons à faire des embuscades. Attaquer les ennemis à leur insu, avec nos flèches, nos lances, nos machettes. Nous pouvons les vaincre grâce au nombre et au secret. Les filles aussi peuvent prendre des armes. Le chef de village vous renseignera sur le comportement des différents soldats qui viennent chez lui. Vous pouvez apporter du vin aux militaires pour les soûler. Puis leur dérober leurs fusils. Dix jours après l'arrivée au camp boloko d'Iseme, plus de mille partisans posent des problèmes énormes de ravitaillement, de mobilité et de sécurité. A observer la brousse aux alentours, on dirait qu'un troupeau d'éléphants y a fait longuement la fête. Mundelengolo et Kafungu accélèrent la formation des jeunes qui retourneront dans leur village pour y créer des équipes locales. L'ennemi lance ses espions à la recherche de Mulele. Comme riposte, on multipliera les Mulele sur tout le territoire du Kwilu. Le camp sera divisé en trois groupes autonomes qui implanteront la révolution dans différentes zones. Félix Mukulubundu et Valère Mun-zamba conduisent 380 partisans en direction de la rivière Kasaï. Rassemblement à vingt heures. Mulele va saluer les hommes en partance pour Kalanganda. Deux jours plus tard, un deuxième groupe du même nombre part avec Louis Kafungu et Eugène Mumvudi vers Kilembe. Mulele et Ben-gila resteront sur place, au centre. Mais par mesure de sécurité, leur camp se déplace de quelques kilomètres jusqu'à Bembele Busongo.Stéphane Etshwe fait la navette entre Idiofa et le camp ^ la direction. Un jour il amène une nouvelle qui trouble Abo: Rémy Makoloni veut rencontrer Mulele. Le camarade en chef débite quelques blagues peu réussies: Ton mari viendra ici, tu partiras avec lui? Léonie s'en va sans rien dlre. Elle appréhende l'apparition de Rémy. Comment seront les retrouvailles après tous ces événements extra-ordinaires qui ont bouleversé leur vie à tous les deux? Mais Rémy, longtemps attendu, n'arrivera jamais. Alors qu'il faisait route vers le maquis dans un camion bourré de vivres, il a été intercepté par l'armée et jeté en prison. Condamné,' Rémy Makoloni sera enfermé à Oshwe. Le 30 octobre à l'aube, des coups de fusil réveillent les partisans. Abo saute du lit. Mulele est debout dans la tente. Les tirs se rapprochent. Panique. Mouvements en tous sens. Fuir. Abo abandonne son petit sac contenant les habits de Mulele, sa radio et ses propres vêtements. Les militaires ne sont pas passés par les villages, sinon un émissaire aurait donné l'alerte. Abo ne regarde ni à droite ni à gauche. Elle suit Mulele. Sûr qu'elle ne sera pas prise. Faut pas quitter Mulele. Derrière elles courent Monique, Soulié, Rosalie: faut pas quitter Léonie. Sûr qu'elle ne sera pas prise. Au cours de l'attaque de Bembele Busongo, on perd les grandes tentes. Les militaires trouveront des taches de sang sur le poste Zénith. Ils diront qu'ils ont coupé les doigts de Mulele. Plus tard, Mulele enverra des partisans faire une enquête dans les villages environnants. Un type d'Impasi a trahi et conduit les militaires jusqu'au camp. Les villageois ont appris à la radio que Mulele a perdu ses doigts. Il faudra qu'ils voient ses doigts, qu'ils les touchent. Bah, la radio, une invention des Blancs, ça ne dit que des lokuta, des mensonges. Lors de la fuite, Abo a perdu Mulele de vue. Comment est-ce possible? Elle se retrouve seule avec Soulié, égarées dans la brousse de Bembele. Que faire? Les deux filles se retirent vers Banda, le village natal de Soulié. En chemin elles rencontrent Delphin Mbumpata. A Banda, Abo et son frère décident de continuer pour Lukamba Bozombo où ils arrivent vers vingt heures. La première maison du village est celle de l'oncle Ebul, où vit la mère de Mulele depuis la mort de son mari, en 1960. Abo frappe à la porte. Une fois entrée, elle sent que la peur hante la maison. Non, c'est trop risqué de te garder ici, c'est le premier endroit que les militaires viendront fouiller. Cache-toi en brousse pendant la journée. La nuit, tu rentreras à la maison dormir. Non, trop dangereux encore. La mère de Mulele part chez Louis Ikuma, un enseignant de sa famille. Au dessus du plafond de son salon, il y a une cachette. Léonie et Delphin y seront en sécurité. A peine y sont-ils installés que Marguerite Mim-pia entre: Les militaires sont à Mukulu, ils savent que tu es à Lukamba, ils descendront ici à l'aube. A trois heures de la nuit, Abo et Mbumpata se mettent en route pour Banda. Le matin, ils y rencontrent une soixantaine de partisans à la recherche de Pierre. Ils se cachent dans la forêt. Un villageois apporte la nouvelle que toutes les jeunes filles de Lukamba Bozombo ont été arrêtées. Les militaires triomphent, certains d'avoir mis la main sur la femme de Mulele. Les villageois de Banda nourrissent les soixante partisans et leur indiquent le chemin vers un endroit sûr à Busongo. Arrivés à cinq heures, les jeunes se mettent immédiatement en rapport avec le chef Kasongo. Pendant deux semaines, ils campent dans l'ancien bivouac de l'équipe de village, dans la brousse en direction de Musenge Munene. De toute part affluent les nouvelles. Les militaires razzient la région. Un papa, dont l'enfant est au maquis, a été tué à Musenge Munene. Un groupe de soldats s'est établi dans ce village. Ils ont ligoté le chef, l'ont tabassé et torturé, puis enfermé à la prison de Kikwit. Les militaires ont arrêté 52 jeunes filles de Busongo dans l'espoir de mettre la main sur la femme de Mulele.Le 15 novembre, Joseph Okwono, l'envoyé de Mulele, rejoint le groupe d'Abo. Il a vu les militaires mettre le feu aux maisons de Bwalenge et de Mbwitsambele. Des maisons en pisé, mais quelques-unes en pierre et en tôle. On part à vingt-deux heures pour une marche de nuit. Arrivée à Bêla Borna, chez Mulele, à cinq heures. Le même jour, la colonne des partisans se déplace et s'arrête deux kilomètres au-dessous du village Banda Buzimbila. Plus au nord, dépassé Buzimbila, se trouvent Inkasambu et plus loin, Kim-Pata Eku.Mulele affiche une humeur bilieuse. Sa femme a fui devant le danger. - Retournée au village, tu dis? Moi, est-ce que j'ai un village? La forêt et la brousse sont ma maison. Comprends que notre village est partout!Plus tard, les villageois salueront Abo au camp de Banda Buzimbila avec un chant du tribunal:
La femme d'un chef connaît tous les secrets de son mari et elle doit faire bloc avec lui. 16 novembre 1963 - fin février 1964, A Banda Buzimbila, - Table de matièresDélégations de villageois, le complot du sel Le frère Lauren-tin Ngolo et la religion au maquis. Première opération des partisans. Un enfant de huit ans devient partisan. Terreur dans les villages, assassinat de Kendita et de Matalatala. Elèves et enseignants rejoignent le maquis. Abo au Bureau de la Santé. Premier grand affrontement avec l'armée. Une brise de feu frôle les hautes herbes sur la plaine de Banda Buzimbila. Abo parcourt du regard la vallée creusée par la rivière Bitshil. La bande forestière qui borde l'eau s'effiloche à trois cents mètres de la colline broussailleuse où Abo a pris position. Sur le versant d'en face, Léonie discerne clairement le village Banda Yansi et la grande route qui longe la crête en direction de Lukamba Bozombo. Suivant du regard la route en sens inverse, plus haut que Banda Yansi, elle aperçoit quelques cases de Banda Papi. Abo se retourne et fait face aux montagnes et aux vallées qui cachent les villages Matende. Celui de Rémy Makoloni, Matende Mazinga, celui de Pierre, Matende Isulu, ils sont dix au total. Ici, sous les arbres, les partisans construisent les bivouacs qui abriteront la direction pendant quatre mois. Cet endroit, où était localisé jadis le village Banda Buzimbila, s'appelle le mayumbu.Presque chaque jour, Mulele reçoit des délégations de villageois. Après les paroles d'accueil d'usage, les vieux chantent:nze oyol Parmi les nombreux criquets,c'est vous le plus éveillé, le plus courageux. A quoi Mulele répond qu'il n'est pas le plus éveillé, qu il est seulement venu apporter la révolution. - Grâce à la révolution, tous les criquets, tous les villageois seront éveillés et courageux. s Puis Mulele écoute leurs questions, leurs plaintes, leur, malheurs et leurs espoirs. Après quelques brèves interven& tions, il se met à causer. Le dialogue peut prendre toute ia journée. Pascal Mundelengolo, qu'on appelle déjà le repré-sentant de la masse, l'assiste et y va de ses proverbes et de ses chansons qui ont fait sa renommée comme juge à Mulembe. Avec lui, les vieux s'amusent à cœur joie. Une grand-mère de Lukamba veut parler d'urgence au camarade en chef. 11 n'y a plus de sel dans toute la région, c'est bien connu, on ne s'en fait pas. On se contente du sel indigène. Mais voilà que dans le bivouac, on a découvert le jeune Mipembe avec du sel. Du pur sel de Blanc. Il est sans doute entré secrètement en contact avec les militaires. Mipembe invitera les partisans à goûter de son sel. Après l'avoir savouré, ils ne pourront plus s'en passer et ils iront rejoindre les militaires. Mipembe est un Pénépé, un membre du Parti des Nègres Payés. Il doit être tué. Après des remerciements circonstanciés à la vieille femme, Mulele dépêche un dirigeant enquêter à Lukamba, sur le complot du sel. Abo éprouve déjà de sérieux doutes sur la capacité de la magie d'accomplir l'impossible. Mais sa foi naissante dans les sciences exactes s'ébranle devant une apparition soudaine. Devant elle surgit, riant, un géant qui porte sur les épaules une antilope entière, oreilles, pattes et queue, rien n'y manque, une bête énorme. L'homme dépose son fardeau et le copain qui l'accompagne semble vouloir l'excuser: - Ne t'étonne pas, il est capable de mettre un arbre entier sur l'épaule. Abo observe avec étonnement les bras de fer de Louis Nienkongo, un villageois de Inkasambu, venu apporter, a sa manière bien à lui, une bonne centaine de kilos de viande. Il dit que les militaires sont devenus peureux depuis qu'ils ont découvert que Mulele surgit en même temps dans des dizaines d'endroits différents. Le courage leur revien seulement en face de paysans paisibles. Le matin, ils se ruent dans les villages, rassemblent la population, volent habits et argent, embarquent chèvres et poulets. - Ça c'est pour nous. Votre Mulele va vous nourrir. Tous les hommes doivent se mettre par terre à plat ventre Comme au temps des Flamands, quand ils nous donnaient la chicote. Avec leurs lourdes chaussures, les soldats marchent sur les corps et les rouent de coups de bâton. Ils laissent derrière eux des gens tout en sang.Beaucoup de jeunes filles arrivent à Banda Buzimbila terrorisées. Une histoire toujours pareille, un drame banal qui bouleverse une vie. Quelques militaires, arrosés de vin de palme, ont violé une fille devant tous les villageois. N'osez plus désobéir aux militaires. Cessez toutes vos histoires avec ce Mulele. Des partisans construisent un premier bureau à l'intention de Laurentin Ngolo. Dès que la présence du frère Laurentin aux côtés de Mulele fut connue, vieux et vieilles chuchotaient: Laurentin Ngolo travaille avec Pierre, cette affaire est sérieuse! A Kinshasa, ce frère Joséphite, étudiant la théologie, avait le privilège de pouvoir observer le comportement aussi bien des prêtres blancs que des colons dont ils exprimaient les intérêts économiques en langage évan-gélique. Les écritures saintes lui semblaient destinées à endormir les nègres. Elles assuraient le repos terrestre aux maîtres esclavagistes qui, en prime, s'accordaient une vie éternelle au paradis. Laurentin Ngolo cherchait des livres rédigés par des gens ayant souffert et lutté. Il se constituait une bibliothèque remplie d'ouvrages marxistes. Dans sa maison, beaucoup de nationalistes ont fait leur première rencontre avec Marx et Lénine. Lorsque, en juillet 1963, Mulele et Bengila faisaient un appel aux intellectuels du Kwilu, il fut le seul à quitter Kinshasa pour le maquis. Il épousa alors une fille de Bozombo, Joséphine Mintsamba, une amie d'Abo. Dès le début du maquis, il souffrit de ï'acite, maladie pénible qui gonfle le ventre à cause d'une sécrétion au niveau des parois. Abo le voit couper des planches à la machette. Avec ces lattes, il fabrique une sorte de tbl. Abo sait qu'il souffre, mais ni elle, ni les autres infirmiers ne peuvent le soigner. Jamais, Laurentin ne se plaint lgré la fatigue qu'on lit sur son visage, toujours souriant et aimable, jamais il ne s'accorde de repos. Les partisans admirent son courage. Dans son bureau flambant neuf, matin au soir, Laurentin Ngolo et sa femme traduisent en kikongo les leçons politiques que Mulele et Bengila ont rédigées en Chine. Sous leur surveillance, un groupe d'une dizaine de filles, sorties de l'école secondaire ou normale, copient les cahiers.Laurentin Ngolo a quitté son ordre religieux. Augustin Kalamba, qui fut abbé à Matende Iwungu, dit que Dieu n'existe pas. Qu'en penses-tu, camarade en chef? Au petit séminaire de Kinzambi qu'il a fréquenté en 1946, le jeune Mulele avait commencé par exprimer des doutes quant à la conception immaculée de la Vierge Marie. Cela lui a valu d'être renvoyé. Le camarade en chef aime parler de son premier affrontement avec le pouvoir colonisateur. - Jésus était l'enfant de Marie, dit-il au jeune partisan qui l'interroge. Ceux qui ont écrit les Evangiles ne savaient pas comment naissent les enfants. Ils pensaient que, par magie, une vierge pouvait mettre au monde un enfant. Les prêtres nous disent que l'Evangile est la parole de Dieu. Mais est-ce que Dieu ne savait pas comment on fait les enfants? Comment Dieu pouvait-il faire écrire de telles bêtises, s'il existe et connaît tout? Jésus était un homme qui vivait dans une société esclavagiste et il a lutté pour libérer les esclaves. Pour cette raison, les Romains l'ont crucifié. Jésus a été exécuté comme des centaines d'autres rebelles qui refusaient l'esclavage. Sa mort sur une croix n'avait rien de spécial. Mais une centaine d'années plus tard, les évangé-listes ont inventé un tas d'histoires. C'est eux qui ont fait de Jésus, le rebelle, un dieu protégeant les tyrans. Les lettres des apôtres disent que l'esclavagisme est voulu par Dieu, que l'esclave doit obéir à son maître. C'est ça, la paiole de Dieu? Non, ces lettres des apôtres sont seulement la parole des hommes qui ont créé la religion. Et ces hommes acceptaient l'exploitation et l'esclavagisme. Au Congo, les Portugais ont commencé à capturer des esclaves il y a cinq cents ans. Les prêtres ont dit tout le temps que l'Evangile accepte l'esclavage et que c'est la volonté de Dieu. Dans les Evangiles, on trouve plein de mensonges et d exemples de l'ignorance des hommes qui ont vécu il Y d deux mi]]e ans. La religion est une sorte de magie, comme la croyance dans les fétiches chez nous. C'est la magie des Blancs. Les colonialistes l'ont toujours utilisée pour nous abrutir et nous soumettre.Lors de ces causeries, Mulele invite les assistants à apporter leur témoignage. L'un dira qu'à la mission Kilembe, le père Gérard, le supérieur, insultait les Noirs, il faisait donner la chicote même aux instituteurs. Abo se rappelle les plaintes de son frère aîné: enfant pendant la guerre, il a travaillé comme un esclave pour les prêtres qui l'obligeaient à faire le ndundu, le caoutchouc naturel. Un troisième raconte qu'à la mission Ngoso, le père Simon prétendait que les nègres étaient des singes et qu'ils avaient une mauvaise odeur. Son ami enchaîne qu'en 1959, à Ngoso, il a frappé le père Arthur lors d'une grève organisée par les élèves et les instituteurs. Le père Arthur chassait beaucoup de jeunes de l'école et il insultait les maîtres noirs.Léonie a chanté les messes dans la chorale de la mission de Totshi. A l'instigation de Bengila, elle chantera désormais des vérités plus terre à terre. Théo, avec son air doux et un peu rêveur, ne semble pas fait de la pâte des grands guerriers. De temps à autre, il prend Léonie et Monique par le bras pour une promenade champêtre. La culture, ça lui chanterait mieux comme terrain d'action que le champ de bataille proprement dit. Aussi donne-t-il des cours privés de bel canto aux deux beautés qui l'accompagnent.
- Toute la
jeunesse du Congo Après maintes répétitions en cachette, le trio Bengila se produit devant le rassemblement qui reprendra en force la mélodie.Pendant tout le mois de décembre, le camp vit un remue-ménage fiévreux. Chaque jour, des jeunes quittent le camp pour une destination inconnue. D'autres rentrent de missions secrètes. Ecoute tendue du message de libération, espoirs fous, rêves téméraires, silences chargés de menaces à l'approche de la tempête. Des partisans partent en mis-S1on, contacter un parent investi d'autorité et de pouvoir: chef de village, chef de secteur, commerçant, instituteur, chef de clan. Le mauvais gouvernement vend le pays aux étrangers, demain ses militaires peuvent venir te torturer et te tuer, toi aussi; Mulele veut que nous luttions ensemble pour libérer le Congo.Les jeunes qui ont acquis les rudiments de la formation politique et militaire retournent dans leur village. Avec l'accord du chef, ils y formeront une équipe de partisans qui construira son bivouac en brousse ou en forêt, un peu à l'écart des cases. De petits groupes rentrent à la direction, faire rapport à Mulele et Bengila. La dernière semaine de décembre, un grand nombre de chefs d'équipes se trouvent réunis chez Mulele. - Même les mains vides, je peux lutter avec les ennemis. Nous devons utiliser notre intelligence pour attaquer et arracher à l'ennemi tout ce dont nous avons besoin. Avec de simples produits chimiques, nous pouvons fabriquer nous-mêmes des explosifs. La tension monte. La décision est prise: nous attaquerons l'INEAC, l'Institut National pour l'Etude Agronomique du Congo Belge, à Kiyaka. Nous allons montrer que nous avons la force. Contents, enivrés même, les partisans s'impatientent de monter à l'attaque. Le saut dans l'inconnu. Théotime Ntsolo part avec les hommes, diriger l'opération. Ils lancent quelques cocktails molotov. Les enseignants présents à l'école de Kiyaka prennent la fuite. Abo voit les partisans rentrer au camp dans une atmosphère exubérante, chargés de boîtes de potasse et de soufre, portant en triomphe un émetteur radio et un petit moteur, étalant quantité de sel et de savon. Abo peut se constituer toute une pharmacie avec les antibiotiques, la streptomycine, la pénicilline, la sulfa-guanidine, le bleu de méthylène, le mercuro-chrome, le sel anglais, l'huile de ricin, les bistouris, le catgut, les pinces et les ciseaux. Minutieusement, tout le butin est consigné dans un cahier. Les jours qui suivent, par petits flots, du matériel de tout genre continue à affluer au camp. Abo en déduit que partout se mènent des opérations de faible envergure. Elil, Kambulu, Ntoma, Etshwe et Langong sont choisis pour une mission de confiance. Ils creusent un abri sur le flanc d'une haute colline, en direction de Maten-de. Ils en renforcent les parois intérieures avec des planches et de la tôle et construisent des étagères. Ils camouflent l'entrée avec des planches qu'ils couvrent de terre et d'herbe. Le dépôt est prêt. Abo aura besoin de la moitié de l'abri pour y ranger tous ses médicaments. Liévin Mitua et Del-phin Mbumpata gèrent le dépôt et personne ne peut rien enlever sans leur autorisation. Arrive François Mwangala, le fils d'Anosa, une sœur d'Abo. Il a huit ans, suit la troisième primaire à Lukamba Secteur. Mais que fais-tu ici, un petit enfant? - Je suis aussi ntot but o mput, partisan! Quelle histoire! Et comment es-tu devenu partisan? Raconte. Le jour de la rentrée, après les vacances de Noël, les militaires qui logent au gîte d'étape, au Secteur, rôdaient autour de nos classes. Le maître a dit: Ça ne va pas, les ntot but o mput arrivent, retournez tous à la maison. A Bozombo, les instituteurs Celestin Mboko et Louis Ikuma m'ont demandé ce qui se passait. J'ai répondu que des coups de feu avaient retenti au Secteur. La famille a commencé à creuser des fosses pour y mettre une valise avec tout ce que nous possédions, des assiettes, deux pagnes, un peu d'argent glissé dans des bouteilles et une poignée de sel. J'ai passé la nuit en brousse, avec maman. Le lendemain, le chef de village, Mbul Kasong, était arrêté par les militaires. Il est venu crier en brousse: - Venez! Sortez! Ce n'est rien. Si vous ne sortez pas, ils vont me tuer. Des garçons qui se cachaient dans la brousse prenaient de l'herbe dans la bouche et un peu de sable dans la main en disant. - La terre est à nous, A leurs yeux, les militaires de Mobutu étaient des étrangers, venus d'on ne sait quel pays. Mais nous sommes quand même rentrés au village. A côté de l'équipe des grands, on a formé une équipe d'enfants de huit à dix ans. Norbert Hennet nous dirige. Nous apprenons à courir, à faire de la gymnastique, à chanter la révolution et à faire le guetteur.Si les militaires nous attrapent et demandent: - Où se trouve Pierre Mulele? - Aïe ! Au camp de Buzimbila affluent de partout des villageois terrorisés. La voix cassée, ils font tous le même récit de sauvagerie et de sang. L'armée convoque tous les villageois à l'appel pour qu'ils assistent à quelques exercices et réjouissances militaires. Des soldats s'emparent d'un homme, lui pointent un poignard sous le nez, puis lui coupent les oreilles et le renvoient parmi les spectateurs, le sang couvrant ses joues et ses épaules. D'autres soldats accusent un jeune de s'être rendu chez Mulele. Au couteau, il lui tranchent l'index droit pour qu'il ne puisse plus tirer au poupou, le fusil de chasse artisanal. Des militaires renversent un homme par terre et lui tordent le bras contre un tronc d'arbre. Avec une machette ils sabrent l'avant-bras, deux, trois coups exécutés aux cris de la soldatesque, cris qui couvrent les hurlements rauques de la victime, quatre cinq coups, jusqu'à ce que dans un éclaboussement de sang, le bras tombe dans l'herbe. L'homme est renvoyé dans les rangs, le sang coulant du moignon.Puis arrive une rumeur concernant Honoré Kendita, fils de Benoît Mulele, demi-frère de Pierre. Né à Lukamba Iban-si, commerçant à Kikwit, il traversait la région pour amener des jeunes au maquis. Et le bruit se confirme: Honoré a été arrêté par les militaires et fusillé. Des gens de Kikwit qui attendaient le bac pour traverser la rivière ont assisté, impuissants, sans mot dire, à un autre drame. Clément Matalatala, marié à Ignace Abiel, était bien connu comme grand commerçant de la place. Oncle paternel de Pierre, les militaires lui ont mis la main dessus pour qu il leur montre où se cache Mulele :- C'est ton propre neveu, tu dois savoir. N'ayant jamais rencontré Mulele depuis son retour, Matalala ne peut rien dire. Pour le rendre plus loquace, les soldats le promènent en bateau sur la Kwilu. Tu sais naqer? Tu te rappelles maintenant où Mulele se planque? Les soldats nouent une corde autour du cou de Matalatala et l'attachent à un sac de ciment. Matalatala ne sait toujours rien. Juste en face du bac, devant les yeux de tous les passagers, les militaires poussent Matalatala, bien ficelé, lié au sac de ciment, par dessus bord.Un émissaire d'Awaka vient voir Abo: Chez nous, à Bozombo, les militaires viennent de fusiller l'enseignant Célestin Mboko. A Mungai, deux villageois, Mboko et Ekwamwangi, ont été enterrés vivants par les soldats. L'homme lance enfin une dernière nouvelle qui inflige un choc terrible à Abo. Cela s'est passé à Kimbanda où se trouve, près de la rivière Edzim, l'huilerie de monsieur Frank, celui qui, dans le temps, a versé, d'une cuillère argentée, des perles colorées dans les petites mains d'Abo. C'est près de sa huilerie que les militaires ont arrêté Gaspar Ngung. Devant les villageois ils l'ont enterré vivant. Les gens de Kimbanda affirment que Gaspar est sorti deux fois de la terre, avant que les soldats n'arrivent à le tuer. Gaspar Ngung, l'enfant de mon oncle Ebul, Gaspar qui est allé au village arranger mon mariage, c'est dans sa maison que j'ai rencontré Pierre et que la révolution a commencé... Mulele ne peut plus rester sans réaction devant les premiers accès de barbarie de ceux qu'on appellera plus tard les pacificateurs. Le 22 janvier, toutes les équipes entrent en action, détruisent les ponts et les bacs, creusent des pièges à éléphant dans les routes, attaquent les petites formations de militaires avec des flèches, des lances, des machettes. Après cette vaste opération, trois mitraillettes, capturées dans la région de Gungu, entrent à la direction ainsi que des Falls et des Mausers. Maintenant les élèves et les enseignants affluent au camp. Le vieux Albert de Matende Lufuku est accueilli au bivouac de Mulele par un éclat de rire:- Eh bien, Albert, tu me rejoins pour faire le maquis? " Non, quand même, répond le papa un peu gêné, je viens te laisser mon enfant, il a déjà fait deux ans de post-primaires,Le qarçon n'a que quinze ans, il pleure et Léonie lui apporte du foufou comme si la nourriture pouvait calmer la terrible douleur d'être jeté parmi les fauves en pleine brousse. C'est à peu près en ces termes que le jeune rebelle-mal-gré-lui voit sa rupture avec l'univers scolaire. Il se confie à Léonie.- Après les vacances de Noël, nous avons fait deux semaines de classes à Gungu. L'armée nous protégeait et la sécurité régnait jusqu'au jour où les prêtres nous ont renvoyés. La situation devient critique, disaient-ils. Que Mulele préparait la lutte en forêt, ça nous apparaissait être une de ces croyances superstitieuses de villageois. Mais une nuit, Fernand Awul, un garçon de mon village, s'est glissé dans notre case. Nous nous formons en forêt, dit-il; le soir, quelqu'un part en reconnaissance chez le chef de village, aujourd'hui c'est mon tour. A Matende Lufuku, les jeunes chômeurs se moquaient de nous, les étudiants. Vos diplômes, vous pourrez bientôt les enterrer, disaient les illettrés, Pierre est venu avec un nouveau système de vie, nous allons faire un nouveau monde. Le 22 janvier on ne parlait que des ponts et des routes détruits. Les militaires attrapaient tous les jeunes de Lufuku pour les ligoter à la commande. Ils nous laissaient en paix, nous les étudiants. Alors mon père a dit: L'armée reviendra sûrement te prendre pour faire le service militaire, il vaut mieux que tu passes au maquis. En une semaine, l'ancien étudiant de Lufuku découvre sa véritable vocation de révolutionnaire. Mulele lui donne un cahier, intitulé "Tactiques de la guerre de partisans", à traduire en kikongo. Le travail accompli, le jeune scribe reçoit les vifs compliments du commandant en chef. Du coup, épanoui, il prend de l'assurance comme s'il venait d'inventer lui-même ces fameuses tactiques de la guérilla. Co-politique et co-militaire. Abo entend ces mots pour la première fois à Banda. C'est quoi encore, ça? Il lui faudra du temps pour savoir. Il y a un rapport avec les gens qui donnent les leçons politiques. A Nkata, une poignée d'enseignants seulement, dont Pascal Mundelengolo et Uévm Mitua, pouvaient exposer les idées politiques à l'entendement des jeunes. Chômeurs et écoliers, précipités dans un monde absolument inconnu, voyaient tout changer avec consternation, vivant en brousse et en forêt, dormant en bivouac, se déplaçant la nuit, se préparant à la lutte et à la guerre pendant la journée. Ils mettaient tout leur cœur à suivre les leçons, mais en pigeaient fort peu. A Banda, fin février, début mars 1964, les enseignants arrivent en grand nombre. Pris dans l'enthousiasme général, ils découvrent que le peuple, jadis regardé de bien haut, est avide de lutte et de changement. Ils ont quelque peu tardé à rejoindre le mouvement, mais ils ont la compréhension facile et à les entendre bientôt exposer les principes de la guérilla, les jeunes leur trouvent un courage insoupçonné. Alors, le mot co-politique dévoile son secret. Le commissaire politique, c'est l'instituteur ou l'enseignant qui, habitué à donner cours, expose maintenant les leçons politiques de la révolution. Aux yeux des paysans, cette reconversion politique se fait de façon trop brutale. Ces gens étaient quand même des Pénépé. Tout individu instruit où riche qui collabore avec le mauvais gouvernement reçoit cette étiquette infamante de l'ancien Parti National du Progrès. Mulele se voit obligé de donner une causerie à ce propos.- Vous, les vieux et les jeunes qui n'êtes pas allés à l'école, vous souffrez le plus. C'est pourquoi vous avez décidé les premiers de venir au maquis. Maintenant, les enfants qui ont étudié, sont arrivés. Nous qui ne connaissons rien, nous pourrons désormais apprendre beaucoup. Les enseignants vont travailler avec nous et notre lutte avancera plus vite. Le mauvais gouvernement a ses intellectuels, mais ceux-là ne pensent pas à la population, tout ce qu'ils cherchent, c'est des belles maisons, une voiture et des femmes. Les bons intellectuels doivent se placer du côté de ceux qui ne connaissent rien. Maintenant que la révolution a aussi ses propres intellectuels, notre lutte progressera rapidement. Un enseignant vient saluer Léonie et dit qu'il est heureux de la voir en chair et en os. - Au début de la révolution, je me suis rendu dans l'équipe de mon village. L'instructeur m'a juré qu'il y avait une femme au maquis qui distribuait des médicaments grâce auxquels on comprenait toutes les leçons politiques, même les Plus compliquées. Peu importait ce que ça pouvait me router, décidé de voir cette femme avant de mourir.Aujourd'hui, mon vœu se réalise. Mais entretemps, mon meilleur ami a rejoint les militaires. Il vient de m'écrire: Là-bas, tu souffriras, tu ne mangeras que des rats, moi je suis tranquille et je vis bien à Kikwit. Mais moi qui te parle, j'écoute la population, j'entends son souhait que la révolution continue et réussisse. Si nous ne sommes plus menacés par les militaires et si nous ne devons plus payer des impôts, nous serons heureux.
Les soins du corps assurés, les villageois courent se nourrir l'esprit. Ils ne se sentiraient qu'à moitié guéris, s'ils n'avaient assisté à une leçon politique du camarade en chef. Abo se charge aussi du service de pharmacie. Chaque jour, quelques envoyés des équipes lui réclament des médicaments qu'elle va chercher au dépôt. Quotidiennement, elle remplit une fiche de contrôle avec les entrées, les sorties et l'état des stocks.
Mulele, Bengila et d'autres dirigeants qu Abo accomPa. ane se rendent dans le village Buzimbila pour observer les militaires qui sont en face, sur l'autre versant de la vallée à Yansi. Mulele est assis dans sa chaise longue sous un palmier de raphia, lorsqu'un premier obus éclate dans la brousse. Les militaires tirent au mortier en direction du vil-lage Buzimbila. Certains obus font un atterrissage en douce dans les hautes herbes et le sable: ils n'explosent pas. Mbumpata démontera le mécanisme pour en extraire le TNT. C'est ainsi, par un service air mail fort original, que l'armée envoie des explosifs aux maquisards.Pendant deux jours encore, il y des échanges de coups de feu entre les militaires qui progressent sur la route et les partisans qui les guettent, cachés dans les hautes herbes, sur tout le trajet. Des villageois, rayonnant de fierté, affirment que les militaires ont amené leurs morts et blessés en camion jusqu'à Lukamba. Six militaires seulement seraient arrivés en bon état à Nienkongo. Au claquement du premier coup de fusil, les hommes restés au camp ont tremblé et les filles ont pris la fuite. Mulele aura à causer sur la panique. - C'est la première fois que nous avons entendu les coups de fusil lors d'un véritable affrontement. Mais il y aura dans l'avenir des combats d'une tout autre ampleur. Nous avons besoin d'une morale révolutionnaire. Pour mériter la liberté, nous devons faire preuve de courage et lutter sans connaître la peur. Jadis, on disait que la femme était faiblarde. Maintenant, au maquis, les femmes doivent faire preuve du même courage que les hommes.Et le maquis a vu de nombreuses jeunes filles admirables de courage et de dévouement. A Banda, Abo rencontre Marie Mukulu, venue d'Eyene, dans le Nord. A l'époque. Ngwensungu y commandait. Cet ancien militaire avait remplacé Félix Mukulubundu, parti inopinément pour Brazzaville. Marie a treize ans. Le 3 janvier 1964, elle a débarqué dans l'équipe d'Eyene avec ses amies Eugénie Angabinaba et Geneviève Masolo. Ses premières impressions, elle les confiées au papier: "Mon admission dans l'équipe avait d'abord été difficile parce que mon poids était inférieur au poids exigé. Le commandant de l'équipe m'avait dit que j'étais encore une gosse de rien du tout et qu'avec un tel poids, ça ne valait pas la peine. Il m'a demandé de regaqner le village. J'avais commencé à pleurer et à regretter amèrement. Dans la suite, quand il a remarqué que j'avais l'amour du maquis, il a fini par m'accepter." Après sa formation à la direction, Marie Mukulu est renvoyée dans son village natal, Impasi Makanga où elle devient, à quatorze ans, instructrice militaire dans une équipe de cinquante partisans, dirigée par Robert Mpuni et Gérard Mukwasa.8. Début mars - fin avril 1964 A Banda Buzimbila - Table de matières L'organisation de la Direction générale à Banda Buzimbila. Le bataillon de Ntsolo. L'état-major général et ses bureaux civils. Leçons sur l'impérialisme. 30 juin 1964, la bataille de Kimpata Eku. La grossesse de Nelly.A Buzimbila, les partisans ont construit leurs bivouacs au hasard de leur arrivée et dans un admirable désordre. Seuls Mulele, Bengila et quelques autres dirigeants campent un peu en retrait. Une division s'est imposée de façon spontanée. Pascal Mundelengolo s'est réservé une aire pour recevoir les masses populaires. Il a innové en préparant une jeune fille, Mpits, à donner des leçons devant les villageoises, épatées, et leurs maris, tous étonnés, d'aucuns choqués mais ne laissant rien apparaître. Sur un autre terrain déblayé, Théodore Bengila et Liévin Mitua assurent les cours des partisans.Début mars, Abo voit surgir, dans un ciel sans tache, deux avions s'éloignant en direction de Matende. Quelques secondes plus tard, elle entend le crépitement des mitrailleuses lourdes. Le lendemain, on rapporte que des avions ont attaqué la mission de Matende Iwungu, présumée sous contrôle des partisans. Des enfants, jouant entre les cases, Y ont perdu la vie. La population est convaincue que le père Delhaze, le supérieur de la mission, se trouvait dans l'avion pour indiquer au pilote l'endroit à mitrailler.Le camp de Buzimbila pouvant être facilement détecté par les avions, Mulele se déplace en pleine nuit avec ses mille hommes pour prendre, vers le Nord, la direction d'In-kasambu. Il descend la pente jusqu'à deux cents mètres de la rivière Bitshil, face à Banda Papi. A cet endroit, l'herbe, exubérante, monte très haut et on y trouve beaucoup de grands palmiers. La direction restera trois mois et demi dans le camp Banda Buzimbila Deux.Un grand effort d'organisation transformera la direction de fond en comble. Elle se dote d'un staff général et Se divise en plusieurs grandes unités bien distinctes. Depuis le début, Mulele et Bengila ont dirigé ensemble toutes les activités du maquis. Un jour, Louis Kafungu, dans un mouvement impulsif, a érigé son bivouac près de celui de Mulele et de Bengila: désormais, la lutte militaire, c'est lui. Autour de ce noyau de trois, Laurentin Ngolo et Pascal Mundelengolo sont les éléments les plus en vue du staff qui regroupe les principaux dirigeants. Bernadette Kimbadi, une fille arrivée de Kilembe, de chez Fimbo, devient la secrétaire de Mulele, chargée des finances du maquis. Hors du camp proprement dit se trouve le bureau des masses populaires où Pascal Mundelengolo reçoit les villageois. Il donne des causeries politiques avec l'assistance de Louis Mayele et de Mpits. Pierre Mulele s'y rend souvent pour s'entretenir avec la population. Un jour, il conte l'histoire de Yetsh Abong. Les vieux s'amusent beaucoup en reprenant à pleins poumons la chanson des enfants: Bong nze naani e nze naani Puis Mulele explique que Yetsh Abong, le diable, n'est autre que l'armée de Mobutu. L'aîné qui a désobéi au père en se promenant dans la forêt représente le partisan indiscipliné. Il attire des ennuis sur la population. Quand on chante : Ongwi je inkat Au camp Banda Buzimbila Un, Mulele se concertait souvent avec Théotime Ntsolo, l'ancien instructeur militaire de 1A' mee Nationale Congolaise. Ntsolo assurait l'instruction d'une bonne trentaine de jeunes, ivres d'action et impatients de combattre. Ils constituaient le premier groupe de défense de la direction. Il y avait Kandondo de Lukamba Bantsamba et Alexandre Mbongopasi Côté na Côté de Mukulu, baga-reurs et batailleurs, fumeurs et voleurs, de ces garçons dont les mères murmurent: Ah, l'enfant est bandit! Mbongopasi porte pourtant un nom qui semble le prédestiner plutôt à être philosophe. Mbongopasi Côté na Côté donne en traduction autorisée: De Tous les Côtés, l'Argent est Difficile à Obtenir. Abo remarque également dans le groupe des guerriers Orner Bakanga, un homme tranquille et taciturne, originaire de Banda.Les équipes de village choisissent en leur sein les meilleurs combattants pour suivre une "formation de commando" à la direction. A Buzimbila Deux se retrouvent bientôt quelques centaines de jeunes, venus en stage militaire. Parmi eux un groupe de redoutables guerriers, recrutés dans la région de Kilembe par Eugène Mumvudi. Ensemble, ils constituent le Bataillon, commandé par Théotime Ntsolo. Pour insuffler un peu d'ordre administratif à ce monde bouillant, Mulele décide de mêler quelques intellectuels à tous ces gros bras. Ainsi, le bataillon se dote d'un état-major composé de plusieurs bureaux. D'abord, le bureau du commandant Ntsolo lui-même. On y trouve son ami Jean-Baptiste Ilunga que tout le monde appelle avec affection "le professeur". Il a fait des études à Kinshasa et obtenu une licence en éducation physique. Il veille sur la condition de tous les partisans, leur impose des excercices qui assurent la souplesse, la force et l'endurance. Ensuite, le bureau du camp, dit bureau de l'immigration parce qu'il assure, sous la direction d'Eugène Mumvudi, le contrôle de l'identité de tous ceux qui entrent. A midi, on peut remarquer quelques dizaines de personnes, assises autour de ce bureau, attendant la vérification de leur identité. Le lendemain, ils participeront pour la première fois au rassemblement général. Mumvudi assure aussi la garde du camp. Chaque jour, il communique le nouveau mot de passe. Il envoie des équipes de sentinelles sur tous les chemins pour prévenir à temps du moindre mouvement suspect. Un bureau de liaison maintient le contact entre le bataillon et les commissaires militaires qui opèrent sur le terrain, dans les sous-directions et les équipes de village. Enfin, il y a le bureau des renseignements, dirige par Gabriel Mudiasupu, qui centralise toutes les informations sur la présence et les mouvements des militaires. Au moment de la plus grande affluence, le bataillon compte jusqu'à mille deux cents hommes.
Les femmes reconstituent leurs pelotons et Abo commande toujours son groupe de quarante filles. Godelieve Madinga et Mpits défient les tabous: elles parlent d'une voix forte et assurée, devant tout le monde, hommes y compris. Or, d'après les traditions, la femme doit chuchoter ce qu'elle veut communiquer à l'oreille de son oncle, qui parlera en son nom. Godelieve Madinga et Mpits sont les premières filles à avoir bien assimilé les leçons. Elles lisent le texte devant l'assemblée et l'expliquent. Si elles commettent une erreur, Mulele ou Ngwensungu rectifient. A Buzimbila Deux, la direction comprend plus de deux cents jeunes filles. Six pelotons sont dirigés par Léonie Abo, Monique Ilo, Godelieve Madinga, Sidonie Mikaba, Mpits et Mwata. Un jour, au rassemblement, Ngwensungu annonce qu'il faut choisir une commandante pour diriger toutes les femmes. Qui se montre courageuse dans l'entraînement militaire? Qui a une voix forte pour imposer son autorité? Les hommes et les femmes discutent la question. On vote à main levée. La majorité est d'avis qu'Abo, comme première partisane, a fait preuve de courage et qu'elle doit devenir commandante. Et pourtant c'est Godelieve Madinga qui prendra la direction des femmes, poste où elle acquerra bientôt une autorité incontestée. Trop souvent, Abo doit s'affairer du matin jusqu'au soir dans le bureau de santé. C'est au camp Banda Buzimbila Deux, d'ailleurs, qu'elle opère son premier accouchement. Une femme mbala met au monde des jumeaux. La mère appelle sa petite fille Mulele-Léonie et son petit garçon, Mulele- Pierre.Un bureau de justice est situé tout près de la prison et dirigé par Théophile Bula-Bula, homme aimable et paisible qui sent faiblir ses genoux au premier coup de feu. Il est assisté par Lakandal et dispose de deux secrétaires, Vital Ipolo et son cousin Bantsongo. Au bataillon, les petits'délits des partisans au bataillon sont jugés par Ntsolo. Quand Kandondo et Mbongopasi, mal cotés en tant que fumeurs de chanvre avant leur entrée au maquis, sont surpris en flagrant délit de rechute, Ntsolo leur inflige une peine de prison. Après plusieurs séjours en prison, sincèrement repenti, Kandondo a pris goût à l'ambiance surréaliste qui règne au bagne-bivouac sous les arbres en pleine brousse. Jean Kamba, le directeur de la prison, le nomme gardien. Il arrive aussi que les villageois ne se sortent pas d'un conflit tordu, et viennent soumettre le cas à Pascal Mundelengolo. C'est lui qui tranchera alors, puisqu'il joint la qualité de juge coutumier à celle, plus moderne, de porte-parole de la révolution populaire. Assurer la nourriture de deux mille personnes en pleine brousse n'est pas une mince affaire. Une cuisine a été construite à quelques centaines de mètres en retrait du camp. Plusieurs dizaines de partisans s'y affairent chaque jour. Un immense hangar abrite les marmites, les ustensiles, les provisions de farine de manioc et de nourriture apportée par les villageois. Le premier chef coq est Ngungu qui, malade, sera remplacé par Donatien Nzoz. Après dix-sept heures, tous les pelotons cherchent leur bassin où les cuisiniers ont déposé leur repas. Des paniers en bois de palmier, indiquant le nom des dirigeants, contiennent la portion allouée à chaque responsable. L'émetteur radio est installé à une bonne distance du camp. L'abbé Lankwan dirige le bureau d'informations et de presse. Avec son équipe, il écoute les radios étrangères et en retient les informations les plus significatives. Le matin à six heures, avant les excercices, Abo écoute les nouvelles émises par La Voix de la Révolution. Elle suit aussi les informations de dix-sept heures.Chaque semaine, les partisans sont pris par la fièvre du samedi soir. Ils dansent sur des mélodies mbuun, chantées a capella. Ils composent les premiers éléments de l'épopée du maquis sur une musique populaire du célèbre chanteur Abong.
Abong viens prendre viens prendre A Buzimbila Deux, début mai, en pleine nuit, un coup de sifflet éveille tout le monde, les gros bras du bataillon comme les "bureaucrates" de l'état-major général. C'est l'alerte générale. Chacun connaît son rôle. Qui ramasse une marmite, qui un sac de manioc, qui un dossier. Rassemblement dans l'obscurité, sans un mot. Mulele et les autres dirigeants se mettent en route. Les partisans suivent à la file indienne selon un ordre convenu. Silence. On ne peut percevoir que le bruissement des vêtements. Bientôt on s'arrêtera: l'ordre en passe de bouche à oreille, tout au long de la colonne. L'aube se lève sur Imolo, près de Inka-sambu. On y passe la journée en brousse. A la tombée de la nuit, on rebrousse chemin vers Banda dans un silence solennel. Un mois plus tard, début juin, ce sont des coups de fusil qui font sauter chacun de sa couche. L'alerte est bien réelle cette fois-ci et le mouvement beaucoup moins coulant. Quand une mitraillette crache son chapelet, la panique atteint son comble. La pleine lune inonde le camp de mille angoisses. Vite en rang, on part sur la route pour Buzimbila, abandonnant marmites, dossiers et machines à écrire à leur triste sort. Puis on se disperse pour entrer dans la brousse qui mène vers Mulembe. A l'aube, un commandant vient prévenir les fuyards qu'ils ont participé à un excercice de nuit qui a complètement foiré. Certains en rient. D'autres piquent une colère. L'organisation du camp est maintenant au point mais la peur règne toujours dans les rangs. Le département de l'éducation aura à bosser pour bétonner la conscience révolutionnaire. Bengila donne une leçon politique en kikongo sur quelque chose dont presque personne ne soupçonne l'existence: l'impérialisme. - L'impérialisme est venu au Congo, mais il faut savoir que chez lui, il s'appelle d'abord le capitalisme. En Belgique aussi, il y a un petit nombre de personnes qui ont le pouvoir et qui commandent le gouvernement et l'armée. Ce petit nombre possède toutes les usines du pays, les machines et les outils avec lesquels le travail peut s'effectuer. Là-bas en Belgique, la terre manque, tu ne peux pas aller faire des champs pour avoir quelque chose à manger. Donc, si un patron ne te donne pas un petit travail, tu peux même mourir. Le travailleur est ainsi obligé à se vendre pour une faible somme d'argent, mais le patron l'oblige à bosser durement pendant de longues heures. De cette façon, tous les patrons ont gagné beaucoup d'argent. Tellement qu'ils ne savent plus quoi en faire en Belgique ou en Europe. Alors, cet argent des capitalistes, lorsqu'il vient ici au Congo, il devient l'impérialisme. Ces capitalistes ont pensé qu'au Congo, il y a encore beaucoup de richesses, des palmeraies, du cuivre, du diamant. Ils viennent nous prendre par la force pour que nous coupions des noix de palme, pour que nous creusions la terre pour en sortir le cuivre. Ils nous accordent un salaire de rien du tout et ils transportent toutes nos richesses chez eux. Ainsi, ils gagnent encore plus d'argent. Puis, avec les matières premières qu'ils ont volées chez nous, ils fabriquent du savon, des ustensiles et des machines qu'ils réexportent au Congo. Avec notre petit salaire, nous sommes obligés d'acheter ces produits et les capitalistes en profitent une fois de plus. Bref, l'impérialisme, c'est un voleur qui dévalise deux peuples, les travailleurs belges et le peuple congolais. Un autre jour, Bengila explique que le capitalisme ne va pas vivre éternellement. Tout a un début et une fin. Maintenant que le capitalisme exploite toute la planète, c'est le monde entier qui est entré en lutte contre lui. Dans le capitalisme, il y a le petit nombre qui possède tout et qui décide de tout. Il y a des classes, des riches et des pauvres, des oppresseurs et des opprimés. Sur la terre entière, les gens qui travaillent durement vont chasser le capitalisme et le remplacer par le socialisme. Dans le socialisme, il n'y a pas de classes, tous les gens ont les mêmes chances, peuvent faire des études et devenir dirigeants. Les usines ne sont plus pour la petite minorité mais pour le peuple. Les richesses produites servent à nourrir, vêtir et éduquer tout le monde pour qu'il n'y ait plus de maîtres et d'esclaves, plus de riches et de mendiants. Il faut aussi apprendre les noms des pays socialistes. La Chine, c'est le pays socialiste que le camarade en chef a visité. L'Union soviétique, le premier pays socialiste au monde. Il y a aussi l'Albanie. Où est-ce qu'elle se trouve encore, l'Albanie? Les dirigeants qui ont beaucoup lutté pour le socialisme, ce sont Marx et un autre, qui est son grand ami, Engel, peut-être. Les Chinois aiment beaucoup leur président Mao. Puis le camarade en chef parle parfois de Staline, mais est-ce qu'on peut se souvenir de tout ça? Khroutchev était contre Staline, il a voulu brûler son corps, mais les Chinois ont demandé qu'on leur donne sa dépouille, c'est bien ça? Staline a gagné la guerre contre les Allemands qui l'ont attaqué. Mais Khroutchev était mauvais. Les révolutionnaires étaient pour Staline. Nous nous intéressons à leur lutte, nous sommes sur la même voie, mais c'est un peu compliqué, quand même. Les militaires ont une garnison à Kimpata Eku d'où ils lancent des expéditions à la recherche de Mulele. Ils ignorent qu'il travaille à une dizaine de kilomètres à peine de leur repaire. La population de Kimpata Eku doit apporter chaque jour la nourriture à ses oppresseurs. Egnang Lamvul veut savoir où se trouvent les soldats. Combien sont-ils? Par où pourra-t-on le mieux les attaquer? Les villageois amènent, bribe par bribe, des renseignements dont Delphin Mbum-pata fait rapport au commandant en chef. Chaque nuit, les militaires de Kimpata tirent des coups de feu qui provoquent la panique chez les maquisards les moins téméraires. Chaque matin, Kafungu se moque des froussards qui ont mal dormi. Après avoir mijoté son plan, il se rend chez Mulele. - Nous allons attaquer Kimpata Eku. Je veux voir tous les dirigeants à mes côtés, toi et Bengila, vous resterez seuls au camp. A son départ, Maurice Zanga, en uniforme militaire, pistolet sur la hanche, mitraillette à l'épaule comme il se doit -n'est-il pas l'officier d'ordonnance du chef suprême, presque le numéro deux — s'énerve: - Qu'est-ce qu'il s'imagine bien être ici? - Ce petit groupe de militaires nous cause trop d'ennuis, répond Mulele, je crois que Louis a raison. Dans chaque équipe, on bat la mobilisation générale. Le camp de Banda est submergé par des centaines de jeunes arrivés de Kilembe, de Musenge Munene, d'Eyene, de Gun-gu. Le 29 juin, Kafungu convoque un rassemblement général au bataillon. - Depuis trop longtemps, nous dormons. Personne ne songe à chercher l'ennemi, mais c'est l'inverse qui se produit. Cette poignée de militaires à Kimpata Eku nous embête chaque nuit. Nous les attaquerons demain. Tous les dirigeants sans exception m'accompagneront, toi aussi, Zanga. Préparez vos hommes pour le départ à 19 heures. Vous connaissez maintenant la tactique de la guérilla. Ne pas craindre les balles, avancer sur l'ennemi pour le tuer, saisir ses armes. La conviction et la détermination donnent la victoire. Ngwensungu, le militaire, grommelle entre ses dents contre le militarisme, c'est trop tôt, ça va rater. Au rassemblement de 19 heures, Kafungu fait son apparition coiffé d'un chapeau orné de plumes blanches. Ce bonnet aux plumes de Mpung, le maître des oiseaux, le vainqueur, symbolise le pouvoir des chefs coutumiers. Mpung nwin onen, chante-t-on devant le tribunal, Mpung est le plus grand parmi les oiseaux. Le bonnet à plumes de Mpung frappe l'imagination. Tous les partisans ressentent un frisson, impressionnés qu'ils sont par la stature de leur chef militaire, Louis Kafungu. Ils sont convaincus que Louis possède des fétiches pour aller à la guerre. La confiance monte d'un cran. Avant le départ, Mulele prend la parole devant le plus grand rassemblement jamais vu au maquis. Mille partisans se mettent en route. L'après-midi, quelques filles avaient demandé à Ngwensungu d'accompagner l'expédition. - Sinon, pourquoi nous a-t-on donné un fusil calibre douze? Mulele a refusé. Ce n'est pas encore le moment. Il y en a encore qui ont peur, qui n'ont pas compris. Nous manquons de fusils. Dans la panique, les femmes pourraient jeter leurs armes. Les hommes seuls marcheront au combat. Certains sur des jambes tremblantes. Au point du jour, les partisans, groupés autour de Kafungu, avancent dans la brousse, sur la rive droite de la rivière Labue. Les militaires campent sur la rive gauche, à l'endroit où la route Kikwit-Idiofa traverse la Labue. Au moment où les partisans descendent la pente vers l'eau, un tir nourri les surprend. Ils se jettent au sol. Puis se redressent, avancent, tirent, crient. Quelques soldats, en embuscade sur la rive droite, exécutent une contre-attaque qui surprend les partisans. Deux jeunes sont blessés par balle. Une équipe les transporte jusqu'à Banda. Le bureau de santé d'Abo les soigne. Le premier a une blessure au mollet. Pas grave. Le deuxième a une balle dans l'intestin grêle. Ankawu l'opère sous anesthésie générale, enlève la balle, lui fait des sutures. Le groupe de Kafungu, fort de cinq cents hommes, le pauvre Maurice Zanga étant du nombre, attaque toute la journée. Une deuxième équipe de partisans avance à partir de Bêla Borna, une troisième de l'autre côté de la grande route, de Kimpata Eku. A la tombée de la nuit, les soldats prennent la fuite. Paralysés de peur, quelques-uns se sont cabrés sous le pont. Les partisans les y découvrent et les exécutent. Pendant les trois jours qui suivent, Kafungu tendra des embuscades sur les routes aux alentours. Chaque soir, quelques blessés légers arrivent à la direction. A faible distance du campement militaire abandonné, les partisans découvrent la tombe du sergent Mbulu. Inkutu, un garçon d'Imolo, en s'en approchant, saute sur une mine. Tous les regards sont fixés sur la tombe: que s'y cache-t-il? Delphin Mbumpata démine l'endroit, puis, en ouvrant la fosse, s'aperçoit que la chère dépouille de Mbulu s'est muée en une impressionnante quantité de caisses de grenades et d'obus. Abo accompagne les porteurs jusqu'au dépôt. Les caisses, empilées jusqu'à une hauteur d'un mètre vingt, couvrent une paroi de cinq mètres de long. Le butin comprend en outre cinquante uniformes militaires. Le quatrième jour, deux cents combattants font leur entrée triomphale au camp. En tête marche, bonnet de plumes de Mpung telle une auréole de gloire sur la tête, Louis Kafungu. Rassemblement général. Mulele parle. - C'est ça notre ligne. Il faut mettre en application ce que nous avons appris. Beaucoup d'entre nous n'ont pas la moindre expérience du combat. On apprend par la pratique. Nous avons maintenant un bon exemple de la manière de mener la lutte révolutionnaire. A dix-sept heures débutera la fête de la victoire. Tous y sont conviés. Sauf ceux qui n'ont rien à fêter pour être partis avant que n'aient commencé les choses sérieuses. Au moment de l'assaut final, certains ont eu les jambes coupées. Mais leurs pieds ont retrouvé toute leur vigueur une fois tournés dans la direction inverse. Kafungu a la lâcheté en horreur. Quand les soldats tirent, avait-il dit, jetez-vous par terre, rampez, puis, quand ça se calme, allez de l'avant. Ceux qui prennent la fuite, il les attend la crosse du fusil en l'air. Et en colère, il frappe à la tête. Très vite, des bruits courrent selon lesquels Kafungu aurait abattu des fuyards sur place. Jean-Pierre Idiabolo, Philibert Kiang, Remy Omper, Constant N'dom et quelques autres évolués que les chômeurs appellent les fils de monsieur l'abbé Lankwan', ont fui au combat. D'eux viennent les commentaires les plus malveillants à l'adresse de Kafungu. Demain, ils seront jugés. Ekwomo amène deux langung de sa fabrication, un instrument à corde unique, tendue sur un arc à laquelle une calebasse a été fixée. Vers dix-sept heures, Kafungu entame la danse. Pas un partisan ne restera à l'écart. La danse au rythme du langung ne s'éteindra qu'à l'approche de l'aube. Le lendemain, il faut tirer quelques conclusions. Bengila pardonne aux jeunes, ce sont des élèves, ils n'ont jamais entendu de près un coup de fusil. La prison suffit comme punition. Soit. Mais il y en a un à qui Kafungu ne pardonnera pas. Maurice Zanga a fui! - Celui-là? Un officier d'ordonnance? C'est un fugitif, mugit Kafungu. Puis à Mulele: - Si les ennemis arrivent, tu seras le premier à être abattu. Tu n'as plus besoin d'un tel officier d'ordonnance. Dès aujourd'hui, on te donnera une garde de cinq commandos. Fernand Mavula et quatre combattants, munis de Falls, se mettent en poste devant le bivouac du camarade en chef. Maurice Zanga passe en taule, sous un régime de préférence. En avril 1964, au camp de Banda Buzimbila, les filles se transmettent un secret: Charlotte Ntsamana est enceinte. En fait, elle l'était déjà lorsqu'elle est arrivée à la direction. Pour qu'elle ne se sente pas visée ni menacée, Mulele dit à Abo d'appeler toutes les filles en consultation. Charlotte a une grossesse de quatre mois et elle refuse de dénoncer l'artisan de son bonheur. Mulele dit de la renvoyer dans son village. Charlotte répond que, dans ce cas, elle se suicidera. Elle reste et dort désormais dans le bivouac de Mulele, à côté d'Abo. On décide d'organiser une consultation mensuelle pour les jeunes filles. On semble donc préparé à toutes les éventualités. Jusqu'au jour où une fille signale à Mulele que Nelly Angontoto, qui doit encore fêter ses quinze ans, sera bientôt mère. Mulele entre dans une de ses colères et convoque Abo: - Qu'est-ce que j'entends? Une toute petite fille comme ça? - Elle n'est pas venue à la consultation, on la croyait encore enfant. Point d'orgue de l'affaire: l'ange Gabriel n'est autre que Bengila! Mulele se retire, la tête entre les mains. L'affaire sera jugée par Mundelengolo, Bula-Bula, Kafungu, Ngwensungu et Zanga. On ne peut pas menacer les partisans des plus grands malheurs s'ils osent faire des désordres avec les filles et autoriser les dirigeants les plus haut placés à semer la zizanie. Bengila sera relégué dans son village jusqu'à la naissance de l'enfant. Tard dans la nuit, Mulele et Bengila sont assis devant le bivouac. Abo leur apporte une calebasse de vin de palme et elle entend Mulele dire: - Tu vois tout ce monde-là sur notre tête? Mukulubundu a disparu. Toi, tu iras au village et moi, je resterai seul avec tout ce monde sur le dos. Nous avons dit aux partisans de ne pas faire cela. Je ne peux pas prendre une autre décision. Tu iras au village avec elle, et après l'accouchement, tu reviendras. Mais quand même, une toute petite fille comme Nelly... - Il n'y a plus rien à faire. Je dois partir. Et si l'ennemi ne m'attrape pas, je reviendrai. Une petite équipe accompagne Bengila et Nelly jusqu'au village Luem. Parmi eux, Mbongopasi, Barthélémy Ilo et Rombo, le neveu de Bengila. Rombo dira plus tard que des villageois d'Imbongo ont conseillé à Bengila de faire une autre révolution, de se détacher de Pierre à cause de l'humiliation subie. Bengila n'a jamais fait le moindre commentaire sur sa punition. Dès son arrivée dans la région d'Imbongo, il y a pris en main la direction de la révolution. 9. Fin avril - fin décembre 1964, A Ndanda, Nkata et Kikwit - Table de matières Bengila, relégué au village, Kafungu, chef de Vétat-major général Abo devant le tribunal du maquis. Un vieux chef révolutionnaire et un chef coutumier réactionnaire. La bataille de Kikwit et ses suites. Les jeunes filles parfont leur éducation.Dans l'insouciance d'un après-midi au soleil adouci, cinq cents partisans, disposés en colonne, traversent l'eau peu profonde de la rivière Bitshil, longent le village Banda Papi et débouchent dans une savane ondulée à laquelle de grands arbres verdoyants donnent un aspect d'abondance et de paix. Lorsque la fraîcheur crépusculaire glisse sur les herbes jaunâtres, Mulele, Léonie Abo, Monique Ilo et Delphin Mbumpata partent en promenade vers une maison solitaire, non loin d'Inkasambu. C'est la case de Louis Nienkongo, le chasseur aux bras d'acier. Pour ses hôtes, Louis commande à sa femme une grillade de la meilleure viande de brousse. Le lendemain, au passage des maquisards, un autre chasseur vivant en ermite à l'écart du village de Gomena, Paul Nzanza, quitte sa maison pour saluer les partisans. Charlotte Mumputu, sa femme, se tient à ses côtés. Elle est tout heureuse de pouvoir servir à sa petite sœur, Léonie, du foufou, de la viande de brousse fumée et des feuilles d'oseille. Charlotte se dit triste avec cette histoire de guerre. Nous ne te voyons plus, toute la famille est éparpillée, quand nous retrouverons-nous tous ensemble? Elle regarde Léonie avec de grands yeux noirs à l'éclat mat de la tristesse. Une question effleure l'esprit d'Abo: pourquoi ce regard affligé? Et au moment même où Abo s'apprête à la prononcer, elle a le pressentiment que ce visage mélancolique sera la derniere image que lui laissera sa sœur.La colonne vire vers le Sud. Pendant quatre jours, le lac Ndanda dorlote les partisans qui, dans l'eau rafraîchissante, en arrivent presqu'à oublier les feux jumelés du soleil et de la guerre. Dans ce cadre idyllique, les femmes, tiraillées entre deux mondes, vivront un petit drame. Six villageois de Ndanda font une entrée spectaculaire au camp, portant à bout de bras un énorme crocodile. La joie est immense, mais uniquement masculine. Les femmes ne peuvent pas manger de crocodile. Alors, Mulele annonce que cette viande exquise sera équitablement partagée entre les hommes et les femmes. Les filles boudent, un œil noir fixé sur les casseroles. Léonie et Monique éclatent en pleurs. Que vous êtes bêtes d'écouter les hommes, dit Mulele, ils gardent les meilleurs morceaux de viande pour eux. Du bout des dents, quelques filles tâteront du croco. Quand le camarade en chef s'écarte un instant, Abo et Ilo font semblant-de manger. Ainsi, elles échapperont à l'épreuve du crocodile, plus redoutable que celle du feu. Le troisième jour, Louis Nienkongo, le chasseur aux poings redoutables, l'homme capable de soulever une antilope, arrive au camp, ses bras, impuissants, le long du corps. Paralysés. Après le passage de Mulele, les militaires sont venus l'interroger. A coups de crosse, ils lui ont cassé les bras. A grand-peine, Louis soulève les objets avec ses coudes. Le lendemain, le chef du village Ndanda offre une splen-dide peau de léopard à Mulele qui étale la fourrure lisse et douce devant son lit. Mulele, en embellissant ainsi son bivouac, tend un piège à sa femme. Le soir, il observe Abo de ses grands yeux pétillants. Le léopard est le totem des Mbwitsambele. Il ne faut pas le manger ni toucher sa peau. Abo se raidit. Elle se rappelle les objurgations de Mabiungu. La maladie frappera ceux qui désobéiront. Hésitante, Abo foule du pied la fourrure interdite. Les maquisards quittent Ndanda et sa faune succulente pour établir leur bivouac à Ebuts Lankat, au sommet d'une colline, dans une grande clairière cachée par une forêt dense. Ils y construisent une tour de six mètres, d'où ils peuvent apercevoir la cité de Kikwit et la mission du Sacré-Cœur. Ntoma, souffrant au ventre, se présente chez les infirmiers. Ankawu l'opère d'une hernie. Après dix jours de calme, les gardes postés en direction de Kikongo surprennent un groupe de militaires. Ceux-ci tirent à la mitraillette et font donner leurs mortiers. Abo, ses sacs dans les mains, son fusil calibre douze sur l'épaule, se sauve parmi des centaines de partisans qui fuient sur la route menant à Nkata. Dans le dos, on entend exploser les obus. Si les militaires arrivent au camp et montent sur la tour, ils nous verront courir et ils pourront ajuster le tir. Les partisans retournent au camp Nkata, dans la vallée aux versants couverts d'une forêt épaisse, à l'endroit où Mulele a séjourné en 1963. Au premier rassemblement à Nkata, Louis Kafungu va droit au but: - Nous nous sommes déplacés jusqu'ici pour préparer la guerre de Kikwit. La bataille sera rude, l'enjeu de taille, il faut être prêt au sacrifice. Moi, je commande désormais l'état-major général. Un frisson parcourt les rangs. On entend des voix: - Où est Théo? - Quel Théo? Dirige-t-il la révolution? Le chef de la révolution est Pierre. Théo a été renvoyé pour avoir donné le mauvais exemple à tous. Il a engrossé une petite fille. Les rumeurs se confirment donc. On jasait depuis quelques semaines sur Théo et Nelly. Sûr qu'elle est mignonne, gentille, encore un peu trop frêle quand-même... Kafungu tire brutalement chacun de sa rêvasserie. - Moi, je ne suis pas Théo. Je vous apprendrai l'esprit de lutte et de sacrifice. La révolution est un combat sérieux qui nécessite une discipline de fer. Dès aujourd'hui, je vous imposerai la discipline. On décidera d'emblée qui ira à la guerre de Kikwit. Et Kafungu enjoint à son secrétaire, Placide Buambisi, de le suivre et de prendre note. - Tous les chefs de peloton, vous êtes mobilisés pour ce combat. Ngwensungu, vous les dirigerez. Se tournant vers les rangs des intellectuels: - Vous ne faites que dormir. Vous vous croyez toujours à l'époque coloniale. Vous écrivez. Vous n'arrêtez pas d'écrire, mais à la première alerte, vous paniquez au point de perdre tous vos papiers et vos notes! Toi, Constant N'dom, tu iras mourir à Kikwit. Le rassemblement terminé, les commentaires vont bon train. Les élèves ont un faible pour Théo. Le doux Théo a toujours fait montre d'une-, grande amabilité pour tout le monde, avec un petit extra pour les jeunes filles. Les élèves l'appellent affectueusement le grand amoureux. Ces apprentis maquisards récemment échappés de l'école sentent toujours plus l'encre que la poudre du poupou. D'une belle unanimité, ils aiment Bengila parce que, lui aussi, est plus porté sur la plume que sur le fusil. Lors de son stage en Chine, Théo a bien assimilé les principes de la guérilla, il les expose avec un art didactique consommé, mais c'est trop lui demander que de les mettre en pratique sur le champ de bataille. Une coalition se forme entre des amoureux inavoués, des séminaristes et des élèves, dont quelques renégats en herbe. On murmure que Théo, le doux Théo, Théo le grand amoureux, a déjà été exécuté. Des rumeurs insistantes veulent que le Flamand Kafungu ait l'intention d'envoyer tous les intellectuels en première ligne, au devant d'une mort certaine. Les premiers à avoir fui, lors de la bataille de Kimpata Eku, dénoncent le plus âprement ces projets meurtriers. Vingt ans plus tard, lorsque l'assassinat de Kafungu par les militaires ne sera plus qu'un lointain souvenir, Constant N'dom, dans un petit écrit hâtif, se vengera de son propre manque de courage. "Esprit obtus, pérorera-t-il, Kafungu est incapable de comprendre que deux plus deux équivaut à un plus trois. Kafungu nourrissait une haine obsessionnelle à l'égard des intellectuels. Saisi de démence, à Kimpata Eku, il tirait sur ceux qui hésitaient d'avancer. Kafungu a fait fusiller des centaines de personnes innocentes." Mais nous sommes toujours en 1964, et même si l'on trouve à Nkata, parmi les élèves, quelques fatigués avant l'âge, ruminant déjà le repentir de leurs péchés révolutionnaires, la grande majorité s'est attachée, de cœur et d'esprit, à cette lutte de libération à laquelle elle comprend encore si peu. Et Théo Bengila a accompli le tour de force d'être l'idole tant des fidèles que des fugitifs. Les intellectuels prêts aux sacrifices qu'exige la lutte, eux aussi, aiment Théo, plus pour la solidité de ses convictions et sa fidélité à toute épreuve que pour son sourire séducteur et son caractère paisible. Ces intellectuels souhaitent que Théo laisse tranquillement sa toute jeune épouse chez sa mère et revienne promptement au camp. A Nkata, le souvenir de Théo revient dans tous les esprits lorsque s'ouvre une affaire judiciaire des plus pénibles. Un tribunal jugera la complaisance du département de la santé dans la liaison illicite entre Nelly et Théo, suivie des conséquences que l'on sait. La plupart des dirigeants sont convaincus qu'Abo et Wavula, du service sanitaire et Monique Ilo, la meilleure amie de Nelly, ont caché cette affaire à dessein. Ils ont contrevenu aux ordres stricts. Il faut respecter la discipline, même si un dirigeant supérieur est en cause. Le jury, présidé par Pascal Mundelengolo qui procédera à l'interrogatoire, appelle les trois, un par un, dans le bivouac. Le verdict: les trois seront mis à la commande pour les forcer à révéler la vérité. L'obscurité enveloppe le bivouac de Mulele, lorsque Kan-dondo ligote à la commande, avec tout l'art du métier, les trois présumés coupables. Il attache pieds et mains ensemble, derrière le dos, de sorte que le corps forme un arc tendu. Déposés devant le bivouac de Mulele, les suppliciés ne touchent le sol que de la poitrine et d'une partie du ventre. La douleur est affreuse. Abo ne tient plus. - Je vais mourir. Elle pleure et ses deux compagnons d'infortune pleurent avec elle. Les trois se lamentent et demandent grâce. Leur mains et leurs pieds gonflent de sang. - Ma mère est morte, mon père est mort, je vais mourir. - Oui, et moi je vais t'enterrer. Assis, Mulele attend la confession. Les larmes s'épuisent, les plaintes se meurent. Abo n'a plus la force de crier, de pleurer ou de prononcer même un seul mot. Après une heure, Mulele aide Kandondo à dénouer les cordes. Voyant de près les mains affreusement gonflées de sa femme, il dit: - Il a serré trop fort. Cet enfant est mauvais. Il cherche une bassine d'eau chaude et un chiffon et trempe les mains et les pieds de Léonie. Il n'y a pas eu d'aveu. Il n'y avait rien à avouer. Pendant plusieurs jours, Abo, Ilo et Wavula auront les mains insensibles, à moitié paralysées, sans la moindre force. Ils ne peuvent rien tenir à la main. Il leur est difficile de porter leur nourriture à la bouche. Ils boitent et n'arrivent pas à marcher plus de dix mètres. Six mois plus tard, à son retour, Bengila protestera auprès de Mulele: - Pourquoi as-tu fait ligoter notre première partisane? Nous avions discuté l'affaire ensemble. - Je ne pouvais pas faire autrement. Des dirigeants ont protesté, ils disaient que Léonie, la responsable des femmes, avait certainement dû être au courant. Un homme de Lukamba Bozombo arrive à Nkata. Il veut parler à Léonie. Ses yeux fuyants, les mouvements gênés de ses mains, son long préambule de banalités annoncent un grand malheur. - Tu sais, dit-il enfin, que les militaires avaient fait un grand dépôt de villageois à Kimpata Eku. - Oui, j'ai entendu parler de ce camp de concentration. - Eh bien, le frère de Mabiungu, Boniface Enkul, y a été déporté avec toute sa famille. Un indicateur a averti les soldats qu'Enkul était l'oncle de la femme de Mulele. Boni-face, sa femme Marie Ambwusil et leurs deux filles Aney et Albertine ont été massacrés à Kimpata Eku. Pierre Mudinda, vieux chef pende d'Indele, essaie de consoler Léonie. Lui, il a vécu, il y a longtemps, en 1931, les carnages de la Force Publique à Kilamba. A l'époque aussi, les Belges avaient rassemblé des milliers de villageois rebelles dans un camp de concentration à Kakobola. Et le vieux Mudinda reprend l'histoire qu'il a déjà répétée tant de fois le soir autour du feu. La jeune génération, dit-on, doit continuer l'œuvre des ancêtres. Savoir que la lutte d'aujourd'hui ressemble comme deux gouttes d'eau au combat des ancêtres, vous donne un étrange sentiment de consolation et d'obstination. En 1931 donc, la situation dans toute la région du Kwilu-Kwango était devenue terrible. Pour les noix de palme, nous ne recevions que le quart de l'ancien prix et le Blanc n'achetait plus le caoutchouc. Mais les impôts augmentaient d'année en année, nous n'avions plus rien. Les Blancs prenaient les jeunes gens de force pour les obliger à couper les noix de palme. Certains de nos frères, les chefs médaillés, les capitas et les policiers, accompagnaient toujours le Blanc lorsqu'il venait collecter l'impôt. A cette époque, beaucoup de femmes recevaient la visite des esprits pendant leur sommeil. Ainsi, elles apprenaient que les ancêtres reviendraient pour nous libérer des Blancs. Qu'il fallait cesser d'obéir aux capitas et aux catéchistes, ne plus travailler pour les Blancs et ne plus leur payer des impôts, chasser les étrangers et détruire les objets des Blancs. Dans des sombolos, de longs hangars construits spécialement pour eux, les ancêtres apporteraient beaucoup de richesses pour que nous vivions heureux. Le Mouvement du Serpent, qui annonçait l'arrivée des ancêtres libérateurs, venait de chez les Bambunda. Les Bapende avaient des Tupelepele, des 'Choses légères qui planent dans l'air.' C'étaient des visionnaires qui communiquaient avec les ancêtres. A Kisenzele, le Blanc est venu avec des chefs médaillés et il a tué beaucoup d'hommes et de femmes. Alors un guerrier très fort et très beau s'est levé. C'était Matemu que nous appelions déjà Mundele Funji, le Blanc qui est comme le vent. Un Belge lui avait pris sa femme Gafutshi pour coucher avec elle. Lorsque Matemu a osé protester, le Belge l'a chicoté. Peu après, un agent territorial est venu lever l'impôt, accompagné par le chef Mbundu a Gamoni, de la chefferie Yongo, grand ami des Blancs et détesté par tous les villageois. Quand le Blanc arriva à Kilamba pour réclamer l'impôt, Mundele Funji lui fendit le crâne d'un coup de machette. Nous avons coupé le Blanc en morceaux pour en faire des fétiches et pour nous emparer ainsi de sa force. Tout le monde a compris que, grâce à ces fétiches, nous étions désormais plus fort que les Blancs. Partout, les gens ont commencé à ne plus obéir aux Belges. Ils détruisaient leurs papiers d'identité, leurs feuilles d'impôt, leurs contrats de travail et même leurs billets de banque. Le mouvement se répartit dans toute la région. Alors l'armée arriva et massacra des milliers de villageois. Au camp de concentration de Kakobola, on les enterrait vifs, les grillait sur des feux, les chicotait à mort ou les massacrait à la machette. Le chef Musoso Shagingungu de Bangi-Mwenga fut enterré vivant. Le chef Mwata Muhega de Kasandji grillé à petit feu. Le chef Gandanda-Gibanda de Musanga assassiné après avoir été émasculé. Donc, vous le voyez, c'est toujours la même oppression et la même lutte. Mais Kilamba, en 1931 l'épicentre de la résistance nationale et le théâtre des pires excès de la Force Publique, accueille aujourd'hui à bras ouverts les successeurs de l'armée coloniale, la Force de Pacification. Mulangi a Gapumba est le chef de groupement de Kilamba, le grand sorcier qui détient le pouvoir ancestral et qui possède les fétiches les plus puissants. Devant lui, même des administrateurs territoriaux pende se mettent à trembler. De son autorité protectrice, Mulangi couvre les militaires qui se sont arrêtés dans son village. Un jour, Mulele dit: - Ce vieux-là fait trop souffrir la population. Je veux le voir demain devant moi. La nuit, des partisans pende, dirigés par Kahanga, conduisent une équipe de trente combattants jusqu'à l'enclos de Mulangi. Entourée d'une clôture de bois, une cour énorme abrite la belle demeure du chef Mulangi, les vingt cases de ses vingt femmes et le gisendu, la petite maison où le chef honore l'élue de la nuit. Sans faire le moindre bruit, les hommes franchissent l'enceinte et se glissent entre les cases. Un moment d'hésitation chez les guides pende : Mulangi dort-il dans sa demeure ou dans le gisendu, la case des ébats amoureux que les Bambunda appellent le mpinl Connaissant leur type, ils parient sur le mpin. Ni Mulangi, ni sa belle de nuit n'auront la possibilité d'émettre le moindre son avant de se voir ligotés, les yeux bandés. A quatre heures du matin, le prisonnier est déjà loin de Kilamba, lorsque les partisans tirent quelques coups de fusils. Jusqu'à l'aube les militaires enverront un déluge de balles dans le feuillage. Alors ils remarquent que celui qui est l'objet de leur protection rapprochée s'est envolé. - Chef Mulangi, est-ce que tu me connais? Mulele accueille le prisonnier par une question qui n'a pas de réponse. - Pierre Mulele, c'est moi. Pourquoi t'opposes-tu à la révolution? Mulangi lorgne à droite et à gauche: comment sortir de ce traquenard? - Nous allons voir qui a le plus de fétiches. Une ombre d'inquiétude passe sur le visage du chef. - Moi, je suis venu pour sauver notre terre. Toi, tu la pourris. Tu envoies les militaires pour persécuter la population. - Papa, répond Mulangi avec humilité, nous avons été influencés. - Chef Mulangi, tu vas rester avec nous et faire la révolution avec nous. A ce moment, Kafungu ne tient plus, il sort du bivouac. Où irons-nous, s'ils vont prendre des gens pareils qui nous font tellement souffrir... La palabre entre Mulele et Mulangi dure toute la journée. Vers la soirée, Léonie aperçoit Mulangi à l'autre côté du camp, assis, les mains liés, dans la prison. Le lendemain, une équipe creuse un trou profond dans la terre. Mulangi est géant et costaud. Un groupe de jeunes filles est chargé de son exécution. Avant de mettre Mulangi à mort, les filles pende prononcent des mizo, les filles mbuun des odzo, formules de conjuration qui donnent à la mort son sens profond. - Tu as été contre la révolution, maintenant tu meurs pour la révolution. - Tu n'as pas eu pitié de nous, tu as bien mérité la mort. Lorsque la nouvelle de l'exécution de Mulangi leur parvient, les militaires prennent la fuite de Kilamba vers Gungu. Au mois d'août, des combattants arrivent de toutes les sous-directions pour se préparer à la bataille de Kikwit. Ils suivent les cours de tactique au bataillon. Godelieve Madinga, Eugène Mumvudi, Louis Kafungu donnent des leçons politiques pour raffermir leur morale révolutionnaire. L'enthousiasme monte au point que beaucoup se voient déjà installés définitivement à Kikwit. Kafungu pense qu'on pourrait y établir une compagnie de combattants pour repousser d'éventuelles attaques de l'armée. Mulele et Bengila préfèrent rester au maquis pendant une longue période. Il faut bien consolider les bases de la révolution dans les villages, avant d'occuper des villes importantes. Lors de l'attaque de Kikwit, on s'emparera de médicaments, d'appareils techniques et de produits chimiques. Il faudra convaincre les habitants de rejoindre le maquis et d'abandonner les militaires seuls à leur frayeur. On coupera les routes pour qu'ils ne se sentent jamais en sécurité. Finalement, deux à trois mille partisans montent à l'assaut de Kikwit en trois groupes distincts. Kafungu commande le premier qui prendra le centre de Kikwit. Un deuxième se dirige vers la Régie des Eaux, face à la mission du Sacré-Cœur. Le dernier groupe, mené par Philippe Kahanga, doit attaquer l'aéroport. Kahanga, un Mupende géant issu de la région de Mokoso, a fait l'armée. On n'a pas voulu lui confier le commandement d'une zone parce qu'il a fait l'objet de plaintes de la part des villageois. Il a été dégradé et mis en prison pour vol au détriment tant des villageois que des partisans. Après qu'il eût été mis à la commande, Mulele l'a appelé: - On vous a ligoté durement, ça vous fera du bien. Un révolutionnaire ne peut pas être voleur. Mais à ceux qui demandaient qu'on le remette en prison parce qu'il ne se corrigeait pas, Mulele répondait: - Nous avons besoin de tout le monde. Même un voleur peut nous sauver en volant un fusil. Kahanga est courageux au combat. Il faut l'éduquer par les leçons politiques. A Kikwit, les partisans subissent un cuisant échec. Le groupe de Kafungu arrive bien jusqu'au marché de Kikwit, mais ceux qui attaquent la Régie des Eaux et l'aéroport sont reçus par les tirs nourris des militaires, apparemment au courant de l'imminence de l'attaque. Kafungu dira par après: - Nous avons été trahis, l'ennemi connaissait nos plans, il avait préparé des contre-attaques aux endroits les plus sensibles. Beaucoup de partisans en déroute sont poursuivis par les soldats jusqu'à Kikongo, à 16 kilomètres de Kikwit. Prenant d'assaut les pirogues, se jetant à l'eau, plusieurs périssent par noyade. Quelques dizaines d'entre eux arrivent au camp avec une balle dans le corps. Ankawu a installé une "salle d'opération" en plein air où il s'affaire. Sur la rive droite de la Kwilu, des villageois ayant les militaires devant eux et les partisans dans le dos se mettent à fuir vers le camp disposant de la plus grande puissance de feu. Pour stopper ce mouvement, la direction se déplace vers Kikongo, dans la forêt entre Lowanga et Nkata Mulun-çju. On y reste trois semaines avant d'être repoussés par les militaires. Retour au camp Nkata. Passant par la prison, un soir de novembre, Abo y remarque, les bras croisés sur les genoux, le commandant Pierre-Damien Kandaka dont elle a souvent entendu louer les exploits militaires, comme cela a été le cas, récemment encore, après l'opération Kikwit. Elle apprend que Kandaka aurait constitué des dépôts clandestins dans sa zone de Kondo-Kandale. Craignant les vols et les pillages, Mulele et Bengila ont ordonné dès les premiers jours du maquis de ramener toute prise de guerre à la direction. Tout y est comptabilisé et enregistré, puis réparti, selon les besoins, sur l'ensemble du territoire libéré. Or, des partisans de la région de Kondo étaient venus rapporter au chef de l'état-major que Kandaka cachait du butin dans des dépôts personnels. Appelé par Kafungu à rendre des compte, Kandaka s'est retrouvé finalement pour quelques semaines en prison. Au moment de la détention de Kandaka, un autre chef de la région de Kilembe se fait conduire au camp central par un commando de la direction. Il s'agit de Gingombe, un ancien militaire qui a rejoint le maquis dans son village Muzombo. Après avoir participé à l'attaque de Kikwit, une fort mauvaise surprise l'attendait à son retour à Kilembe. Pendant qu'il risquait de perdre sa vie au champ d'honneur, son épouse bien-aimée avait perdu son honneur au lit d'un autre. Suprême injure. Gingombe a enterré vivant Mugon-go, le coupable. De ce forfait, Gingombe doit s'expliquer devant Mulele. Mais il préfère se taire. Mulele et lui se connaissent trop bien. - Tu te souviens du 13 janvier 1960 au camp Thijsville, commence Mulele. Nous aurions pu libérer Patrice Lumum-ba. Mais toi, tu es allé trahir nos plans. Mobutu, ce bandit, m'a donné un coup de crosse et j'ai eu une côte droite fracturée. Et maintenant, tu veux recommencer? Julien, un Mupende de Lozo Munene qui travaille au bureau du protocole, dira plus tard à Léonie: - Avec deux autres camarades, je suis allé visiter Gingombe en prison. Vous ne pouvez pas badiner avec la révolution, nous a-t-il dit. J'étais un homme fort, je montais au front sans crainte, mais maintenant, au moment où je vous parle, je suis déjà mort. Quand vous êtes ici, vous devez suivre les instructions et ne pas en faire à votre tête. Entre-temps, par petites touches, les jeunes filles du maquis continuent à parfaire leur éducation, décidées à atteindre l'égalité avec les hommes. - La société néo-coloniale ne connaît pas de pitié pour les opprimés, qu'ils soient hommes ou femmes, aime dire Mule-le. Les femmes ont le cœur trop tendre, elle doivent apprendre à s'endurcir. La peur disparaît à mesure que les tabous sautent. Une partisane a touché la peau de son totem. Une autre a dégusté un morceau de croco. Une troisième, debout, a donné une leçon devant des hommes. Une équipe de filles a eu le courage de mettre à mort un traître, chef coutumier redouté de surcroît. Les partisanes les plus hardies aspirent maintenant à l'égalité avec les hommes au cours des combats. Ngwensungu les réunit dans la forêt de Nkata pour commencer un entraînement intensif de tir à l'arc. A Banda Buzimbila Deux, une poignée de filles avaient déjà décoché quelques flèches qui, après un court vol hésitant, avaient été se planter au hasard. Maintenant, on s'y met sérieusement. Si, au village, tous les garçons apprennent cet art en vue de la chasse, jamais une fille ne s'y mêle. Une exception: la petite Engwun, fille du juge Mwatsj Abuun, avait une réputation de légende à Lukamba Bozombo parce que, baguenaudant toujours avec les garçons, elle arrivait à abattre des oiseaux à l'arc. Mais ce militantisme plus pugnace n'empêche pas les jeunes filles de garder un œil attendri sur la chronique de la vie familiale au camp. Toutes, elles se pressent autour de Charlotte Ntsamana, qui vient d'accoucher d'un garçon. Charlotte gardera son enfant près d'elle au maquis. La présence du bébé rend plus perceptible l'aspiration de toutes les jeunes femmes à une vie familiale normale. Le bébé de Charlotte s'appellera Mulele. Théo Bengila, accompagné de son cousin Rombo, fait une rentrée discrète à Nkata. Il est devenu l'heureux père d'une adorable petite fille qu'il a laissée au village, aux soins de Nelly. Fraîchement revenu de sa mésaventure sentimentale et de son exil, Théo sera le premier à secouer la tête devant les complications familiales que son ami Pierre se crée. A Kinshasa, pendant les années cinquante, Mulele a animé deux associations d'entraide et de détente qui ont connu un franc succès auprès de nombreuses jeunes femmes de la capitale. On pourrait dire que Mulele était, dans le contexte plutôt sévère et provincialiste de la colonie belge, un ambianceur avant la lettre. Si ma femme a une belle amie, disait-il parfois sur un ton moqueur, qu'elle fasse bien attention. Et comme sa femme était presque toujours flanquée de Monique Ilo, Mulele eut tout loisir d'apprécier la beauté de la jeune fille d'Inkasam-bu. Mulele choisit une réunion de dirigeants, une nuit autour du feu, fin décembre 1964, pour annoncer quelques réaménagements de sa vie privée. - Je vais prendre Monique comme deuxième épouse, annonce-t-il laconiquement. Je parle pour que tout le monde l'entende, parce que je n'aime pas faire des choses en cachette. Abo n'a pas eu à donner son avis, au moment où Mulele l'a épousée. Son mari ne lui demande pas non plus son opinion, maintenant qu'il prend une deuxième femme. Abo se fâche d'une colère impuissante. Elle aime son mari. Mais désormais, elle appartient aussi à la révolution. Elle ne peut pas quitter son mari sans rompre avec le maquis. Elle s'est habituée à cette vie de dangers. Le silence de la brousse lui semble plein de menaces; les coups de fusil, par contre, la font vivre au rythme de la révolution. Eloignée de sa famille, elle a retrouvé une famille plus grande: toutes les filles du maquis, tous les partisans sont ses sœurs et frères. La forêt et la savane lui tiennent lieu de maison. Les villageoises sont ses mamans qui la nourrissent. Donc fuir son mari serait abandonner sa nouvelle famille. Et puis, où aller? Sortie du maquis, elle n'échapperait pas aux militaires. Elle détourne sa rage contre Monique. - Tu étais donc une mauvaise amie. Tu ne cherchais devenir ma rivale.Monique éclate en sanglots bruyants. Léonie n'insiste et Mulele se tait. Pour la première fois dans sa vie, Abo conçoit elle-même une leçon politique. Les hommes se sont efforcés de éduquer et de nous faire comprendre l'égalité l'homme et la femme, entre l'époux et l'épouse. Mais malgré les plus beaux discours, un homme reste toujours un homme. Une femme ne peut pas avoir plusieurs maris, sinon plus personne ne la respecte, elle n'est plus une femme normale. Dans le village, le chef coutumier pouvait s'attribuer toute une brochette de femmes. Maintenant, on raconte que Fimbo, dans la région de Kilembe, se comporte de façon pareille. Or, la femme ne supporte pas de partager son mari. Mais elle est obligé de se soumettre. Il faudra beaucoup de temps aux hommes avant qu'ils aient bien assimilé leurs propres leçons. 10. Fin décembre 1964 - 27 février 1965, A Mungai-Busongo, Malele et Nkata Kalamba - Table de matières Réorganisation de la direction. La leçon sur la lutte réformiste et la lutte révolutionnaire. Problèmes familiaux. Début de la rébellion de Kandaka. Fête populaire à Malele. Le repos des bureaucrates à Nkata Kalamba. L'abbé Tara au maquis. Lors d'un rassemblement général au lac de Ndanda, fin décembre 1964, Kafungu annonce que la direction se divisera en deux groupes, Léo-Yita et Léo-Landa, c'est-à-dire la direction qui précède et la direction qui suit. Léo-Yita sera commandée par Louis Mayele, le vice-représentant de la masse qui a vécu jusqu'à présent à l'ombre de papa Mundelengolo. Léo-Yita comprendra le gros des forces de l'état-major général, tous les scribes de la direction, au total 250 personnes dont 120 jeunes filles. Mayele ira réconforter la population entre Kilembe et Kipuku. Léo-Landa sera constituée du staff général de Mulele et du bataillon de Ntsolo, soit deux cents personnes qui resteront dans les parages pour préparer une réorganisation générale. Entre-temps, Mulele a dépêché Pierre-Damien Kandaka à Kilembe pour y régler ce qu'on appelle depuis quelques mois le problème Fimbo. Si l'on en croit les nombreux rapports parvenus de la troisième région, le problème Fimbo se résume au diptyque femmes et richesses. Le guerrier barbu prend les jeunes filles sans autres formalités et il vole les biens des villageois. Une partisane a vu Fimbo à l'œuvre, au début de la révolution. Il avait jeté un regard concupiscent sur Joséphine Mafiga, mais le père de celle-ci ne vou-lait Pas céder sa fille. Pris de colère devant ce refus humi-ïiant, Fimbo fit enterrer le vieux jusqu'au cou, puis il attendit tranquillement qu'il cède. A ce libertinage de chef coutu-naer, Fimbo joignait quelques petits privilèges de seigneur de guerre. Il avait, par exemple, installé sa propre femme au village. Et il refusait de répondre aux demandes d'explication que lui adressait la direction. Kandaka devrait corriger ce despote de village.Léo-Landa s'arrête, après un court déplacement, à Mungai-Busongo et plus particulièrement au mayumbu, l'emplacement de l'ancien village, situé sur une colline herbeuse. C'est ici que régnait, avant l'indépendance, le chef Ndzuku au ventre ballottant. Mulele, Bengila, Abo et Ilo construisent leur bivouac bien en retrait du camp, au creux d'une petite vallée boisée. Sur l'autre versant, ils aperçoivent le village Kimpundu. Chaque matin, Abo remonte la colline pour se rendre dans une des quatre vieilles cases en bon état qui abritent le dispensaire. Elle y attend les patients peu nombreux, dix à vingt personnes se présentent par jour. Un commandant vient la voir avec une régularité déconcertante et sous les prétextes médicaux les plus imaginatifs. Il lui fait une cour assidue. Abo se demande si, par cette galanterie à haut risque, il ne cherche pas à mettre fin à ses jours dans les délais les plus brefs. Le camp de Mungai est modeste, deux cents personnes au plus. Villageois ou délégations des sous-directions n'y font que de rares apparitions. Comme Mulele a moins d'occupations, il trouve le temps de parfaire l'éducation politique de sa femme. Il faut qu'elle connaisse à la perfection la leçon la plus difficile, celle sur la lutte réformiste et la lutte révolutionnaire. Abo, à son entrée au maquis, ne savait même pas ce que le simple mot lutte signifiait. Vous vous imaginez donc son trouble. Alors, après une dizaine de répétitions, cette fameuse leçon sur le thème "réformisme ou révolution" donne à peu près ceci. Il y a longtemps, des étrangers sont venus dans notre pays pour nous dire que désormais ils dirigeraient le Congo. Ils ont fait les lois et organisé une armée pour les faire respecter. Au tout début, ils ont fait la chasse à l'homme et ils ont vendu les Noirs comme esclaves. Il y a eu beaucoup de morts. Après, ils nous ont obligés à leur apporter de l'ivoire et du caoutchouc naturel. Nous avons refusé et il y a eu encore plus de tués. Ensuite, ils ont pris nos palmeraies et les richesses de notre sous-sol et ils ont instauré le travail forcé. Quand les Noirs ont refusé, comme chez nous en 1931, ils ont envoyé l'armée pour commettre des massacres. Nos parents ont payé beaucoup d'impôts pour entretenir le gouvernement et l'armée des Belges. Ils ont effectué du travail forcé pour enrichir les compagnies étrangères. Quand la souffrance est devenue insupportable, Lumumba nous a dirigés pour obtenir l'indépendance. Il voulait que les enfants du Congo gouvernent le pays, que les lois soient faites pour les Noirs qui ont souffert et que l'armée protège les villageois et les travailleurs. Mais après l'indépendance, les compagnies étrangères, les impérialistes ont encore envoyé leur armée pour nous faire la guerre, ils ont corrompu une partie de nos frères, ceux qui étaient depuis toujours les amis des Blancs, pour être leurs capitas. Aujourd'hui, le Congo est toujours aux mains des capitalistes étrangers qui font exécuter leurs basses besognes par leurs boys, les réactionnaires noirs du gouvernement et de l'armée. Les lois sont faites pour qu'ils puissent continuer à voler nos richesses et à opprimer la grande masse du peuple. L'armée est composée de Noirs qui travaillent pour les étrangers et qui sont formés et dirigés par eux. Il y a donc une lutte perpétuelle entre l'impérialisme qui s'appuie sur la réaction noire et la masse du peuple qui veut se libérer de la domination et de l'exploitation étrangères. Mais il y a deux sortes de luttes, la lutte réformiste et la lutte révolutionnaire. Les réformistes croient qu'il faut seulement lutter pour changer certaines choses dans l'ordre actuel. Ils ne veulent pas détruire cet ordre imposé par les impérialistes. Ils font des propositions dans le parlement, écrivent contre le gouvernement dans des journaux, organisent des grèves. Ils peuvent obtenir de petits succès mais ceux-ci ne durent pas. Puisque les impérialistes restent les maîtres, ils peuvent à tout moment reprendre ce qu'ils ont accordé. Les réformistes ne connaissent pas la vraie nature de l'impérialisme et des hommes à son service. L'impérialisme est une sangsue qui vide le Congo de son sang. L'impérialisme ne peut pas être amélioré. Il doit être chassé. L'impérialisme est venu il y a cinq siècles avec sa violence et ses fusils. Il faut une lutte violente pour le chasser. Pour qu'il y ait lutte révolutionnaire, il faut que les masses populaires participent et qu'elles utilisent tous les moyens, y compris les fusils, pour en finir avec la réaction et l'impérialisme. Pour qu'une lutte aussi importante puisse réussir, les masses doivent être organisées et unies dans un parti révolutionnaire qui a des idées progressistes et socialistes. Ce parti doit accorder de l'importance aux syndicats, aux journaux, aux grèves, aux manifestations mais la forme principale de lutte est la lutte armée. Toute la masse populaire doit aider à mener cette lutte armée pour nous libérer de l'impérialisme et de la réaction noire. Alors les lois seront faites pour les masses populaires et l'armée sera là pour les protéger. Le jour où Abo réussit à suivre le fil de cette histoire- compliquée jusqu'à la conclusion heureuse de la lutte armée de libération, Mulele ne lui accorde aucun repos. D'affilée, Mulele passe à un tout autre problème. Il aborde un sujet encore plus tordu: le premier mariage de sa ferrure. En effet, c'est à ce moment précis que la mère de Gaspar Mumputu et sa sœur Scolastique Oseme qui vivent à Mungai, se rendent à la direction et tombent sur Ado. Elles écarquillent d'abord les yeux, incrédules, puis éclatent en sanglots: elles étaient convaincues qu'Abo était morte au maquis. Le commandant en chef propose aux deux femmes de payer son tribut à la coutume et de leur rendre la dot que le clan de Gaspar avait versée pour Abo. Le chef Muli-kalunga de Mungai Mazinga, au courant de tous les avatars de cette affaire de famille, officialise l'opération en y assistant personnellement. Les deux femmes acceptent, mais encaissent l'argent avec un sentiment de dépit, leur seule préoccupation pour l'instant étant la survie. Elles souffrent de diverses maladies et Abo leur donne quelques médicaments devenus introuvables dans la région. Mulele décide de poursuivre sur son élan et de régler du coup l'ensemble de son contentieux matrimonial. Il envoie ses frères, munis de 4.000 F, payer la dot de Monique Ilo. Ils sont en outre chargés de cadeaux: deux pièces de tissu et un foulard pour la mère; un costume, un chapeau feutre et une paire de chaussures pour le père et une chemise, une paire de souliers et un labul - grand pagne - pour l'oncle. Peu de temps après, Monique est enceinte. Le staff, réuni en petit comité, l'envoie au village, attendre l'accouchement chez la mère de Mulele. Ilo, Abo et Mulele se rendent en février dans la brousse de Kimbanda où vit Ignace Luam, avec Amias, la fille de l'oncle Ebul. Celle qui, enfant, rivalisait avec Abo pour la suprématie sur les gosses de Bozombo. Amias souffre d'anémie. Elle vient d'accoucher d'une petite fille, maigre comme un squelette, qui meurt devant Abo. Peu après le départ de Mulele et d'Abo, Amias rend l'âme à son tour. Autre drame : l'infirmier Anaclet Bilo voit sa femme mourir dans des douleurs atroces. Enceinte, elle appréhendait la naissance d'un enfant au milieu des dangers de la guerre. Sans rien dire à personne, elle a voulu provoquer un avor-tement selon des recettes vaguement apprises au village. Elle a pilé des racines séchées de quinquiliba et de papaye, y a mêlé des graines d'atnon et a jeté le tout dans l'eau bouillante. Elle a avalé cette potion amère. Or, une quantité trop importante de graines à'amon s'avère mortelle. Anka-wu, le médecin, en constate l'effet lors de l'autopsie: les intestins de la jeune femme sont collés, brûlés, à l'aspect de la viande bouillie.Au camp Mungai, Mulele a construit un grand dais de branches et de feuilles sous lequel il reçoit les délégations. Un jour, deux Bapende arrivent de la région de Kondo, porteurs d'un message urgent. - Papa, ça ne va pas entre Kandaka et les partisans. Kandaka prétend qu'il va faire la révolution à sa manière. Il nous donne des leçons politiques qui disent le contraire de ce que tu nous a appris. Alors, qu'est-ce qu'il faut en penser? Est-ce qu'il faut diviser la révolution en deux, une pour les Bambunda et une pour les Bapende? Certains ne sont pas d'accord. Il y a même eu des affrontements sanglants entre les partisans. Tout d'abord, Mulele ne croit pas ces accusations. Kandaka est un de nos commandants les plus courageux, comment pourrait-il faire une chose pareille? Mais à mesure que tombent les messages en provenance des équipes de Kilembe, Mulele doit se rendre à l'évidence. Abo le surprend en conversation avec Bengila. - Je ne comprends pas ce que Kandaka cherche. Maintenant, nous avons un peu de liberté, le moment est venu de mieux discipliner les hommes et d'impulser l'action militaire. Et voilà que Kandaka nous amène des histoires. - Il faudra aller là-bas pour lui faire entendre raison. On prélève quelques partisans dans chaque équipe pour se rendre à Kilembe. Mulele quitte Mungai et passe la nuit dans la brousse de Kimbanda. Le lendemain, on traverse la plaine entre Lukamba Ingudi et Matende Mazinga. C'est dans cette savane qu'Abo voit surgir, comme un groupe de spectres, son ancienne institutrice de Lukamba, Maria Aliam, son mari et leur fille Albertine Musamuna accompagnée de ses deux petites filles. Anémiques, les deux enfants de respectivement trois et six ans ont le ventre gonflé, signe apparent du kwashiorkor. Elles sont couvertes de plaies dont suppure un liquide incolore. Abo demande à Albertine, son amie d'école primaire: - Pourquoi les enfants sont-ils dans un tel état? Albertine ne répond pas. Le regard fixé sur un horizon vague, elle semble accablée de tant de misère qu'elle ne voit plus rien. Maria Aliam, l'institutrice, a l'air de bien se porter. Mais elle n'est plus en mesure de prendre en charge la misère d'un autre être humain, fût-ce sa propre petite fille. Cette scène pitoyable bouleverse Abo, étourdie devant ce laisser-aller et cet abandon étrange et anormal. Elle donne de la folidine aux petites filles. Mais peu après, elles mourront. A Malele, Mulele n'est entouré que d'une centaine de partisans, essentiellement du bataillon de Ntsolo. Le samedi soir, la population se rend au camp, munie de quelques langung et d'onkwak, l'instrument rythmique des brous-sards. Il s'agit d'un petit bâton creux, pourvu sur toute sa longueur d'une fente aux bords taillés en dents de scie sur lesquels on passe une baguette pour donner le rythme. Les villageois chantent leur vie de tous les jours.
Mulele, les soldats sont-ils partis, puis-je venir? Ce samedi-là, Abo se tient à l'écart pendant que la fête bat son plein. Maurice Zanga, réinstallé comme officier d'ordonnance de Mulele, s'approche d'elle pour lui annoncer que le commandant en chef veut qu'elle danse. Il est bien connu que le camarade Pierre est expert en la matière. Vêtue d'un vieux pagne, Abo rentre au bivouac pour mettre sa tenue de fête. Il se fait que peu auparavant, des villageois ont offert à Mulele une robe splendide, couleur bleu ciel, une robe bien cousue, comme les femmes en portent en ville, d'après ce qu'on dit. Mulele en a fait cadeau à son épouse. Abo fait donc son apparition parmi les partisans en fête, vêtue comme une princesse de conte de fées. Regards épatés. Et elle n'échappe pas, bien entendu, aux grands yeux de Mulele. Qui, du coup, envoie Zanga avec un ordre sans réplique: - Enlève ça, mets autre chose et viens danser. Rentrée au bivouac une deuxième fois, Abo fond en pleurs. Elle n'a pas le cœur à la danse, la honte d'avoir été vue dans sa robe éblouissante pour être chassée l'instant d'après, lui monte aux joues. Nulle envie de danser avec lui. Mais comment oserait-elle braver ses ordres, maintenant que tous les partisans guettent la suite de l'histoire? Elle revient en paysanne, vêtue d'un pagne. Au rythme du langung et de Yonkwak, Abo esquisse quelques mouvements flous, comme cette Flamande qui dansait sans rien dire, sans rien dire au dimanche sonnant. Cette Flamande qui n'était pas causante, Abo l'entendra chanter par Jacques Brel, bien des années plus tard. La fête terminée, Mulele lui dit: - Si tu veux faire la coquette, il faut aller faire ta vie à Kinshasa. J'y ai une maison, vas-y. Abo répliquera en pensées par une question qu'elle n'ose pas formuler. Pourquoi m'offrir une robe si tu ne veux pas que je la porte? Il est parfois dur d'avoir vingt ans au maquis. Abo boude et détourne son regard d'un mari trop sec. Mulele a les yeux tournés vers Kandaka, l'insoumis, et l'élégance déplacée de sa femme l'agace. Il dépêche Pascal Mundelengolo, Julien, le Mupende et trois autres partisans vers Kilembe pour une palabre avec Kandaka. A leur arrivée à Mukedi, le chef Nzamba réunit ses hommes dans l'église. Mundelengolo ne parlant pas le kipende, Julien expose le point de vue de Mulele, insiste lourdement sur l'idée qu'il ne peut y avoir du tribalisme dans la révolution. Le soir, la délégation est invitée chez le chef Nzamba qui leur sert un excellent repas. Ce qui est très bon signe. Finalement, le chef promet de se rendre en personne à la direction pour s'entretenir avec Mulele. Au retour à Malele, Julien proclame haut et fort la réussite de la mission. Mais derrière son dos, Kandaka éprouve peu de difficultés à convaincre le chef Nzamba que les Bambunda "ne nous aiment pas" et qu'ils vont certainement l'abattre s'il ose se présenter dans la tanière du léopard. Arrive un messager de Bozombo. Après que la colonne de Mulele a quitté la brousse de Lukamba, des militaires sont venus brûler le quartier chrétien de Bozombo, le quartier chic où vivent les intellectuels. Ils ont tué Charles Nku-tu, l'enseignant, revenu il y a peu de la direction générale. Charles fut le mari de Marguerite Mimpia, la cousine d'Abo. Pratiquement au même moment, Sabine Mimpia, qui fréquentait l'école de Lukamba avec Abo, est morte de maladie à Bantsamba. A travers les brousses de Malele et d'Ingietshi, Mulele s'achemine en direction de Nkata Kalamba, paradis de vacances où s'est niché le commandant Mayele. La population mbuun et pende de la région Kilembe-Kipuku avait protesté depuis belle lurette contre la discrimination qui la frappait: Pourquoi les gens de Lukamba veulent-ils garder jalousement pour eux seuls la direction centrale de la révolution et le commandant en chef, Mulele? Est-ce que nous, nous ne pouvons pas le voir? La mission de Louis Mayele et de son groupe Léo-Yita consiste à renforcer le moral de cette population. A Nkata Kalamba, il n'y a pas un militaire ni le moindre danger à des dizaines de kilomètres aux alentours. Mayele ne connaît pas les limites de son bonheur: le voilà chef suprême, coiffant les têtes les mieux faites de la direction générale! La paix, que Dieu nous donne la paix, soupirent les ex-et futurs séminaristes qui entourent l'abbé Lankwan. Ils sont enfin libérés de ce foudre de guerre qui s'appelle Kafungu. Kafungu ne cessait de nous emmerder pour aller à la bataille. Ces gens viennent ici pour bouffer, disait-il, cet abruti. Ciao Kafungu, nous voilà libres! Fêtons la paix retrouvée, organisons des réjouissances, nous avons déjà trop souffert. Bien sûr, les rites de la révolution continuent: rassemblement, drill, leçon politique, exercice militaire, corvée, mais tout se joue dans l'atmosphère bon enfant d'une colonie de vacances. A l'heure de l'entraînement physique et militaire, l'abbé Lankwan se retire: son refus se pratique dans la discrétion. Lankwan porte symboliquement — et pour tourner la chose en dérision — un petit arc et deux flèches. Dans les bureaux ne s'effectue plus aucun travail. Les bureaucrates, comme on appelle communément les intellectuels, ne s'imaginent pas devoir rendre compte à Mayele, un ignare. Et quant au mal instruit lui-même, il ne s'offusque guère de l'insulte, heureux comme il est en sa qualité de "chef de troubles". Il s'annonce dans cette qualité aux villageois impressionnés — et les intellectuels se gardent bien de lui apprendre le sens exact du mot chef de troupe. Chaque jour, dans le bureau des masses, Louis Mayele et François Ibungu, son adjoint, reçoivent les populations des villages environnants qui veulent entendre de la bouche de Mayele, le Jean-Baptiste de la révolution, la bonne nouvelle que Mulele descendra bientôt dans la région. Message de bonheur et d'espoir. Les villageois ne s'étonnent guère, dans cette atmosphère légèrement euphorique, d'entendre entonner le credo et le gloria, chants d'une autre époque. C'est l'abbé Lankwan qui, entouré de ses séminaristes et élèves, s'efforce de maintenir une certaine nostalgie. Les partisans de chez Mayele, qui s'esquivent devant toute rencontre avec les soldats, mènent, en revanche, un combat d'extermination contre un ennemi très mordant: les anguilles. Elles en ont vu de toutes les couleurs, ces petites bêtes visqueuses. Quel sentiment exaltant d'aiguiser vos armes, de monter en ligne et de retourner, au crépuscule, couvert de butin. Mes amis, les anguilles de Nkata Kalam-ba, rien qu'à y penser, l'eau vous monte à la bouche. Il faut que je vous raconte. Dans la forêt, vous trouvez des bambous aux petits rameaux portant des épines. Prenez cinq bouts de trois centimètres environ, comptant quatre à cinq épines. Fixez une corde de raphia au milieu de chaque rameau. Maintenant vous attachez à chaque épine un pam-bu, petit ver jaunâtre. Au bord de la rivière, vous faites des trous peu profonds et dans chacun vous mettez un faisceau de cinq rameaux. Il ne reste qu'à attendre. Les anguilles, avec leur petite bouche et leur petit cerveau, avalent tout : vers, rameaux et bien sûr, épines. Retournez maintenant d'un pas allègre au bivouac, épicentre de la révolution et haut-lieu de l'art culinaire. Les anguilles, vous les coupez en menus morceaux, ensuite, vous étalez des feuilles au fond de la marmite, puis vous y déposez le poisson assaisonné de pili-pili, d'oignons, de sel indigène et vous versez un peu d'eau bouillante dessus. Laisser mijoter pendant un bon bout de temps. Ah, quel régal! Et qu'il est loin, le temps où Kafungu nous persécutait à mort. Des centaines de personnes innocentes qu'il a fusillées! Je vous le jure, moi, Constant N'dom. Puisse la révolution avoir toujours le goût des anguilles de Nkata Kalam-ba! Kafungu, d'une voix tonitruante, admonestera plus tard les rescapés du groupe Mayele: - Qu'est-ce que vous faisiez là-bas? Dormir, aller à la pêche, bien manger, danser, les fugitifs aiment ça! Le calme règne à Nkata Kalamba au point qu'on a eu le loisir d'ériger deux constructions relativement impressionnantes en pleine brousse. La première merveille architecturale, comprenant rez-de-chausée et étage, a été construite par l'abbé Tara pour son confort et celui de ses deux sœurs. Sa demeure tient sur six piliers, des troncs d'arbres robustes. A deux mètres du sol, Tara a fixé une claie de solides branches couvertes de bambous liés par des lianes. Une clôture entoure l'étage, surmontée par un toit de branches et de feuilles de palmiers. De temps en temps des villageois apportent un présent à l'abbé qui les reçoit dans l'ombre délicieuse de son rez-de-chaussée. Une échelle conduit à l'étage. Sa sœur Sophie, treize ans, fréquentait la deuxième normale avant d'entrer au maquis. Elle ne se sépare jamais de son frère. Et c'est là qu'intervient un phénomène des plus étranges. Souvent, des partisans surprennent Tara près de la rivière, en train de puiser de l'eau, de laver des vêtements, de mouiller le manioc. Les partisans observent avec grand étonnement, mais sans se permettre le moindre commentaire, ce spectacle insolite d'un homme faisant le ménage quoiqu'il dispose d'une femme à ses ordres. La deuxième réalisation urbanistique de Nkata Kalamba frappe encore plus l'imagination, puisqu'il s'agit d'une construction souterraine. Un grand espace d'une profondeur de trois mètres a été creusé sous terre: c'est la prison. Elle est couverte de branchages, mais un trou permet d'y introduire suspects et condamnés. En général, ils jouissent d'un régime de faveur: la journée au bivouac, la nuit dans le puits. Ils sont vingt jeunes à y descendre sous des accusations ou des inculpations diverses. Le juge Bula-Bula Théophile envoie une plainte à Kafungu : Mayele devient dictateur, il met les jeunes en prison pour un rien. Kafungu fait chercher les mal-obéissants par un commando. Plutôt que de pourrir sous terre, aller mourir à la guerre! s'exclame dans un bref élan d'héroïsme, celui qui est le plus porté vers la poésie. Dans le dolce far niente de Nkata Kalamba, un abbé sauve l'honneur de la révolution. L'abbé Tara se révèle un excellent instructeur politique et militaire. Figure imposante, noir-foncé, d'une forte carrure, Tara est un homme posé et calme qui parle de la révolution avec une autorité tranquille. Les jeunes admirent son érudition. Après avoir lu deux fois le cahier sur la tactique de la guérilla, l'abbé arrive à en expliquer toutes les finesses. Puis il peut passer à un autre registre et faire une longue causerie sur l'art mbuun. Avant l'indépendance, dit-il, j'avais déjà lu des livres sur la Chine. Vous voyez que nous, les abbés, avons des privilèges qui parfois s'avèrent utiles. La révolution en Chine ressemble beaucoup à la nôtre. Vous êtes venus dans la révolution, mais vous ne savez pas ce qui peut arriver à l'avenir. Les paysans chinois ont beaucoup lutté, ils ont connu beaucoup d'échecs. Pourquoi la révolution connaît-elle des défaites? Il faut y réfléchir, en tirer des leçons. Les tactiques de la guerre en Chine sont les mêmes que chez nous. C'est la guerre populaire, la guerre des masses, puisque les partisans, pour être en mesure de lutter contre l'ennemi, doivent s'entendre parfaitement avec la population. Tara donne souvent la leçon sur la conviction de la lutte. Le partisan doit posséder une volonté ferme, inébranlable de lutte : toute sa vie doit être imprégnée de la détermination de combattre l'ennemi. Nous n'avons pas de fusils. Alors, comment lutter? L'ennemi a la gentillesse de nous apporter fusils et munitions. Il faut tendre des embuscades. Et capturer des soldats. Nous les instruirons, nous leur donnerons des idées révolutionnaires pour qu'ils puissent faire la révolution avec les villageois. Il faut l'autorité et le talent oratoire de Tara pour faire passer ce dernier message. Les villageois ne croient pas que les grands commis, les militaires et les prêtres puissent se mettre du côté de la révolution. Mais si, mais si, leur assure Tara, ces gens peuvent venir de notre côté, pourvu qu'ils se battent réellement contre l'impérialisme. A Banda, trois militaires, faits prisonniers, ont suivi avec succès les leçons politiques. Ils venaient de l'Equateur et de l'Est. Deux travaillent maintenant à la cuisine; dans le groupe de Mayele. Le troisième est resté avec Mulele. Après le rassemblement, Tara s'éloigne avec une cinquantaine de partisans pour l'entraînement militaire. Il faut choisir, dit-il, pour vous camoufler, des plantes qui ressemblent exactement aux herbes de la brousse où vous voulez opérer. Puis il montre comment ramper comme un serpent. Il commande de progresser en tirailleur, puis de se rassembler au signal. Très bon tireur à l'arc, il aide les partisans à améliorer leur technique. On ne tire pas au fusil, les balles sont trop précieuses, mais Tara apprend aux jeunes à démonter, nettoyer et remonter le fusil Fall qu'il porte toujours à l'épaule. 11. 27 février - 19 juin 1965, A Kifusa - Table de matières Début de l'affrontement avec Kandaka. La commandante Godelieve Madinga. La vie à la Direction. A propos du tribalisme. La prise de Mukedi. Trahison et exécution de l'abbé Lankwan. Grande attaque de l'armée. La colonne de partisans, Kafungu et Mulele marchant à sa tête, serpente sur le sentier de brousse conduisant de Malele à Mobi Djeme. Les maquisards passent la nuit du 28 février 1965 entre Mobi Djeme et Mobikai, deux villages qui commencent à manquer dramatiquement de manioc mais dont les habitants tiennent à tout prix à fournir du foufou aux combattants. Des vieux de Buzimbila-Yassa ont parcouru quinze kilomètres pour venir supplier le camarade en chef d'honorer leur village d'une visite, si brève soit-elle. Ils causent avec Mulele dans une langue à laquelle Abo ne pige rien. Mulele se moque d'elle: - Tu n'as rien compris, tu n'es pas une Mumbunda. Les villageois parlent un vieux kimbunda aux consonances indéchiffrables pour une jeune femme de Lukamba. La direction poursuit la route pour s'arrêter, le premier mars, à Luende Nzangala où elle s'établira pendant deux semaines. Les partisans des équipes environnantes commencent à rejoindre le camp central où l'on les verse dans le bataillon de Ntsolo. Bientôt on compte à nouveau 700 combattants. Fimbo, grand, brun, bon vivant, Fimbo, le seigneur de guerre local, plie l'échiné à l'approche du grand chef. Ses histoires de femmes, ses détournements et sa brutalité, qui lui auraient valu une punition draconienne en d'autres temps, sont mis aux oubliettes devant le drame terrible de la rébellion de Kandaka. Aussi Fimbo fait-il une entrée remarquée à la direction, chantant à pleins poumons:
Chef Mulele Pierre il nous a appelés Une activité débordante se développe à Luende Nzangala. Dans la plaine, Abo voit marcher en sens divers des colonnes de combattants, brandissant fièrement leurs flèches et leurs poupous et rythmant leurs pas en chantant Fumu Mulele. La scène est impressionnante. Mais Mulele n'est nullement sensible à cette ambiance exaltée. Son courroux devant l'impasse de la révolution, il l'exprime dans ses leçons politiques. - Le Congo est pour nous tous, enfants du Congo. Quand les Belges ont envoyé leur armée, en 1931, ravager le Kwan-go, est-ce que leurs balles cherchaient seulement une race? Non, des Bambala, des Bapende, des Bakwese, des Bam-bunda ont été tués. Des Bapende en fuite devant cette terreur sont arrivés dans notre village. Nos ancêtres leur ont donné de la terre. Les Bapende avaient beaucoup d'huile de palme que nous ne savions pas bien produire; ils avaient aussi des légumes qu'on appelle élin, en abondance. Nous, en échange, nous leur donnions du millet et du maïs. Dans la révolution, il n'y a pas de place pour le régionalisme, le sectarisme ou le tribalisme. Nous, les partisans, devons montrer l'exemple. Et la population prendra exemple sur nous. Kafungu part, le 13 mars, à Kimbunze, négocier avec le grand chef coutumier de l'endroit, Fumu Nzamba. Le surlendemain, trois Bapende de son groupe se présentent devant Mulele, le premier la tête ensanglantée, le deuxième une blessure à l'épaule, le troisième le cœur tout petit. Des hommes de Kandaka leur ont tendu un guet-apens. Tous les trois ont perdu leur fusil de chasse dans les escarmouches. Quelques partisans ont succombé. A cette nouvelle, Mulele se met en marche avec 200 partisans, dont Abo et Ambwel, la femme de Kafungu, pour Kimbunze. Puis, avec les hommes de Kafungu qui se joignent à eux, ils continuent jusqu'au village Nioka Munene. Alors qu'ils s'apprêtent à y pénétrer, les partisans de Kandaka, embusqués dans le village même, ouvrent le feu. Panique, les uns fuient, d'autres avancent. Entre-temps, les hommes de Kandaka s'esquivent. Mulele et les membres de la direction s'installent dans une grande maison en briques à Nioka Munene. Les jours suivants, tous les villages qui bordent la rivière Tshi-nyo connaissent des affrontements internes entre partisans de Kandaka et fidèles à la direction générale. A plusieurs endroits, des deux côtés de la rivière, on voit monter la fumée noire des cases incendiées. Après un bref séjour à Nioka Munene, la direction s'installe dans l'ancien village de Kifusa, envahi de hautes herbes, de palmiers et d'arbres de raphia. Bientôt le camp y dépasse en étendue comme en animation celui de Banda Buzimbila. Toutes les équipes des alentours, celles de Mukedi et de Kinzam-ba, mais aussi un bon nombre de villageois, s'y installent. A Kifusa, la révolution retrouve le rythme qu'elle avait à Banda. Chaque matin, le rassemblement général salue la montée du drapeau rouge. On chante l'Internationale en français et en kikongo. Tous les partisans se trouvent dans les rangs, derrière les chefs de peloton, sur toute la longueur d'une aire rectangulaire. En face d'eux, les dirigeants qui commandent le rassemblement: Mulele, Kafungu, Ngwensun-gu, ça dépend des jours. Godelieve Madinga assure parfois le commandement. Sur les flancs droit et gauche prennent place tous ceux qui ont rang d'officier, les chefs de bureau comme Bula-Bula, Laurentin Ngolo et Placide Tara, rentré il y a peu du paradis vacancier de Nkata Kalamba, aussi bien que les commandants militaires, Mumvudi, Fimbo, Ntsolo, Bakanga et les autres. Pour diriger les exercices militaires, les partisans apprécient surtout les voix fortes et décidées de Situkumbansa, de Muzungulu et de Mumvudi. Elles inspirent confiance et fierté, font marcher les hommes et les femmes avec détermination et enthousiasme. Situkumbansa surtout se laisse parfois aller à une exubérance martiale malvenue. Un jour, il crie tellement fort que Mulele envoie Abo pour lui dire: - Les ennemis sont à Lozo, ils peuvent t'entendre, ils pourraient accourir pour participer à tes excercices. Après le rassemblement, Godelieve Madinga donne de temps à autre la leçon politique du jour. Elle insiste sur le respect qu'il faut avoir pour la masse et pour les biens des villageois. - La masse constitue la base de la révolution. Sans la masse, le partisan ne peut pas trouver où aller. Nous-mêmes, nous sortons de la masse, ce sont nos propres parents. Le partisan dépend de la masse pour sa nourriture, ses habits, les médicaments. Les secrets des partisans sont entre les mains des villageois. Quand les militaires viennent, la masse nous protège. Tous ceux qui volent les villageois, qui ravagent leurs champs, n'ont pas l'esprit révolutionnaire. Godelieve expose ses idées en kikongo. Depuis le camp Banda Buzimbila Deux, elle s'est imposée comme chef d'état-major adjoint, au grand dam de Ngwen-sungu pour qui le passage par l'armée est obligatoire si l'on veut faire un bon capitaine de guerre. Et puis, une femme, qu'est-ce qu'elle pourrait commander? Kafungu a tenu à mettre les choses au point devant tous les partisans: - Pourquoi ne veux-tu pas de Madinga comme adjoint? Nous avons besoin de femmes-cadres dans la révolution. Mais il fallait une force plus puissante pour briser les résistances. Un matin, Mulele en personne devra se présenter devant le rassemblement. - La révolution, est-elle commandée uniquement par les hommes? Aujourd'hui, Godelieve commandera le drill, pour que je voie si elle est de taille. Après les exercices, commandés à la perfection ou presque : - Moi, je ne peux pas voir de différence entre le commandement de Godelieve et celui des hommes. Et du coup, l'autorité de Godelieve s'affirme. Mais il reste toujours du chemin à faire. Godelieve aura d'abord à sévir et à châtier de son propre chef. Un jour, au lieu de dire "quart de tour", Godelieve crie "demi-tour". Ceux qui guettent depuis belle lurette la première faute se moquent abondamment d'elle. La réplique ne tarde pas: - Nzao, Gimena et Katalay, quatorze jours de prison au bataillon. Plus personne ne se risquera désormais à manifester la moindre opposition aux femmes commandantes dans la révolution. L'idée un peu éthérée de l'égalité entre l'homme et la femme se concrétise de façon palpable en Godelieve Madinga, petite, costaude, la mitraillette sur l'épaule. Un après-midi, Abo entend l'abbé Tara donner une leçon qui ne manque pas de piquant. Tout à fait sérieusement -et aucun des assistants n'a d'ailleurs envie de rire à de tels propos - Tara dit aux partisans : - Ce que les femmes peuvent faire, les hommes le peuvent aussi. Bon dieu, lit-on sur les visages, cet abbé iconoclaste a l'intention d'inverser l'ordre naturel de l'univers! - Vous ne faites rien, vous êtes des paresseux, il n'y a que les femmes qui travaillent. En fait, Tara commente un exercice qu'il a entrepris ce matin même et qui lui a valu les moqueries acerbes de toute la gent masculine. L'abbé a été aperçu ramenant sur son épaule un panier plein de manioc mouillé qu'il venait de retirer de la rivière. Comme vous savez, pour être comestible, le manioc doit tremper pendant deux jours dans l'eau. Mais certaines des conséquences désagréables de cette opération, échappent en général à l'attention. Monsieur l'abbé s'en est bien rendu compte quand un liquide blanchâtre, fort malodorant, a dégouliné des mailles de la corbeille sur ses vêtements. Aucun homme digne de ce nom ne peut subir une humiliation aussi dégradante : transporter du manioc mouillé aux relents de moisissure. C'est un travail de femme. Et si l'on peut poursuivre le raisonnement, on dira qu'il revient aussi à la femme de réaliser tout le cycle de transformation qui fera, de ce manioc cru, du toutou chaud et appétissant. A propos, il faut que le toutou soit bien lourd et dur, sinon, pas la peine d'épouser cette femme. Et l'homme honorera sa femme en mangeant bien et abondamment, occupation qui lui est essentiellement réservée. Ainsi l'ont voulu les ancêtres. Au grand désespoir de l'abbé Tara. A Kifusa, les bureaux fonctionnent à nouveau à plein rendement. Mulele recommande aux responsables de tenir un journal et d'y consigner tous les événements majeurs. Il revient sur l'idée, le soir autour du feu, devant tous les dirigeants. - Tout ce que vous faites, ce que vous voyez, toutes les informations qui vous parviennent, il faut les noter. Sinon, comment pourriez-vous réfléchir sérieusement à notre expérience? Jusqu'alors, Abo tenait des petits cahiers dans lesquels elle notait ses réflexions au gré des événements. Désormais, elle écrira régulièrement dans un journal de classe cartonné et couvert d'une étoffe grise. Elle reprend son travail d'infirmière à côté d'Ankawu, de Wavula, d'Anaclet Bilo et du vieil Antoine Musuta. Jeanette Kashiama et Charlotte Ntsamana s'initient à l'art de guérir. Abo remet en état sa pharmacie dont le registre et le stock sont tenus avec minutie. Lors de la réorganisation de la direction à Kifusa, Placide Tara a remplacé Eugène Mumvudi comme responsable de la sécurité du camp. Des équipes postées à un kilomètre du camp, sur les différentes voies d'accès, constituent la garde rapprochée. Toute la journée, un homme de l'équipe fait le ' guet de la cime d'un grand palmier. La garde éloignée assure la surveillance dans un rayon de dix kilomètres. Des équipes d'embuscade se tiennent en permanence sur les axes principaux pour intervenir en cas de besoin. Toutes les semaines, la garde est renouvelée. Chaque semaine aussi, Tara change le mot d'approche et le mot de passe que toute personne qui sort de la direction doit connaître s'il veut y rentrer. En plus, celui qui se rend de l'état-major général au bataillon ou qui quitte le camp pour une mission quelconque doit se munir d'un laisser-passer. Après le coucher du soleil, Tara, Mulele et Kafungu se glissent dans l'ombre, comme des chats, pour inspecter les gardes. Une nuit, Mulele surprend un partisan en train de produire une mélodie plaintive sur les lamelles métalliques fixées sur une petite boîte en bois, la sanza ou l' ébim, dans la langue des Bambunda. - Ainsi, tu appelles les militaires?Le commandant en chef confisque l'instrument musical. Il y a un temps pour tout. Le week-end, tu peux exercer tes talents artistiques. En effet, chaque samedi, plusieurs centaines de villageois pende donnent à la direction l'aspect d'une foire ou d'une fête populaire. Plus experts en musique que les Bambunda, ils amènent des tam-tams, des madimbas qu'on appelle ailleurs balofons, des ébims et même, à l'occasion, un accordéon. Il fait bon vivre à Kifusa, comparé à la sévérité qui régnait au camp de Banda. Les partisans pratiquent pêle-mêle les différentes danses de la région. Kafungu préfère aux mouvements lents pratiqués à Mukulu, son village natal, les danses plus vigoureuses, plus violentes des Bapende.Tous les événements du maquis sont immédiatement relatés dans des chansons composées pour l'occasion. Ainsi, tout le monde se rappelle que, récemment, l'armée a tué la plus belle fille de la région de Sembo, convoitée par tous les garçons: Mbiri. Son frère la pleure tous les jours. Filo, chanteur réputé de la sous-direction Yassa, chante sa mémoire à la guitare.
Mbiri eh Mbiri eh marna Quinze mètres derrière son bivouac, Mulele a fait construire un grand dais, sous lequel il tient ses causeries avec la masse populaire. Les villageois y vont de leurs proverbes.
Un palmier de la brousse a des lignes sur son tronc Cette chanson du tribunal veut dire pour l'occasion que devant les difficultés de la révolution, les villageois comptent sur l'intelligence de Mulele pour leur montrer le chemin. - Je n'ai jamais dit de faire la révolution avec une seule race, commence Mulele. La révolution est pour tout le monde. Mulele avec les Bambunda, Kandaka avec les Bapende, quelle sorte de révolution pourrait-on faire de cette manière? Je sais que Kandaka ne durera pas longtemps. Maintenant que je suis arrivé dans la région, il pourra peut-être laisser tomber cette affaire et revenir à la direction. Vous, les vieux, vous connaissez les événements de chez nous avant l'indépendance. Kasavubu a d'abord envoyé ses hommes à Brazzaville, pour s'entendre avec Youlou, un abbé, afin de créer ensemble une république pour les Bacongo. Un an plus tard, Kasavubu nous a proposé à Gizenga, à Kama et à moi, de proclamer l'indépendance d'une République du Congo Central ne regroupant que le Bas-Congo et le Kwango. Les enfants du Congo allaient se diviser pour se battre entre eux, au grand profit des Belges. Mais nous avons créé le Parti Solidaire Africain pour affirmer que nous sommes Africains et que nous ne voulons pas diviser les différentes races. Mulele ne cesse de répéter son message, dans l'espoir qu'il parviendra à Kandaka. Mais entre-temps, une guerre sournoise continue. Quand les partisans descendent dans la rivière Tshinyo pour se laver, on leur tire dessus de l'autre rive où règne Kandaka. Comme la majorité des partisans à la direction sont des Bapende, une question revient sur toutes les lèvres: mais qu'est-ce qu'il cherche au juste, Kandaka? Zacharie Mupembe aborde le sujet au rassemblement: - Moi, je travaille ici, j'ai toujours été l'adjoint de Kandaka, maintenant je le remplace. Quels problèmes pourrait-il y avoir pour les Bapende à la direction? La première chose que nous avons appris, c'est qu'il n'y a pas de races dans la révolution. Mais devant une case à Kimbunze, Zacharie trouvera une planche portant une inscription au charbon de bois:
Qui veut mourir, qu'il meure C'est le cri de guerre des Bapende. La formule aussi qui accompagne l'épreuve du poison. Que celui qui a raison, reste en vie, que le coupable meure! Mais ici ce proverbe émerge d'une vague de tribalisme. Et juste à ce moment, on voit rentrer à la direction ceux et celles qu'on croyait disparus à l'autre bout du monde, dans la plus décriée des tribus. C'est l'équipe de Nelly Labut, envoyée en novembre de l'année précédente en mission chez les Bankutu. Elle fait son apparition en chantant en kinkutu. Tous les membres de l'expédition ont appris la langue locale. Les premiers Blancs pénétrant la région des Bankutu ont brossé des tableaux hauts en couleur de la sauvagerie rencontrée sur leur chemin. Les Bankutu dégustent de la chair humaine comme d'autres mangent du poulet, écrivaient-ils. Chez les Bankutu, tout esclave décédé est invariablement destiné à la consommation et à l'approche d'un convoi de civilisateurs, ces sauvages se retirent dans des cases clandestines en forêt, placent des trappes et des pièges dans leurs villages et mènent une guerre de guérilla implacable avec des flèches empoisonnées. Pour rallier des guerriers aussi farouches à la révolution, Mulele leur a envoyé une équipe d'une vingtaine de filles et de dix hommes. On comprend donc l'étonnement qui se lit sur tous les visages lorsque cette équipe rentre saine et sauve, sous la conduite de Nelly, la commissaire politique, et accompagnée d'une escorte de cinq Bankutu. Barthélémy Mwanan-deke, le commissaire militaire, est resté de l'autre côté de la rivière Kasaï. Comme présent, de vieux Bankutu ont offert à Mulele une livraison de poison pour ses flèches. Expédition dangereuse que celle de pénétrer la grande forêt des Bankutu ! Il a fallu franchir une zone contrôlée par l'ennemi le long de la rivière Kasaï et traverser l'eau en déjouant la surveillance de l'armée stationnée aux points de passage. Se déplacer uniquement de nuit. Puis, le plus difficile, se faire accepter par une population inconnue. Mais depuis toujours violemment hostiles à la colonisation, les Bankutu, auxquels des bruits sur la révolution étaient déjà parvenus, attendaient avec un préjugé très favorable les émissaires de Mulele. Ce qui les a impressionnés le plus, c'est de voir des femmes commander une révolution. Alors là, il n'y avait plus lieu d'hésiter. Nelly a envoyé de suite une équipe de quatre filles et de trois garçons nkutu à Banda pour la formation. Barthélémy, un Munkutu, restera comme aide aux côtés de Mulele jusqu'à la fin. Des partisans de Kandaka, arrêtés, sont interrogés à la prison, chez Jean Kamba. Kandaka dit que Pierre est tribaliste, qu'il accepte uniquement des Bambunda autour de lui. Il prétend aussi que Mulele va bientôt constituer son gouvernement et qu'il n'y aura que des Bambunda dedans. Les Bambunda tuent tous les grands chefs pende, comme Gin-gombe. On va nous traiter comme à l'époque coloniale. Nous devons faire notre propre révolution pour avoir des gens à nous. Mais, ajoutent les prisonniers, tous ne sont pas d'accord. Certains villageois demandent à Kandaka où se trouve son collaborateur Zacharie, pourquoi ils ne le voient pas en sa compagnie. Des informations inquiétantes parviennent à la direction. Des villageois auraient été tués par balle, par flèche ou à la machette lors d'affrontements confus entre partisans de Kandaka et équipes de la direction. Le soir, Mulele a les traits tirés, les nerfs à fleur de peau. Il n'avait jamais pensé se trouver un jour dans une situation aussi impossible et absurde. Mulele invariablement ressasse sa question: - L'ennemi réactionnaire nous poursuit, Kandaka s'intercale, il soulève une partie des forces révolutionnaires. Nous allons lutter contre qui maintenant? Presque toujours, les dirigeants lui répondent qu'il faut en finir vite avec Kandaka, puis s'attaquer à l'ennemi numéro un. Mulele s'énerve. Kandaka est un révolutionnaire courageux. Le bruit court que tous les opposants à la révolution se sont retranchés dans la Terre de Dieu, Mavu a Nzambi. Cette grande mission protestante de Mukedi garde depuis toujours un aspect mystérieux et menaçant aux yeux des païens pende. Les supputations vont déjà bon train: le chef Nzamba a joint ses fétiches à ceux de Mavu a Nzambi. Décidément, ça devient dangereux. Des hommes de Mukedi apportent une information. Kandaka, qui se trouve dans notre village, dit qu'il va chasser Mulele de Kifusa. Il s'apprête à attaquer. Mulele pique une de ses colères. - Un enfant comme Kandaka, que moi j'ai formé? Il ne se contente pas de tromper les masses, il se prépare à me frapper? Je lui montrerai que je suis bien son père. L'après-midi à quatorze heures, Mulele, dans un état d'énervement et de tension extrêmes, convoque Kafungu et, debout, lui déclare: - Kandaka se trouve en face, à Mukedi. Il faut redresser le moral des partisans et des masses. Je vous donne un ordre militaire. Je ne veux plus entendre parler de ce problème. A peine une heure plus tard, Kafungu tient un rassemblement général. Il y choisit les hommes qui l'accompagneront. A un élève il dit: - Vital, tu resteras à mes côtés pour me remettre les cartouches. Etre aux côtés de Kafungu au combat, rien de pire! Tremblant, sachant sa fin certaine, Vital Ipolo va dire adieu à ses copains du bivouac. Le lendemain à cinq heures, trois groupes se mettent en route. Bakanga dirige ses deux cents hommes sur Kinzam-ba. Il contournera Mukedi pour l'attaquer à revers. Ntsolo et Fimbo, à la tête de deux cents partisans, exécuteront le même mouvement du côté opposé. Kafungu, accompagné de cinquante combattants et disposant de dix fusils, foncera tout droit sur Mukedi. Au moment du départ, Mulele dit à Kafungu : - Je ne veux pas qu'on tue des gens de Kandaka. Il faut les amener ici pour qu'ils puissent nous parler. Quand Kafungu arrive devant la rivière Tshinyo, on lui tire dessus. Riposte des poupous et des fusils. Arrêtez, s'exclame Kafungu, ils sont trop loin, traversons! Arrivés dans la forêt, de l'autre côté, les partisans grimpent la pente qui conduit à Mukedi. Quelques-uns tombent grièvement blessés. Kafungu devance tout le monde et met le feu à la première maison de Mukedi. A ce moment, Bakanga et Ntsolo arrivent par derrière. Tout Mukedi flambe. Les villageois ont enterré des malles contenant des habits, des ustensiles et des pièces de valeur. Les partisans repèrent aisément les endroits et ils déterrent tout. Ce butin, auquel s'ajoutent chèvres et boucs, médicaments et microscopes, prend la direction de Kifusa. Une équipe de soixante partisans conduira le tout dans les dépôts aux environs de Nienkongo. Kafungu laisse deux pelotons à Mukedi et rentre à la direction. Nous sommes à la mi-avril. Quand Mulele revoit ses combattants chargés de butin et de victuailles, ils les réprimande vertement. - Ces villageois restent toujours des révolutionnaires, malgré la mauvaise influence de Kandaka. Tous les partisans de Kandaka ressortent de la direction générale. En dépit de tous les problèmes, Kandaka est un enfant de la direction. Mulele veille sur l'orientation politique. Il lui faut unir tous les révolutionnaires, le père de la révolution doit l'être pour tous les enfants. Mais le combat militaire a sa propre dynamique qu'il est difficile de maîtriser. Les partisans, tous sans expérience militaire, sont d'une nervosité agaçante au cours des affrontements et toujours à deux doigts de la panique. Si Kandaka arrive à nous battre, ce sera la débâcle pour la révolution. Il faut lui montrer que nous constituons une force. Sur le champ de bataille, nous considérons tous les gens de Kandaka comme nos ennemis. C'est normal, nous ne respectons pas non plus les biens des militaires. A cela s'ajoute le fait qu'une partie des partisans ont perdu le moral. Ils sentent les militaires dans le dos, se trouvent devant une révolte insensée, ils ne perçoivent pas un objectif valable dans ce combat qu'ils doivent livrer à Kandaka, ils ont perdu leurs points de repère. Certains se mettent à voler. D'autres prennent la fuite. Chaque soir autour du feu, Mulele fait des causeries. Parfois il laisse parler les autres, écoute leurs disputes et, en lançant quelques blagues, évite de s'en mêler. Puis il questionne, explique, argumente, raconte. Mulele, Bengila, Kafungu, Mundelengolo sont là tous les soirs. Trois femmes aussi ne manquent jamais à l'appel, Godelieve Madinga, Nelly Labut, Bernadette Kimbadi. Laurentin Ngolo, sauf s'il est souffrant, Théotime Ntsolo, Pierre Ngwensungu, Eugène Mumvudi, Valère Munzele et Maurice Zanga appartiennent au noyau de base. Lievin Mitua, Jean-Pierre Ilunga et les commandants de zone sont de temps en temps invités. Zacharie Mupembe vient lorsqu'on parle de l'affaire Kandaka. - Si j'avais été à ses côtés, les choses ne se seraient pas passées ainsi, soupire-t-il. Kandaka excite les gens. Il n'a certainement pas exposé le véritable motif de la punition de Gingombe. Quelque temps après, une longue lettre de Kandaka parvient à Mulele. L'enfant a insulté son père et il demande pardon, écrit Kandaka. Le soir, autour de feu, le camarade en chef s'entretient avec les autres dirigeants. - L'enfant égaré peut toujours revenir. Bengila, comme c'est presque toujours le cas, approuve l'idée. Ngwensungu et Ntsolo rouspètent: il mérite au moins la prison. Kafungu s'énerve: trop de gens sont morts à cause de Kandaka, on ne peut pas le laisser en vie. La palabre prend une bonne partie de la nuit. Mulele insiste pour qu'on tienne compte de la sensibilité et de la réaction des Bapen-de. Le tribalisme est une histoire délicate et compliquée. Quand Kandaka revient, il restera auprès de moi. Qu'il nous explique ce qu'est le tribalisme. Qu'il nous fasse quelques plans pour réorganiser la direction générale. Ça calmera les gens qui l'ont suivi. Ils diront: Kandaka est tout près de Mulele. Mulele rédige deux pages de réponse à Kandaka. Zacha-rie Mupembe y ajoute une note complémentaire. Peu après, Kandaka reçoit la lettre. On l'apprend par l'interrogatoire de deux Bapende qui ont suivi Kandaka. Ils l'ont quitté lorsque Kandaka a reçu une lettre de Pierre où il est dit: - Je t'attendrai les bras ouverts. Les deux Bapende se présentent devant le rassemblement général. - Nous ne voulons plus du tribalisme. Nous avons compris que c'est une perte de temps. Nous avons entendu que Kandaka a écrit une lettre dans laquelle il marque son accord pour revenir. Alors tout le monde a commencé à le quitter, on veut revenir à la direction générale. Kandaka, qui rêvait d'une révolution pour les Bapende, voit qu'une bonne partie des siens cherche refuge auprès de l'armée réactionnaire. Bientôt le lieutenant Nguya, Mupende lui aussi, ravagera la région, massacrant les partisans sans distinction, qu'ils aient suivi Kandaka ou Mulele. Peu de partisans portent un intérêt quelconque à la date du 6 juin, jour de la Pentecôte. Il n'y a que les anciens séminaristes et élèves qui constituent le clan Lankwan, pour attendre la descente du Saint Esprit avec grande impatience. Parce que, eux, ils savent ce que personne au camp ne peut soupçonner. Au réveil, une rumeur fait tendre l'oreille, puis la consternation, le branle-bas, l'agitation s'emparent du camp tout entier. De bivouac en bivouac, on transmet la nouvelle que l'abbé Lankwan, accompagné de Idiabolo, de Wendo et de Kiang, a pris la fuite, ce matin vers quatre heures. Secrètement, il était entré, depuis des semaines, en contact avec l'armée à Idiofa. Le rendez-vous devait avoir lieu ce matin. Mais une équipe de partisans de la direction aurait vu l'abbé Lankwan, en soutane, courir au devant d'un peloton de soldats. Aux tirs des maquisards, l'armée aurait pris la fuite. Lankwan était coincé. Rassemblement dans une atmosphère de surexcitation. Abo, détachée d'un pas de son peloton de filles. Mulele parle, puis Kafungu. Personne ne semble retenir quoi que ce soit de leurs paroles. La colère est trop grande, on crie: - Au poteau, au poteau! Au poteau, répète Abo. Elle ne sait pas ce que poteau veut dire, mais comprend que c'est la mort. Lankwan doit mourir, c'est tout ce qu'on veut entendre. Il y a eu beaucoup de victimes avec l'histoire de Kandaka. Et maintenant, Lankwan veut amener l'armée pour qu'elle vienne nous exterminer tous. Fimbo parle. Pas de pitié pour les traîtres. Abo quitte le rassemblement, la tête lourde d'inquiétudes, les idées en désordre. L'abbé Lankwan, nous ne lui avons rien fait, nous l'avons bien reçu et accepté dans la révolution, religieux ou pas, nous ne lui avons jamais rien dit là-dessus. Mais voilà qu'il se trouvait parmi nous avec d'autres idées, il était un ennemi caché dans nos rangs. Quand les partisans l'ont arrêté, il portait, plié sous ses vêtements, le plan de la direction. Ces gens disent qu'on ne peut pas tuer. Mais lui, il voulait que les militaires viennent nous abattre tous. Abo ressasse ces idées toute la journée. Elle ne s'informe même pas auprès de Mwadi et de Mwata, les chefs de peloton des filles qui ont participé à l'interrogatoire de Lankwan, ce matin. Distraite, elle écoute Vital Ipolo qui rentre de la prison où il a vu Lankwan, fermement ligoté, des plaies aux bras, les mains déjà paralysées. - Mon fils, je ne vivrai plus longtemps, a dit Lankwan. Tout ça, c'est à cause de l'orgueil. Mulele m'a souvent dit: Si vous arrivez dans un village et que les gens dansent à gauche, vous aussi, dansez à gauche, s'ils dansent à droite, dansez à droite. Abo connaît le proverbe. Il signifie qu'il faut suivre la masse. Samedi 19 juin 1965, la préparation de la fête de ce soir s'engage dans le rire, quelques batteurs de tam-tam ajustent le son de leurs instruments. La saison sèche a débuté, le soleil se fait insistant. Dans la rivière derrière le bataillon, beaucoup de jeunes filles prennent un bain et font leur toilette : le bal désormais traditionnel du samedi soir est un grand événement. Abo se trouve dans le bureau de la pharmacie, à trente mètres de son bivouac. Mulele vient d'entrer, au loin on entend les cris des baigneuses, tout est tranquille. C'est à ce moment qu'avec une violence brutale, un homme saute dans le bivouac. Renverse tout. Mbumpata. Le fusil à la main, il se jette sur Mulele. - C'est plein d'hommes dans la brousse. Dehors. Regarde! Derrière le camp, de l'autre côté de la rivière, sur la pente. Des hommes, beaucoup d'hommes, des dizaines, peut-être des centaines d'hommes. Ils sont vêtus d'un pagne, un sac de raphia sur le dos. Comme des villageois. Que se passe-t-il? A ce moment éclate le feu roulant des mitraillettes et des fusils automatiques. Abo se précipite vers le bivouac, Kafungu et Bengila y arrivent au même moment, chacun attrape son fusil, son sac de documents. La pagaille est totale. Les partisans fuient en tous sens. En un éclair, Abo voit Mulele, à dix mètres devant elle, indiquer de la main la direction à prendre. Des balles sifflent à ses oreilles avec un bruit sec. Elle se jette par terre, rampe, se redresse et court. Elle remarque Mulele, Mbumpata, Ngwensungu, debout, tirant des salves de mitraillette en direction des assaillants. Penchée, les yeux au sol pour ne voir ni balles, ni tués, Abo file. Nouvelle salve. Ramper. Des partisans s'arrêtent, tirent un coup de poupou à l'aveuglette, histoire d'intimider les militaires. Et fuir. Fuir entre les palmiers, les arbres, les bivouacs. Sortie du camp, Abo entend éclater les obus, tirés par les mortiers installés sur les hauteurs en direction de Gondo. Abo reprend ses esprits quand on s'arrête, à deux kilomètres du camp, sous les arbres, dans un petit ravin en pleine brousse. Elle a donc fui en direction de Luende Nzangala. Il y a là une bonne cinquantaine de partisans, dont la plupart des dirigeants, Mulele, Bengila, Kafungu, Ntsolo, Ngwensungu, Bernadette. Jetant un coup d'oeil en arrière, Abo voit monter la fumée. Les bivouacs flambent. Le soir, une centaine de personnes entourent Mulele. Il envoie Mbumpata enquêter au village de Nioka Munene sur la position des militaires et des partisans. Les filles qui prenaient leur bain sont restées figées au crépitement des balles. Immobiles, elles n'osaient pas sortir de l'eau, ne sachant pas d'où venaient les militaires. Elles se sont cachées sous les feuilles et les fleurs de lotus, abondantes à cet endroit. Le calme revenu, elles ont happé leur pagne et leur sac et se sont enfoncées dans la forêt qui longe la rivière en direction de Kinguda. C'est la retraite qu'ont choisie la plupart des partisans. Il y a eu peu de morts à Kifusa. Mais perte totale des archives et des documents. 12. 19 juin - 25 novembre 1965, A Sembo, Busi Bongo, Matende et Yassa Lokwa - Table de matières Dispersion. Une assemblée de tous les chefs d'équipe du maquis, naissance d'Ibulabit. Déplacements incessants, découragement. Des envoyés-pacificateurs arrêtés au maquis. Villages en flammes, Abo sauve Ibulabit. Cent fidèles errent dans la vaste brousse au nord de Luende N/.angala. Pas un village, pas une case en vue, se cacher cl dormir le jour pour se déplacer sous les étoiles, pas le tomps d'établir un bivouac, faut dormir sur l'herbe ou sur un pagne. Mulele envoie des émissaires à Luende Nzanga-l.i, à Mungai-Dibanda, à Mubwata et à Banda-Yassa. Ils en reviennent avec de la nourriture et quelques partisans qui y traînaient. Début juillet, la direction, qui compte à nouveau deux cents personnes, s'établit dans la brousse de Sembo. Abo voit rentrer ses copines Jeanette Kashiama et Charlotte Ntsamana, son bébé âgé de six mois sur les bras. Elles rejoignent le cercle d'une trentaine de femmes, assises, taciturnes. Le feu qui tombe du ciel vous consume plus vite quand vous n'avez rien eu sous la dent depuis deux jours. Quelques hommes arrivent: - Nous, les hommes, nous avons appris à préparer le manioc. Pourquoi les femmes ne construiraient-elles pas les bivouacs? Les femmes n'ont pas le cœur à rire. Mulele s'assoit parmi elles. - Ils se moquent de vous. La mine déprimée, les femmes restent muettes. - Les femmes, est-ce que vous êtes fatiguées? - Un peu fatiguées. - Qu'est-ce que vous pensez, maintenant que nous sommes attaqués de partout par les militaires? - Il faut encore lutter. - Mais comment pouvons-nous trouver des armes? - Par les embuscades. - Y-a-il encore une autre façon? - Si nous pouvons sortir au village, nous nous mélangerons à la population. Là où les militaires mangent et boivent, nous irons les soûler pour prendre leurs armes. - Auriez-vous le courage de le faire? - Oui. - Ah, je crois que les femmes ont trop de pitié. Quand elles voient leur enfant malade, elles pleurent déjà. Mulele cause, raconte des blagues pour remonter le moral. Et comme il n'y a pas de manioc à préparer, les femmes apportent leur aide aux hommes pour la construction des bivouacs. Elles essaiment dans la brousse, à la recherche de cordes pour fixer les branches sur les toits. Elles découvrent des lianes qui se tortillent entre les herbes et qui conviennent à cet usage. A Sembo, tout le monde se rassemble le matin et Ntsolo ou Ngwensungu commandent les exercices physiques. Le drapeau rouge a disparu et, avec lui, l'enthousiasme et l'entrain. Même quand on entonne un chant révolutionnaire, on sent l'impasse. On écoute les leçons, on recopie les cahiers, mais on ne voit plus à quoi tout cela aboutira. La nourriture manque parfois. Les villageois eux-mêmes éprouvent des difficultés à se ravitailler dans les champs de manioc, à cause de la présence des militaires. Des partisans commencent à voler de quoi vivre. Mulele donne une leçon sur la discipline. - On vous envoie à la guerre pour tuer les ennemis ou pour les arrêter et les amener au camp, ou encore pour confisquer leur fusil. Il faut s'arrêter à l'endroit qu'on vous a indiqué. Si on vous envoie là-bas et que vous attrapez des chèvres puis que l'ennemi vous prend, qu'allez-vous dire? Heureusement, on trouve dans la brousse, en saison sèche, un fruit sauvage que les villageois appellent akwoki. Après avoir brisé sa coque extrêmement dure, on peut en manger les graines. Au moment où la direction générale se reconstitue grâce à l'arrivée quotidienne de petits groupes de partisans et ce dans le climat morose que l'on sait, les forces vives du maquis se regroupent non loin de là. En effet, début juin déjà, des équipes de partisans des zones les plus éloignées,-Sedzo, Buluem et Nkara -, avaient pris la route pour la direction générale, située alors à Kifusa. Tous les chefs politiques et militaires des équipes et des sous-directions, ainsi que tous les présidents des comités de village, étaient convoqués chez Mulele. En route l'équipe d'Ibubu a rencontré l'abbé Eugène Biletshi au village Musanda Siki-siki. Au moment même où il annonçait à ses visiteurs la trahison suivie de l'exécution de l'abbé Lankwan, l'abbé Biletshi a été appelé pour baptiser un nouveau partisan: sa sœur venait d'accoucher d'un petit garçon. Drôle d'époque pour les abbés compagnons de route. Le 18 juin, tous les invités de Mulele s'étaient retrouvés à Kifusa pour un premier entretien. Le lendemain, au moment des retrouvailles, éclataient les coups de feu des militaires donnant l'assaut de la direction. Il a fallu une bonne semaine pour que tout le monde soit revenu sur ses pas et se regroupe au sud de Banda-Yassa. Mulele y prend longement la parole. - Nous sommes à un tournant décisif de la révolution. Il faut le dire, nous constatons une grande faiblesse chez nos combattants, un manque d'initiative et de mordant dans la lutte armée. La raison en est la sortie d'une partie importante des villageois et la fuite de certains partisans qui livrent aux militaires des informations sur nos positions, notre équipement et nos tactiques. Nous devons punir les trahisons et rehausser notre morale révolutionnaire. Vous devez constituer des équipes combatives, capables d'attaquer à tout moment. Désormais, aucune équipe ne devra rester longtemps à un même endroit. Il faut être mobile, se déplacer dans toutes les directions, chercher à tout prix à surprendre les militaires dans des embuscades. Les sous-directions qui comprennent des équipes de quatre à cinq cents partisans devront diviser celles-ci en unités plus réduites. Nous connaissons les difficultés qui frappent les villageois. Les militaires ont calciné la brousse et les champs de manioc dans les secteurs Musanga, Kanga, Lukamba, Madimbi et beaucoup d'autres et les gens ne peuvent plus survivre. Alors je demande de la bonne volonté aux autres villages : accordez une partie de vos forêts à ceux qui ont été frappés. Dans les villages, il faut aussi enlever et cacher les tôles des maisons construites en pierres, pour que les soldats ne puissent pas y trouver gîte. Après sept jours de formation politique et militaire, toutes les délégations retournent dans leurs bases, leur volonté de lutte raffermie. Une petite surprise attend Mulele a son retour à l'état-major général. Monique Ilo vient lui fourrer un bébé dans les bras. L'enfant de Monique est gros, bien portant, les yeux tout grands. Lorsque Mulele le soulève, il dit: - Tiens, tiens, que c'est bizarre, cet enfant a des yeux aussi grands qui les miens. Monique a accouché à Matende, la mère de Mulele à ses côtés. Les militaires circulant librement dans les villages, elle a vécu dans l'inquiétude constante de se voir embarquer. Son bébé n'avait qu'un mois lorsque Monique s'est mise à vagabonder dans la brousse de Malele-Mobikai. Hier, Abo a aperçu sa silhouette s'approchant lentement du camp de Sembo. Mulele demande à Monique et à Léonie quel nom elles donneront au bébé. - Décide toi-même comment l'appeler. Mulele penche d'abord pour le nom Nguts dont la consonance révolutionnaire lui plait beaucoup. Nguts, la bataille, tout un programme pour commencer une vie. Mais finalement, il se décide pour Ibu la bit, au milieu de la guerre. L'enfant né au milieu de la guerre. Ibulabit, quand il aura grandi, se rappellera toujours cette révolution qui a transformé les gens jusque dans leurs noms. Dans les villages, les jeunes mères appellent leur fils Etum, la lutte, Nguts, la bataille, Bit, la guerre, Esash, la balle. Le 7 août, des villageois signalent la présence de militaires dans la région. Il faudra descendre au sud. Mais, comme il n'y a que trente-cinq kilomètres entre Sembo et Idiofa, un groupe de jeunes filles préfèrent rentrer chez leurs parents. Parmi elles, Eulalie Fam, Jeanette Kashiama et Charlotte Ntsamana avec son bébé. Eulalie dormait dans le bivouac de Mulele. Albinos, avec une peau blanche parfaite, sans tache, elle porte comme un halo de mystères. Une personne ndundu ne meurt pas et elle apporte la chance dans la famille. Avec son départ, la chance abandonnera-t-elle le maquis? Une longue colonne - il doit y avoir trois cents partisans maintenant - marche pendant cinq heures à travers les hautes herbes vers le sud jusqu'aux environs de Busi Bongo. Le surlendemain, des soldats entrent dans cette localité. Par mesure de précaution, les partisans évacuent temporairement le camp pour se cacher dans la petite forêt bordant la rivière Mobi. Mayele règne toujours, de façon plus ou moins indépendante, sur son fief avec ses cent trente femmes, situé maintenant à Dibanda. Dernièrement, il est venu se plaindre auprès du commandant en chef: Mukama, homme marié, s'apprête à prendre une maîtresse. Il ne m'obéit plus et il ne veut pas aller à la guerre. Il faut le mettre en prison. Mulele et les dirigeants tiennent une palabre qui prendra la nuit entière, à propos de cette affaire. Les dirigeants s'efforcent de dénouer le noeud fait d'intrigues, de galanterie et de lâcheté. Voilà un sujet sur lequel doit plancher un chef de guérilla au Congo. Les jours suivants, Mulele se promène en solitaire dans la brousse, à la recherche des mandata, les feuilles de palmier dont on couvre les bivouacs. Puis le commandant en chef est appelé pour une urgence. Les villageois de Kim-bembele réclament sa présence pour trancher la dispute entre deux prétendants au poste de chef de village. A son retour, Mulele plie sous le poids de la viande de chèvre et de cochon que les villageois lui ont offerte. Il y a une éternité que les partisans n'ont plus goûté à un bon repas. Mulele se réserve une grande calebasse de vin de palme. Abo possède dans sa trousse médicale une boîte de saccharine. En jetant dans la calebasse un ou deux de ces comprimés, le vin de palme peut se conserver pendant quatre jours. La vie du camp s'anime un peu, chaque jour des partisans égarés rejoignent le groupe, la cuisine se remet en marche, le bataillon sonne le rassemblement de ses troupes, on reconstitue les bureaux, même s'il n'y a rien à faire. Les rapports des sous-directions ne rentrent qu'au compte-gouttes, beaucoup de liaisons étant coupées. Dans le bureau d'Abo, peu de malades s'annoncent. Louis Kafungu ne se sent pas à l'aise au milieu des pensionnés, des fugitifs, des fatigués en fausse convalescence. Il a appris par les rares messagers que Laviwa à Buluem, Ndabala à Ibubu, Menaba à Nkara et Fimbo à Kilembe continuent à mener des attaques vigoureuses contre les militaires. Il veut rappeler ces commandants qui savent dresser et diriger les hommes. Qu'ils réveillent un peu tous ces gens endormis. Mulele refuse. Laisse-les mener le combat chez eux, ils y connaissent les hommes et les lieux. Le dimanche 22 août, les gardes entendent des coups de fusil à Mobikai. On évacue le camp, puis on y rentre à la tombée de la nuit sous une pluie torrentielle. Début septembre la direction effectue un long déplacement, traverse la rivière Labue et s'établit dans la brousse du village natal de Pierre Mulele, Isulu Matende. - Est-ce que ça continuera toujours comme ça? - Il se peut que ça continue. Nous ne pouvons pas exclure que notre révolution connaisse l'échec. Mais à l'avenir, d'autres la reprendront. La révolution ne chemine pas calmement, tranquillement vers la victoire. Les révolutionnaires seront menacés, ils souffriront, je vous l'ai toujours dit. Vital Ipolo, né à Matende, que le retour dans son village natal a rendu nostalgique, pense qu'on tend vers la fin. Il le dit à Abo. - Tu sais, Vital, lui répond-elle, le camarade a toujours dit que la révolution sera un travail de longue haleine. En Chine, c'était ainsi: lutte et échec, recommencement et nouvel échec, nouvelle lutte jusqu'à la victoire. Je n'ai jamais rien compris à ça. Mais maintenant, Vital, nous voyons que Pierre avait prévu ce qui arrive. Innocent Kimbombi aussi ne voit plus l'avenir. - Nous sommes fatigués avec ce problème de la révolution. Qu'il retourne en Chine et revienne plus tard avec des fusils et des munitions. Nous resterons un peu tranquilles et nous recommencerons plus tard. Mulele essaie de contrer cet état de fatigue morale par un proverbe:
Moi, j'ai amené l'esprit de la révolution et je l'ai mis dans une calebasse; même si elle se vide, même si elle se casse, les idées de la révolution resteront toujours. Certains sont déjà fatigués, même si notre lutte ne dure que depuis deux ans. Ne pensez pas que vous aurez la vie plus tranquille en vous réfugiant auprès de l'armée. Partout où le gouvernement réactionnaire imposera sa volonté, vous souffrirez doublement. La souffrance s'aggravera aussi longtemps que durera ce gouvernement vendu aux étrangers. Delphin Muzungulu et Valère Munzele perdent patience au milieu de tous ces bureaucrates obsédés par une seule préoccupation: éviter le combat. Ils demandent au camarade en chef de pouvoir rejoindre leur ancienne sous-direction, là-bas les équipes ont gardé du mordant. Ils quittent le camp, ressuscites. Le jeudi 24 septembre, des militaires arrivent à la mission d'Iwungu Matende, d'où ils tirent quelques coups de fusil. Les partisans se retirent sur la montagne et Ntsolo, entouré d'une équipe de choc, part affronter les soldats. Mais ceux-ci, considérant leur devoir accompli après les tirs symboliques d'usage, foncent déjà en direction de Kimpata Eku où ils tiennent garnison. Le soir, Théophile Bula-Bula rentre d'une expédition chez les Bayanzi. Peu après, une mission de pacification, conduite par Philé-mon Wolo, arrive à Isulu pour convaincre les villageois de sortir du maquis et de se placer sous la protection de l'armée. Mais, comme le hasard fait parfois bien les choses, au lieu de sortir les gens, les émissaires entreront eux-mêmes au maquis. Sous la contrainte. En effet, les villageois s'emparent des pacificateurs pour les conduire chez les guerriers. Mulele leur demande: - Vous voulez faire sortir les gens, mais qui les a poussés dans la forêt? - Les partisans. - Vous croyez? Restez un peu ici et vous verrez. Le lendemain, ayant appris le triste sort des pacificateurs, l'armée vole à leur secours. Des soldats venant de Bwalenge arrêtent quatre villageois. Ils entreprennent une vague attaque en direction du camp. Les partisans quittent l'endroit, fuient vers Malele. Puis les soldats tombent dans une embuscade organisée par Mulele et Ntsolo. Les militaires prennent la fuite, laissant sur le terrain les cadavres des quatre villageois. Les partisans passent la nuit sur la montagne pour retourner le lendemain au camp dans la brousse. Les peureux ne rentrent que vers midi. Mais devinez qui a galopé sur la plus longue distance? Eh oui, la vaillante mission des pacificateurs. A bout de forces, elle rentre l'après-midi chez Mulele. - D'où venez-vous? Vous êtes allés sortir les gens? - Non. - Vous avez vu les militaires? - Oui. - Et entendu siffler les balles? - Oui. - Et les balles, est-ce qu'elles cherchaient tout le monde ou seulement moi? - Chef, vous avez raison. - C'est ainsi que nous avons commencé la lutte. La terreur et les méfaits des militaires ont poussé les villageois en forêt. Moi, je n'y étais pour rien. Restez maintenant chez nous, nous allons vous éduquer. Mais perdus, désespérés, malades autant dans la tête qu' au ventre, les pacificateurs qui versent quotidiennement des larmes et se lamentent: on va mourir, reçoivent bientôt la permission d'aller raconter leurs misères à leurs commanditaires. D'étranges foces de la nature viennent parfois en aide à celles, faiblissantes, des maquisards. Ainsi, elles ont expulsé du ciel un avion ennemi qui s'est écrasé au sol entre Banda Papi et Gomena. Les villageois en retirent immédiatement tout ce qui peut avoir une utilité quelconque: une mitrailleuse lourde, des balles, un parachute. Et ils amènent leur trophées à la direction. Mbumpata et Okwono vident les balles de leur poudre qui servira aux poupous. La splendide mitrailleuse pèse trop lourd pour être traînée par monts et par vaux dans une galopade quasi quotidienne. Malgré la supériorité écrasante acquise par l'armée, l'osmose entre villageois et partisans reste parfaite. Chaque fois qu'un militaire apparaît à l'horizon, des villageois de Matende courent dans la brousse en criant: - Awi ho ! Ce même message, ils le communiquent aussi par tam-tam ou, plutôt, par nkwil, un tronc d'arbre creux en bois très dur, muni d'une longue fente sur laquelle on frappe avec deux bouts de palmier. Un jour que le nkwil annonce que le danger est imminent, les partisans quittent la brousse, descendent la vallée de la Labue et passent de l'autre côté. Amusés, de six heures du matin jusqu'au coucher du soleil, ils suivent le concert rythmé d'un feu roulant. Quand, par après, ils entendent à la radio que l'armée vient de vider les dernières poches de la résistance, tous éclatent de rire. Le rire? On croyait l'avoir désappris après des semaines d'incertitude, de tension et de désœuvrement. Début novembre, les pluies s'acharnent sur les brous-sards, tout le monde s'affaire à renforcer la toiture de son bivouac. Mulele part avec une équipe jusqu'à Malele. Quand ils entrent dans ce village, ils apprennent que les militaires viennent à peine de le quitter. Un villageois tient encore à la main le drapeau blanc de reddition. Le porte-étendard, arrêté par Mulele, mine déconfite, traîne des pieds jusqu'au camp de Matende. Le 15 novembre, des militaires envahissent le bivouac évacué à la hâte. Ils s'emparent de la mitrailleuse désœuvrée, délabrée, ancienne gloire décrépite. Mais elle témoignera d'une grande victoire militaire sur les rebelles. Les maquisards, partis jusqu'à Yassa Lokwa, rentrent au moment où le soleil s'endort dans des draps d'un rouge éclatant. La nuit suivante, les partisans quittent le camp de Matende sulu en tirailleur et continuent le chemin en formation dis-Dersée jusqu'au sud de Yassa Lokwa, à Impiti-Entsum. Ils descendent deux jours plus tard à Imbongo-Lokwa où ils prennent demeure à l'ancien emplacement du village. On prend du manioc dans le champs des villageois. La révolution l'interdit. Mais les villageois, traqués eux-mêmes par les militaires, ne peuvent plus venir nourrir les partisans que la faim commence à tarauder. Des coups de fusil font tourner les yeux du côté de Matende, où plusieurs colonnes de fumée noire montent dans le ciel: les cases de plusieurs villages Matende flambent à nouveau. Cette fois-ci, la brousse environnante a pris feu, un nuage sombre efface la lumière du matin. Les villageois ont dit à Mulele: - Ils peuvent brûler dix fois nos cases, aussi longtemps que nous avons des mains, nous les reconstruirons le lendemain. Les militaires entrent au village Imbongo-Lokwa,. les partisans remontent la rivière Kamtsha jusqu'au nord de Nien-kongo. La fille de Théophile Mbuku, qui est à côté d'Abo, apprend que les soldats viennent d'arrêter son père à Iwun-gu. La nouvelle effraie Monique Ilo, toutes les mauvaises nouvelles l'épouvantent, elle n'a de pensées que pour Ibu-labit qu'elle nourrit au sein, mais est-ce qu'il survivra au milieu de la guerre? Monique a vu dans les villages des mères anémiques, épuisées, poussées par le désespoir, abandonner leur bébé dans la brousse. Abo, moins ébranlée, s'occupe d'Ibulabit. En déplacement, Abo marche devant, l'enfant noué dans le pagne sur le dos, la mitraillette sur l'épaule droite. Monique la suit et porte son sac. Ibulabit se met à hurler, Abo le secoue, Ibulabit crie deux fois plus fort. - Ferme sa bouche. Les militaires viendront nous tuer. - Beta ye moto na nzete. Monique pleure, elle tremble, non, il ne faut pas tuer l'enfant. Léonie ne dit rien, continue sa marche. 25 novembre 1965. La radio annonce que le Congo a un nouveau chef d'Etat. Il s'appelle Joseph-Désiré Mobutu. Hier, l'armée a pris le pouvoir. Ebebi, ebebi, dit Mulele, ça va mal, très mal. Le commentaire de Théo fait le tour du camp. - Le loup se couvre d'une peau d'agneau pour pouvoir nous approcher et nous surprendre. 13. 26 novembre 1965 - 19 mars 1966, Dans le Labwak, entre Sembo et Ingietshi - Table de matières Le coup d'Etat de Mobutu. La famine dans le Labwak, terreur dans les villages. Déplacements incessants, fuite de partisans. Attaque de l'armée et dispersion finale de la direction générale. Séparation avec Kafungu. Répartis sur deux colonnes, les partisans quittent Nien-kongo pour établir leurs bivouacs à la source de la rivière Sembo. Des biets, de petits arbres qui poussent en bosquet, s'y dressent, présentant un camouflage parfait pour les bivouacs. La direction restera deux mois dans cette brousse, passant d'un endroit à l'autre en un incessant carrousel. De-ci de-là, des obuots solitaires pointent un long doigt vers le ciel. Les cimes de ces grands arbres, hautes de dix mètres, deviennent invariablement des postes de guet. Mulele tient conseil avec tous les dirigeants du bataillon et de l'état-major général pour relancer les opérations militaires. En attaquant l'armée à différents points, il sera plus difficile aux soldats de repérer le camp central. Mumvudi part avec l'équipe de Buzimbila-Yassa pour opérer contre l'armée à Sembo et Banda-Yassa. Début décembre, devant 300 militants, Mulele donne une leçon politique sur les bouleversements politiques récents à Kinshasa. Dans son cahier, Abo en a consigné quelques idées. - L'armée est maintenant au pouvoir. Mobutu, qui est-il? Quand il était avec Lumumba, c'est l'impérialisme qui se trouvait derrière lui. Il nous a toujours combattus, il continuera à nous faire la guerre. Tu entres dans la forêt avec ton chien pour chasser les animaux. Le chien amène le gibier. Mais est-ce que le chien va te diriger? L'armée n'est que le chien de l'impérialisme. Il ne faut pas avoir de faux espoirs. Mobutu est un surveillant de l'impérialisme. Il veille sur toutes les richesses dont disposent les étrangers blancs. Mobutu n'est toujours que le chien de l'impérialisme et le chien ne commande pas au maître. Il travaille comme un capita sous les ordres du Blanc. Un autre jour, Mulele développe ces idées. - Il y a des centaines d'années, avant que les Blancs ne viennent nous opprimer, nos ancêtres fabriquaient des couteaux, des casseroles et des houes, ils savaient produire le cuivre et ils en faisaient le commerce jusqu'en Afrique de l'Ouest. Quand les Blancs sont arrivés ici pour la première fois, ils ont dit que les nègres possédaient beaucoup de richesses et qu'ils étaient intelligents. Ces nègres vont s'occuper de leurs richesses et nous ne pourrons pas les prendre. Alors, les colonisateurs ont commencé à offrir beaucoup de cadeaux au roi des Bakongo et ils l'ont converti à leur religion chrétienne. Ensuite, ils ont amené beaucoup de choses qu'ils ont mis en vente dans les magasins. Avec tout ça, ils poursuivaient un but. Ils voulaient empêcher que les Noirs développent leur intelligence. Donc, il y a toujours eu de mauvais chefs qui se laissaient corrompre par les Blancs, qui adoptaient leur religion et qui acceptaient que les Blancs viennent vendre ici tous leurs produits. C'est ainsi que nos ancêtres ont perdu, petit à petit, leur intelligence. Maintenant nous faisons la lutte pour que le pays appartienne aux enfants du Congo, pour que nos richesses servent la population, pour développer à nouveau notre intelligence et pour construire notre pays. Bien sûr, camarade en chef, nous voulons développer notre intelligence, mais entre temps, nous n'avons rien à manger. Les partisans remplissent leurs jours en traquant, non pas l'armée mais la faim. Parfois ils ne trouvent plus l'occasion de bouillir les feuilles de manioc. Mais on ne peut pas les manger crues. Les partisans enterrent les feuilles, enveloppées dans du papier, pendant deux jours, pour qu'elles soient adoucies par le premier pourrissement et aptes à la consommation. Impossible aussi de préparer le foufou. On ne peut plus laisser tremper le manioc dans l'eau. Hommes et femmes râpent le manioc cru, puis le sèchent au soleil. La farine ainsi obtenue, versée dans l'eau chaude, donne une pâte incolore et fade. On réduit de la même façon des carottes en poudre, ça donne le kabanga, amidon blanchâtre dont la consommation donne des vertiges. Survivre jusqu'à demain, sans savoir où aller, ayant perdu tous les points de repère, se traîner jusqu'au jour suivant qui amènera peut-être l'attaque et la mort. Sur cette grande brousse entre Luende Nzangala, Sembo et Malele, marchent des hommes et des femmes au visage pâle, d'un ton gris, les mains et les pieds à la peau blanchie, atteints d'anémie. Labwak, c'est la couleur pâle de l'anémie. Et à cette brousse infinie où ils ont connu la faim, la misère et l'insomnie, les partisans donnent le nom de Labwak.Connaissant eux-mêmes la privation, les partisans voient affluer au camp des centaines de villageois affamés. Ils rapportent que huit cents militaires sont arrivés dans la région pour ratisser la brousse. Ces soldats sèment la terreur dans les villages. Un homme de Lukamba Bozombo arrive au camp. Il y a quelques jours, des centaines de villageois ont été sortis de la brousse par les militaires et réunis à Lukamba Bantsamba. Devant tout le monde, les militaires ont coupé le pouce et l'index d'Ebangen, le chef d'équipe de Lukamba Misadi pour qu'il ne puisse plus tirer au pou-pou. Puis les soldats ont appelé quatre hommes de Banda Butindi. Nous tous, nous avons dû chanter et taper des mains. Personne ne devait pleurer, crier ou tourner la tête: les militaires se tenaient derrière nous, le doigt sur la gâchette. Un soldat a ordonné aux quatre hommes de mettre leur pied sur un tronc d'arbre. Puis, sa machette, comme le tranchoir du boucher, s'est abattue sur une jambe. Hurlement d'une bête égorgée, mouvements convulsifs des membres. Le soldat a remis la jambe ensanglantée sur le billot, un deuxième coup et le pied est tombé dans l'herbe. Quand la scène s'est répétée quatre fois, les militaires, en braquant leurs fusils sur les estropiés, ont crié qu'ils devaient se sauver. Sautillant sur un pied, les malheureux se sont hâtés de disparaître dans la brousse. Le vaillant "chef de troubles", Louis Mayele, rentre au camp central à la tête de ses trois cents vacanciers. Le camarade en chef l'a rappelé de sa villégiature à Busi Bon-go. Depuis plusieurs semaines, les militants se sauvaient un à un de son campement pour retourner chez Mulele. On construit un nouveau bivouac auprès de quelques minkoso, des arbres dont les feuilles abritent des chenilles succulentes. Malheureusement, la saison des chenilles n'est pas encore arrivée. La famine ne lâchera plus les partisans. 28 janvier, la direction se déplace pour un endroit appelé Makanga, le camp du désert. Les partisans sentent leur corps carboniser sous les flammes qui, ruisselant du firmament, leur lèchent la peau et effacent le monde d'une réverbération qui délave toutes les couleurs. La fournaise. Le désert. Le purgatoire sur terre. Le soir, quand le mouvement des membres redevient possible, les partisans creusent, à l'aide de machettes et de houes, de petits puits, comme des tombes peu profondes. Un demi-mètre, juste assez pour s'y enfouir. Par-dessus, on aménage un écran avec des branches, des feuilles et des herbes. La journée, chacun rentre dans sa tombe où l'air est un peu moins torride. Kafungu et Bengila emmènent la moitié des partisans attaquer les militaires à Buzimbila-Yassa. Ils les poursuivent jusqu'à Sembo où ils les harcèlent pendant de longues heures. Le lendemain, on entend à nouveau des coups de fusil à Sembo. Mulele s'y dépêche mais trouve le village en flammes, les militaires s'étant déjà retirés sur Buzimbila. Deux gardes de la direction générale ont pris la fuite. Comme ils connaissent tous les campements dans la brousse de Sembo, il faut disparaître, et vite. Le 3 février, les partisans se trouvent déjà à vingt kilomètres de Sembo, aux environs de Malele. Mulele réunit les principaux dirigeants, Kafungu, Bengila, Mundelengolo, Maye-le, Bula-Bula et Wavula pour réfléchir à la relance de la lutte armée. Comment attaquer les militaires qui ont choisi Lukamba comme base d'opérations? A 9h30, on entend des coups de fusils au village et on y dépêche Kafungu et Bengila. Ils reviennent, accompagnés de villageois qui apportent de la nourriture. Le lendemain, le rassemblement du matin, - un millier de personnes désormais -, se disperse au crépitement d'armes à feu. Un groupe du bataillon riposte, tandis que la majorité se retire sur la montagne. Vers une heure, les dernières balles se meurent. Les militaires sont terrorisés par l'idée de devoir affronter les partisans. Ils craignent surtout les flèches qui tuent en silence. Alors, dès qu'ils pénètrent dans la brousse, ils tirent à l'aveuglette, le bruit fracassant raffermit leur courage. Les hommes du camp central, eux aussi, évitent tout affrontement. Dès le premier coup de fusil au loin, la masse des "fugitifs" se retire dans la direction opposée et deux douzaines de dirigeants restent au camp pour protéger leur retraite. L'armée a mis le village Yassa Lokwa à sac, des colonnes de fumée en témoignent. L'après-midi, Eugène Mumvudi conduit un groupe de dirigeants à Banda-Yassa pour une attaque surprise contre la garnison. Les partisans descendent jusqu'au centre du triangle Malele-Nienkongo-Ingietshi, à la source de la rivière Nsie-min. Dans la colonne qui se déplace sur le labwak, un garçon commence à trembler, s'affaisse, le corps trempé de sueur. Deux partisans le portent. Il n'est pas malade, mais épuisé, miné par la faim. Heureusement, on trouvera du manioc dans la Nsiemin. Le jour après, au moment du rassemblement, des coups de feu éclatent vers Nienkongo. Kafungu conduit une équipe en direction du danger. Au rassemblement, Mulele donne une leçon politique. - Vous avez maintenant entendu siffler les balles et connu la faim. Quand je l'ai prédit au début, vous ne m'avez pas cru. Toute révolution passe par des hauts et des bas, connaît le chaud et le froid. Certains ont pris la fuite, mais les militaires les ont attrapés et mutilés. Cela veut dire que nous devons toujours penser à la lutte et ne jamais relâcher la volonté de combattre. Lors de l'attaque à Kifusa, certains ont jeté leurs fusils et leurs poupous. Maintenant vous avez les mains vides mais les militaires continuent à vous massacrer. Un partisan ne se sépare jamais de ses armes. Le mercredi 16 février, on traverse la rivière Labue pour s'installer non loin d'Itunu. C'est à ce bivouac qu'on constatera, le samedi 19 février, que le responsable de la sécurité, l'abbé Tara, a pris la fuite au cours de la nuit. Tara était un révolutionnaire convaincu, mais la famine a eu raison de sa volonté. Par affection pour ses deux petites sœurs et dans l'espoir de les sauver, il est sorti de la brousse avec elles. Dans un mouvement de panique, les partisans retraversent la Labue pour circuler dans la brousse entre Malele et Ingietshi. Ces dernières semaines, ils apprennent de temps à autre le départ de quelques partisans, affaiblis par la faim, la maladie et la tension nerveuse. D'autres, comme la camarade Mpits, perdent le contact avec la direction lors d'une attaque. - Le révolutionnaire, dit Mulele, doit passer par des épreuves. Maintenant nous pouvons reconnaître les bons militants. Désormais, les rassemblements généraux se font rares, ils ont lieu le plus souvent le soir pour vérifier s'il n'y a pas eu de désertions au cours de la journée. Alerte. Tous les partisans quittent le camp. Les dirigeants armés de fusils automatiques y restent. Au nord, tout l'horizon se noircit: les militaires mettent le feu à la brousse de Malele. Seule l'humidité de la nuit tombante éteindra les flammes. Le lendemain, on dépasse la zone carbonisée pour atteindre la source de la Lokwa, au nord de Malele. Les déplacements se succèdent. Nouvelle alerte. Marche de nuit après une journée de chaleur étouffante. Les partisans traversent un marais, osop en kimbunda, pataugent dans quinze centimètres de boue. De temps à autre une mare d'eau. Un partisan s'agenouille, il n'en peut plus, la soif l'étrangle. Mulele le suit: - Nous t'avons dit qu'il faudra apprendre à supporter la faim et la soif. Si tu bois cette eau pourrie, tu mourras. Le matin, les partisans constatent qu'aux bords de Vosop, là où le sol commence à sécher, des ampfuls sortent de la terre. Des vers blancs d'une taille de deux centimètres qu'on fait bouillir dans de l'eau avec un peu de sel indigène. A sept ans, pendant les vacances, Abo et toutes ses copines allaient récolter des ampfuls pendant que les mamans travaillaient aux champs. Au retour, à l'heure du crépuscule, elles chantaient en courant: les garçons du village auraient pu leur chercher noise et leur enlever la nourriture. Mabiungu, qui sur instruction du féticheur ne mangeait pas de viande, raffolait d'ampfuls. Si tu n'as pas de fille, tu ne mangeras pas d'ampfuls, dit la sagesse populaire. J'avais sept ans alors, médite Abo; et maintenant, Mabiungu est-elle encore en vie? Le 3 mars, un partisan prend la fuite pendant la nuit et rejoint les militaires à Mobikai. A l'aube, au moment où le camp dort encore, retentissent des coups de fusils. Tous sursautent, happent en vitesse leurs sacs à dos et leurs armes et courent. Mulele, Kafungu, Ntsolo, Bakanga, Mbumpata et les autres dirigeants restent en arrière, montent sur une petite colline d'où ils tirent vaguement en direction des assaillants. Ceux-ci poussent une pointe jusqu'au bureau de contrôle et aux premiers bivouacs qu'ils saccagent avant de se retirer. Les partisans descendent à nouveau vers Ingietshi. Deux jours plus tard, les soldats mettent le feu aux cases du village. Les maquisards reviennent vers le bivouac dit Makanga où les militaires surgissent deux jours plus tard. Fuite dans tous les sens. Quand le calme s'est rétabli, Mulele retourne au camp et aperçoit papa Pascal Mundelengolo, fuyant par enjambées de girafe dans le sens opposé, la poitrine en avant, les yeux fixés sur l'horizon. - Où est-ce que tu cours avec ces sauts de gazelle? - Je fuis. - Toi, un comédien-né, tu nous fais rire. Mais dis-moi, où est ta femme? - Ce n'est pas le moment de parler de cela. - Et les masses populaires, où sont-elles maintenant, Pascal? - Où voudrais-tu que je les trouve? - Il faut continuer les leçons politiques. - Il ne fait pas encore assez calme. - Mais qui fera le calme? Toi aussi, tu es un partisan. - Ah, camarade en chef, je sais que tu es encore en train de me faire l'autocritique. On se déplace vers le sud d'Ingietshi. La nuit, Abo ne dort plus une demi-heure d'affilée. Même dans son sommeil, elle est agitée par des pensées affolées, ses oreilles captent le moindre bruit. La journée, le sang bat des mesures de douleur dans la tête, le picotement dans les yeux ne cesse plus. Trop épuisée, Abo marche comme une somnambule. Sur l'immense étendue du labwak, entre Malele et Luende Nzangala, circulent de petites équipes de partisans, croisant parfois des groupes qui leur ressemblent, des pelotons de militaires. Chaque fois que des partisans prennent la fuite, ils risquent de se ruer sur les fusils de l'armée. Le 11 mars, le camp central se déplace en deux colonnes distinctes. Pendant une semaine, il bouge constamment entre les sources des rivières Mobi et Masamanga. Le samedi 19 mars, la direction se trouve près de la source de la Labue, à sept kilomètres de Mukulu, le plus grand village mbuun. Quelques centaines de ses habitants ont suivi le vieux chef Ngambuun, le père de Gabriel Yumbu, au camp de Mulele qui ressemble maintenant à un énorme marché tropical en pleine brousse, plus de mille cinq cents personnes. Abo a pitié du gros Ngambuun. Qu'il est loin le temps où il trônait majestueusement sur son tipoy, entouré de ses trente femmes. Ses femmes ne sont plus là et Ngambuun n'a plus rien à manger. Vers dix heures, accompagné de trois partisans, Mulele grimpe sur une petite colline pour y guetter les déplacements des soldats. Mais il leur y est offert une scène aussi inattendue que déchirante. Des militaires attaquent et dans une panique indescriptible, les centaines de partisans et de villageois courent, trébuchent, tombent et fuient dans toutes les directions. Le chef Ngambuun s'effondre mortellement blessé. Pendant toute la journée, Abo entendra tonner des coups de fusil, tantôt en face, tantôt derrière le dos, un moment à sa droite, une minute plus tard à sa gauche. En courant dans une vallée en direction de Masamanga, elle croise des partisans qui fuient en sens inverse. Les uns après les autres, de petits groupes en cavale se cramponnent à Louis Kafungu: derrière le grand guerrier, on se sent moins à la merci du premier soldat venu. Au crépuscule, Abo se trouve dans une longue colonne qui suit Kafungu dans une marche forcée en direction de Dibanda et Luende Nzangala. A leur droite monte une fumée noire et bientôt la colonne est entourée par le crépitement des flammes dévorant les herbes, hautes de deux mètres à cet endroit. Les partisans fuient sur une pente qui n'a pas pris feu et foncent, longeant les longs étendards flamboyants et rouges. Une petite rivière les sauve. Abo traîne à la queue de la colonne, ne voulant pas s'échapper de ce côté-là. Elle sait que Mulele ne part jamais loin de l'endroit attaqué, il décrit un cercle et revient toujours au point de départ. Avec Ntsolo et une trentaine de partisans, elle décroche et retourne sur ses pas. Elle marche toute la nuit, ne s'arrêtant que de brefs moments pour reprendre haleine. Elle sursaute chaque fois que des flèches rouges montent dans le ciel. Des groupes de militaires circulent dans la brousse et tirent des flèches incandescentes. Tac tac tac, le cri sec d'un fusil, cent mètres à sa droite. Fuir, mais dans quelle direction? Les soldats qui ont tiré sont tout aussi effrayés par l'obscurité. Eux aussi prennent la fuite. I ,v. matin, le groupe d'Abo entre dans la forêt qui longe la rivière Labue. De nombreux villageois de Mukulu, Ingietshi <>t Malele y errent, hagards ou à bout de nerfs. Des partisans aussi. Certains veulent suivre Abo. Elle retrouvera certainement Mulele. D'autres disent non, si nous sommes arrêtés on sa compagnie, nous mourrons avec elle. Coupés de Mulele, les partisans perdent toute tranquillité d'âme. Que faire? Où aller? Qu'arrivera-t-il? Derrière Mulele, le partisan se sent vivre; sans Mulele, il se sent mourir. Abo n'a qu'une seule idée: retrouver Mulele, si les militaires me prennent, c'est la mort. Abo entend des coups de fusils, les militaires ratissent la petite forêt. Ibulabit rappelle sa présence "au milieu de la guerre". Face au danger, il hurle à fendre le cœur. Beta ye na nzete. A voix basse, la terreur dans la gorge, on souffle: tape sa tête contre un tronc d'arbre. Beta ye na nzete. Monique au bord de la crise de nerfs. Abo essaie de la calmer, nous retrouverons Mulele, viens. Fuite dans les hautes herbes au dessus d'Ingietshi. La nuit elles s'assoient. Pas dormi ni mangé pendant deux jours. Mais elles ne ferment les yeux qu'à moitié, sur le qui-vive, prêtes à sursauter à la moindre alerte. L'aube pointe. Dans la première lumière brumeuse, Abo constate qu'elle se trouve à vingt mètres de la grande route Ingietshi Nienkon-go. Si un peloton de militaires avait passé par là... On change de direction, traverse la Labue, monte vers le nord à travers la forêt, vers Matende. Encore une journée sans nourriture. La peur domine la faim. Par miracle, cinq hommes découvrent du manioc dans la rivière, mis à l'eau par des villageois. La faim, redoublée à la vue de la nourriture, les aveugle. Au moment où ils retirent le manioc de l'eau, des soldats leur pointent un fusil dans le dos. Le quatrième jour de cette marche ininterrompue, Abo et Ntsolo progressent, par un sentier de brousse, d'Itunu vers Malele. Un guetteur, au loin sur un arbre, les remarque. Une heure plus tard, Mbumpata les rejoint et les conduit au-dessus de Malele vers l'endroit où se trouvent Mulele, Bengila et une vingtaine de partisans. Le mardi 23 mars, deux cents partisans entourent Mulele qui monte vers Matende. Le lendemain, des militaires leur barrent la route. Retour sur le plateau entre Malele et Nien-kongo. Le jeudi, les militaires mettent le feu aux bivouacs de Nsiemin, à peine quelques minutes après le départ des partisans. Les soldats se jettent sur les traces de Mulele. Entre Yassa Lokwa et Malele, ils ouvrent le feu. Dispersement dans toutes les directions. Bengila, Nelly Labut, Léon Makassa et quelques dizaines de partisans perdent tout contact avec Mulele. Entouré d'une centaine d'hommes, Mulele retrouve le premier camp de Mulembe, appelé Sim Labue. A l'époque, les villageois chuchotaient que Mulele avait construit des bivouacs sur l'eau. Les plus jeunes insistent pour voir ce coin historique et mystérieux. Après la visite à ce lieu saint de la révolution, en remontant la pente de l'autre côté de la rivière, les partisans se font surprendre par des militaires qui leur tirent dessus. Continuellement traqué, Mulele se sauve en direction du nord, vers Bêla Borna. Lundi 29 mars, un courrier de Kafungu apporte une lettre annonçant l'arrestation de Louis Mayele et de sa femme. Mulele répond que, vu le quadrillage de la brousse par les militaires, il est préférable, pour le moment, de rester en groupes séparés. Le lendemain, Ntsolo et Bakanga rejoignent le groupe Mulele. Jeudi 1er avril, longue marche pour échapper à l'encerclement. Mulele pousse vers les forêts du secteur Kanga. Le soir il se trouve dans la brousse de Busongo Elom, à quarante kilomètres déjà de Malele. 14. 1er avril - 13 août 1966, A Iseme et Impasi - Table de matières Cent cinquante partisans se sauvent vers le nord. Reconstitution de la direction, mort de Kandaka et de Mundelengolo. Visite de Ngalampang et Ngalangos, deux chefs coutu-miers. Abo et son équipe de jeunes filles cherchent des plantes médicinales. Un photographe au maquis. Les échos de la terreur dans les villages. Dans une clairière entre les arbres, quelques vestiges de parois de bivouac, branches attachées par des lianes, toitures de bâtons et de feuillage de palmier affaissées sous les pluies torrentielles : à cet endroit, entre Ibutsu et Muzumuna, la sous-direction Kanga tenait son quartier général jusqu'à une date récente. Mulele y loge ses quatre-vingt-dix rescapés. A un élève-partisan, il offre un bon pantalon et une belle chemise et l'envoie chez le chef d'Ibutsu. Le jeune s'en va pour sa mission solitaire, l'effroi envahissant tous ses os. Ce sera la mort, les villageois l'identifieront certainement comme le dangereux guerrier de la brousse qu'il s'imagine être. Le chef d'Ibutsu fait tuer une chèvre pour l'accueillir, lui, l'étudiant de passage. J'ai mangé s-é-r-i-e-u-s-e-m-e-n-t, dira plus tard notre héros. Mais pour l'instant, sa gourmandise faillit le trahir. Pensif, le chef se frotte longuement le menton de sa main droite. Est-ce qu'on a jamais vu un étudiant affamé à ce point? Finalement seul avec le chef, l'étudiant se confesse: Je suis un partisan, Pierre veut vous rencontrer, il vous demande de quoi boire et manger. En pleine nuit, le chef se met en route, suivi à une distance respectueuse de ses trois premières femmes chargées comme des ânesses de foufou, de viande, de saka-saka et de calebasses de vin de palme. Quand Mulele vient à sa rencontre, le chef le salue respectueusement: Taat, père. Mulele lui répond en chantant comme le font enfants et adultes qui écoutent le conte des dix gosses mangés par le diable aux dix ventres:
Mon père m'a abandonné Puis Mulele dit: - Tu es maintenant heureux, bien repu et tu collabores avec les militaires pour me chasser. - Non, répond le chef, nous sommes sortis à cause de la souffrance. La force des militaires dépassait la nôtre. Mulele s'adresse aux trois femmes. - Les mamans, vous qui m'avez mis au monde, êtes-vous maintenant d'accord avec les militaires? Vous les nourrissez pour leur donner la force? Moi, je suis dans la forêt pour le bonheur de tous. Entre-temps Mulele s'est assis, boit son vin de palme, et, comme le disent les partisans, fait la leçon. - J'ai commencé la lutte à cet endroit, il y a deux ans et demi. Aujourd'hui, je suis de retour. Recevez-moi comme vous le pouvez. La cause pour laquelle nous luttons ne concerne pas une seule région, nous luttons pour le Congo tout entier. Je peux être ici ou à l'Est du pays. Nous faisons la révolution pour libérer notre pays de la misère causée par les étrangers. La révolution suit ses propres rythmes, elle monte, elle descend. Même rentrés au village, vous pouvez continuer la révolution. Le 6 avril 1966, Mulele s'avance de quelques kilomètres dans la forêt vers les environs d'Iseme. Cinq jours plus tard, un groupe de 54 partisans conduit par Bengila et Nelly Labut l'y rejoint. Ainsi 145 partisans se sont sauvés de l'enfer du labwak. Au cours des deux mois à venir, le camp central fera six courts déplacements, ne s'écartant jamais très loin d'Iseme. Mulele contacte les chefs de village qui lui envoient nourriture et renseignements sur les militaires. Un villageois nommé Kakoy prévient Mulele que des policiers circulent dans la région avec pour mission l'arrestation de deux chefs du secteur Kalanganda. Un enseignant, Victor Kaka, vient rapporter qu'à Idiofa, des bruits circulent que les militaires soupçonnent la présence de Pierre entre Idiofa et Kalanganda. Joseph Okwono et Faustin Mupila, qui ont grandi à Idiofa, conduisent à deux reprises une équipe d'une douzaine de partisans attaquer les installations et les véhicules de la Compagnie du Congo Belge, ainsi que le pont de Lungu. Mulele et Bengila songent à reconstituer la direction générale pour donner un nouveau souffle au maquis. Ils convoquent tous les dirigeants de la région, qui disposent encore de jeunes désirant se battre, pour le 5 mai à Iseme. Parmi les arrivants de Kalanganda, d'Ibubu, de Kapia et d'Eyene, il y a des hommes qui ont fui la fainéantise sur le labwak — Ngwensungu, Munzele, Muzungulu — ainsi que des chefs d'équipe qui ont toujours préféré le combat effectif sur leur propre terroir - Ndabala, Laviwa et Musila. Ntsolo exprime l'avis que dans les conditions présentes, des bureaux remplis de bureaucrates n'ont plus la moindre utilité, que leur poids mort freinera la lutte. Il faut trouver un bon chef de guerre comme Kafungu pour entraîner jusqu'au dernier partisan au combat. Mais Mulele décidera finalement qu'en dehors du bataillon, on maintiendra l'état-major qui coiffe les scribouillards. Alors se produit une apparition inopinée, l'arrivée d'un grand commandant que tout le monde croyait disparu sur la terre lointaine des Bankutu: Bathélemy Mwanandeke, imposant, brun et barbu, rentre à la direction. Il épate les combattants en présentant quatre Mausers, trois Falls et un calibre douze. On n'imagine pas qu'une petite équipe ait été capable de s'emparer d'un tel arsenal. Désormais, tous salueront respectueusement celui qui n'est plus appelé autrement que "le dirigeant Mwanandeke". Quand Ngwensungu embête les partisans, il arrive qu'ils lui posent la question perfide à laquelle il n'a jamais trouvé de réplique: - As-tu déjà mené des actions comme le dirigeant Mwanandeke? Dans la nouvelle structure, Ntsolo a sous son commandement les trois cents partisans du bataillon et il supervise le bureau du camp. Ngwensungu fait chaque matin le rassemblement de ses quatre-vingts bureaucrates, dont une vingtaine de filles. Geneviève Ngulanzungu et Sophie Munge-sungu deviennent chefs de section. Théo dirige les bureaux de documentation et d'études. Laurentin Ngolo n'a pas survécu aux épreuves du labwak. Qui dira si c'est la maladie ou le fusil ennemi qui a finalement eu raison du brave homme, le plus philosophe des maquisards? Mulele lui-même accueille les villageois et s'entretient avec eux, assisté par un nouveau représentant des masses populaires, papa Michel Onsuil. Pascal Mundelengolo, le conteur, le blagueur, le juge et le sage, l'homme qui courait à se casser les jambes au moindre danger, a finalement été attrapé par des militaires plus lestes que lui. Lors de la dispersion finale dans le labwak, Pascal s'est trouvé dans le groupe Kafungu, en direction de Kilembe. Et c'est là que Kafungu, échappé de justesse de la brousse en feu, ayant toujours devant les yeux les visages ensanglantés des partisans tombés sous les balles, a vu surgir Pierre-Damien Kandaka, désespéré, entouré de quelques fidèles. Kandaka a demandé pardon, a exprimé son désir de se rendre chez Mulele pour lui confesser sa faute. Kafungu, l'air incrédule, l'a dévisagé, les yeux brûlant de haine. Voilà que la révolution vient d'être défaite à cause de ce bandit et il ose venir nous parler de pardon! Kandaka a été exécuté à l'instant même. Puis Kafungu a donné des ordres pour reprendre en main les maquis entre Kilembe et Kipuku. Pascal Mundelengolo a fait, à la tête d'une équipe de partisans, le long déplacement vers le nord. Aux environs même de Kipuku, son groupe a été surpris par des militaires. Un camion de l'armée a acheminé Pascal Mundelengolo vers le camp militaire de Kikwit, pour l'y mettre à mort. Devant l'arrivée de militaires à Busongo-Elomo, Mulele décide d'aller vers le nord, en passant par le village Impasi Impata pour s'établir dans les forêts au-dessus d'Impasi Makanga. Du 21 juin 1966 jusqu'au 13 août, il y connaîtra une tranquillité relative. Chaque matin, après les exercices physiques, Abo suit la leçon politique, souvent donnée par Mulele, mais le cœur n'y est plus, les idées flottent, les espoirs sont à redécouvrir et elle ne retient pratiquement rien de ce qui se dit. Le jour même de l'arrivée dans cette forêt, une expédition de cinquante partisans, sous la conduite de Valère Malutshi, Joseph Okwono et Isidore Musuni, part pour Malele. Des villageois y ont arrêté Kambulu, un responsable des dépôts et ils lui ont volé une partie de son stock. Mulele veut aussi se renseigner sur le sort de Kafungu. La mission rentre bredouille et Mulele se fâche : Qui vous a ordonné de retourner et de laisser un vide de ce côté? Difficile de foncer sus à l'ennemi avec des fugitifs fatigués, comme l'aurait dit Kafungu. Ce matin, tous les partisans ressentent une trouble impatience à assister à la rencontre entre la coutume et la révolution: ils attendent la visite au camp du grand chef Nga-lampang qui règne sur les Bambunda et les Badinga des trois villages Pangu. Vers huit heures, Ngalampang fait une apparition royale, son grand pagne etuk, couleur bleu ciel, autour des reins, un beau drapé mis en larges plis qui forme un cercle majestueux quand le chef entre dans la danse. Ngalampang porte deux pagnes en bandoulière sur les épaules que couvrent une veste noire, de coupe européenne. Sur sa tête, un casque de haut dignitaire en peau de lion, une rareté. Ses notables l'accompagnent et ils entrent au camp en citant le proverbe: Kwitin embwim On peut lier avec une liane, Le proverbe exprime ici l'amitié entre deux parties et leur décision de travailler ensemble. Au moment où Ngalampang arrive devant Mulele, il se met à genoux, les mains jointes. - Tu t'agenouilles maintenant comme du temps de Jésus-Christ? Mulele lui prend la main pour qu'il se relève et demande : - Pourquoi m'as-tu laissé seul au maquis? - Taat, excusez-nous, c'est à cause de la famine. Mais pourquoi n'es-tu jamais venu chez nous? Nous t'avons toujours cherché et attendu. - Me voilà. Vous pouvez prendre vos machettes et me couper en petits morceaux que vous vous partagerez, si vous avez tellement besoin de moi. Mulele blague pour détendre l'atmosphère. Aux yeux des chefs coutumiers, Mulele est une figure légendaire et mythique, dotée du pouvoir magique suprême. Si le commun des mortels avait osé de telles plaisanteries, l'insulte aurait été impitoyablement vengée. Mais le ton léger que prend Mulele signifie au chef coutumier qu'il est l'égal du Grand Léopard. L'après-midi du même jour arrive Ngalangos, le chef de Ngoso. Il porte un grand pagne rayé de rouge, de bleu et de jaune sur les épaules. A ses paroles: - Mpfum nze mbot Chef, je vous salue, Mulele répond: - Non, c'est vous le grand chef que nous respectons, moi je suis votre enfant. Puis Mulele chante, comme au tribunal: bé awi? Je demande à mes étrangers Et tous les présents reprennent la chanson. Ngalangos a amené ses femmes et Abo se joint à elles pour la danse. Avant que les chefs n'entament leur conversation, les femmes chantent: tang laween kaalil osika ngon Ho ntan ho-ho elum kalilie mwaan ebal ntana Les Mbwitsambele Ce chant souvent entonné lors d'une séance de tribunal, à l'occasion d'un deuil ou d'une fête traditionnelle, signifie qu'on ne peut pas arranger cette affaire de la révolution si la population n'est pas présente.Mulele, assis dans sa chaise longue — confort auquel il tient beaucoup — cause longuement avec le chef Ngalangos. Grâce au soutien des chefs, les partisans ne manqueront jamais de nourriture. Et leur moral remonte d'un cran. Célestin Mukulu, le président du comité de village d'Impasi Makanga, le père de Marie Mukulu, organise le ravitaillement du camp et apporte des renseignements. Chaque jour, une vingtaine de villageois viennent au camp pour une causerie. Les chefs leur interdisent de venir en plus grand nombre pour ne pas provoquer de soupçons. Les partisans ont débroussaillé une aire en pleine forêt où Mulele reçoit la population. Le camp comprend maintenant sept cents partisans qui se présentent chaque matin au rassemblement. Le bureau de santé fonctionne à plein rendement, mais avec pénurie de médicaments. La population vient nombreuse aux consultations. Lorsqu'Abo, Ankawu et Anaclet Bilo se présentent à sept heures, ils trouvent déjà trente à cinquante malades devant leur bureau. Le nombre des patients dépasse souvent la centaine. C'est ici, à Impasi, que le vieux chef pende Pierre Mudinda, l'homme qui a survécu aux massacres de 1931 à Kilamba, qui a supporté la famine et l'insomnie du labwak, sera enterré avec tous les honneurs. Le dispensaire a pu sauver deux microscopes malgré toutes les attaques et cavalcades. Le service pratique les examens du sang et des selles. Véronique Muyasa, Hélène Pulese, Mathilde Manima, Flaurentine Muke, Nelly Mum-bongo et Eugénie Ente, toutes de la région d'Impasi, ont rejoint l'équipe sanitaire et accompagnent Abo en forêt lors de ses tournées de cueillette de plantes médicinales. Après de savantes palabres avec le camarade en chef, des vieux ont finalement accepté d'accompagner sa femme pour lui montrer les plantes miraculeuses. Les convaincre ne fut point facile. Usant d'une astuce, Mulele leur a demandé s'ils connaissaient les médicaments mpipil et mvuka qui rendent invisibles et permettent de s'envoler. Pris de honte, les vieux ont reconnu ne pas les connaître. Nous regrettons beaucoup, camarade en chef, ont-ils dit, mais les ancêtres ont gardé le secret, ils ne nous ont pas communiqué comment fabriquer ces médicaments. Vous voyez maintenant, leur expliqua Mulele, la grande perte que vous avez subie. Il faut donc que vous transmettiez vos secrets aux jeunes et que vous leur appreniez les plantes qui soignent. C'est ainsi qu'Abo apprend à bouillir les racines de la papaye dans du vin de palme, pour soigner la blennorragie. L'écorce de Yobuot, l'arbre préféré des guetteurs, bouillie dans de l'eau, chasse les maux de dents et de ventre. Il faut râper la racine fraîche de Yelul mbwetsh, la quinquilliba, la sécher, puis piler et presser la poudre ainsi obtenue en comprimés. Ce médicament soigne efficacement la malaria. L'équipe d'Abo apprend ainsi les qualités curatives de dizaines de plantes de la forêt et de la brousse. Des visiteurs d'Idiofa informent régulièrement Mulele des dires et des gestes des militaires. Abo donne de l'argent à l'ancien chef d'équipe d'Impasi, Gérard Mukwasa, pour qu'il aille acheter du savon, du sel et des médicaments à Kikwit. C'est aussi Gérard qui rapporte l'assassinat de son collègue Victor Kaka, l'instituteur qui renseignait Mulele sur les intentions de l'ennemi: intercepté lors d'un déplacement pour le maquis, il a été abattu. Dimanche 31 juillet 1966, sensation au camp: les filles courent mettre leur plus belle jupe. Abo profite de cette occasion unique pour enfiler sa robe bleu ciel interdite et son grand chapeau blanc. Les hommes se présentent dans leur chemise la plus avantageuse. Antoine Kayoko, photographe à Kinshasa, est venu faire le portrait de chacun. Kayoko utilise beaucoup de pellicule mais aucune de ses photos ne parviendra jamais au maquis. Quand, des années plus tard, des anciens partisans montrent leur étonnement devant les images d'Impasi, ils indiquent d'abord les visages des hommes et des femmes que l'armée a abattus. Voilà Joseph Okwono, là-bas Omer Bakanga, ici Valère Munzele et celui avec le chapeau, c'est Delphin Mbumpata. Et regarde, Véronique Muyasa qui cherchait des plantes avec Abo. De Godelieve et Martine Madinga, personne ne possède de photo. Mais c'est à Impasi que les partisans apprennent leur fin dramatique. Vers Kilembe, les militaires se sont emparés des deux sœurs Madinga et ils les ont mises à mort. Même les hommes les plus durs n'arrivent pas à retenir leurs larmes. Nous ne les verrons plus jamais, Godelieve, cette jeune femme forte, brune, à la voix assurée, la première femme à donner des leçons politiques et à commander les rangs, inséparable, même dans la mort, de sa sœur Martine, presque son contraire avec sa taille élancée et sa peau noir foncé. Le vendredi suivant, Fernand Kalvanda arrive d'Idiofa. Il sonde son vieil ami Pierre Mulele: - As-tu envie de rester encore longtemps dans cette forêt? - Moi, je peux y rester toujours. - L'endroit n'est plus sûr. Jour et nuit, les militaires ne parlent que de l'attaque qu'ils préparent. - Moi je les attends, ils n'ont qu'à m'attaquer. Mais dis-moi, la population d'Idiofa est-elle toujours aussi révolutionnaire qu'auparavant? - Oui, mais les gens ont peur, plus personne ne peut se manifester ouvertement, les militaires commettent en public des actes de terreur horribles. Ce que terreur veut dire, de la part de ceux qui seront décrits comme des pacificateurs dans les livres d'histoire, leur histoire, la seule couchée sur papier, les partisans l'apprennent par bribes et de bouches qui hésitent à parler. Victor Isulu de Matende rapporte ce qui est arrivé à son ami Jean Ekot. Les villageois de Matende, rabattus comme du gibier par les militaires sur Yassa Lokwa, ont d'abord dû se mettre à plat ventre par terre, comme du temps de la chicote flamande, puis les soldats leur ont travaillé le dos avec des bâtons jusqu'à ce que le sang jaillisse. Ensuite, ils ont demandé à Jean Ekot de leur indiquer sa mère. Ils ont déshabillé la vieille et ordonné au fils de faire l'amour avec sa mère, spectacle auquel tous les villageois étaient conviés. La mère, Ambwil de son nom, s'est suicidée peu de temps après. Au moment où Mobutu aura consolidé son pouvoir, cet exploit aussi fera partie intégrante de ce qu'on appelle la pacification. Un ami d'enfance d'Abo raconte les événements de Lu-kamba. Les soldats ont arraché à la foule un homme d'une quarantaine d'années dont le nom est Ngangi. Cela s'est passé devant les villageois, rassemblés à Lukamba Secteur. Les soldats lui ont dit de leur montrer sa fille. Il a obéi. Il leur a présenté Béa, la femme de Mandutshi. Les militaires ont commandé à Ngangi et Béa de faire l'amour, sur place, devant le rassemblement. Après trois refus catégoriques, le père et la fille ont été fusillés. Et ainsi a continué l'épopée de la pacification. Un homme arrive de Kimbanda. Il y a quelques semaines, les soldats y ont ramassé beaucoup de monde. Ils ont dit à un homme de Bukundu de mettre sa main sur un arbre. Puis ils ont pris un villageois, lui ont fourré une machette dans les pattes et ont aboyé: coupe! Excités par ce premier sang, les militaires se sont emparés de Ntono, l'ont allongé sur un arbre et ont commandé à un villageois de lui trancher la jambe au dessus du genou. L'homme a levé la machette, le sang a giclé mais l'os n'était même pas touché. Un autre villageois a été mis à la tâche. Il a sabré, puis éclaté en pleurs. Au total cinq villageois ont levé la machette avant que l'os ne soit cassé et la jambe amputée. Kimbanda est pacifié. Des jeunes filles et des femmes sont traînées devant les villageois. Les soldats n'en veulent ni à leurs pieds, ni à leurs mains. A la baïonnette, au poignard, ils leur coupent un sein. De la sorte, les femmes sont pacifiées. De nombreuses nouvelles parviennent à Impasi, racontées comme des faits divers. Un homme de Mukedi a vu sortir un groupe d'une bonne dizaine de personnes de la forêt. Les militaires leur ont ordonné de se coucher sur le ventre. Puis, avec de gros bâtons, ils leur ont, les uns après les autres, défoncé le crâne. Les villageois de Mukedi ont dû assister à cette mise à mort barbare. Kobebisa masasi te, disait le lieutenant Nguya, il ne faut pas gaspiller les balles. Jacqueline est sortie de la forêt il y a un an. Une grande brousse descend en pente de la mission de Mukedi jusqu'à la rivière Tshinyo. L'armée y a amené des dizaines de présumés maquisards. Courez, disaient les militaires. Puis ils tiraient sur les cibles mouvantes. Quand Jacqueline a visité l'endroit, on avait brûlé la brousse. Partout elle a vu des cadavres en décomposition et des squelettes. Près de l'eau, du sang imbibait encore la terre. Autant de faits divers, autant de victimes anonymes qu'Abo enregistre dans sa mémoire. Un jour, ces morts auront un nom. Un jour, tous ces hommes et femmes estropiés et mutilés porteront témoignage. Même s'il faut attendre un quart de siècle. Fernand Kalvanda connaît tous ces drames. Comme Antoine Kayoko, il sympathise avec les villageois et avec Mulele, tout en caressant un rêve impossible de dialogue avec les militaires. Et il quitte le maquis avec un sentiment d'étonnement, d'admiration même, devant le degré d'organisation des partisans. A son départ, le camarade en chef lui donne sa montre qui s'est arrêtée définitivement à l'heure de la pacification et de la terreur. L'horloger d'Idiofa pourra-t-il la réparer? En échange, Fernand laisse la sienne à Pierre. Un quart de siècle plus tard, le co-propriétaire de l'hôtel Diakal à Idiofa aurait-il toujours conservé la montre du camarade en chef? Abo se le demande. De gauche à droite, debout: 1. Inconnu, 2. Kabombo, 3. Jean Mawala(?), 4. Dieudonné Muku, 5. Inconnu, 6. Théodore Bengila, 7. Ankawu, 8. Pierre Mulele, 9. Barthélémy Mwanandeke, 10. Théotime Ntsolo, 11. Théophile Bula-Bula, 12. Delphin Muzungulu, 13. Munzikatshive, 14. Zéphérin Langung, 15. Inconnu, 16. Papa Michel Onsuil. Assis: 1. Valère Malutshi, 2.Valère Munzele, 3. Vital Ipolo, 4. Joseph Okwono, 5. Pierre Ngwensungu, 6. Richard Isita, 7. Omer Bakanga, 8. Dieudonné Ndabala, 9. Makila. 15. 13 août - 9 novembre 1967, A Eyene et Mayili et au bord de la Kamtsha - Table de matières Abo, accoucheuse au maquis. Escarmouches dans la forêt d'Eyene, angoisses parmi les partisans à Mayili. A la rencontre de Che Guevara. Chez les Bangoli. Léonie, Monique et Bernadette, trois amies. Toute la famille adoptive dAbo exterminée. Le coup fatal près de la rivière Kamtsha. Le 13 août 1966, Mulele apprend que des militaires ont pris position dans les villages Bembele, Impasi, Elomo-Esala, Lad-zum et Nko. Il faut échapper à l'encerclement. Les partisans marchent vers le nord, à travers la forêt de Nko. A une heure de la nuit, le 16 août, Soulié, mariée à Mbumpata, n'en peut plus. Abo oublie le maquis pour redevenir, le bref temps d'un cri d'enfant, accoucheuse à l'hôpital de Gungu. Soulié peine depuis quatre heures à la queue de la colonne, s'arrêtant tous les cent mètres pour reprendre haleine, souffrant des premiers mouvements d'un fils rebelle dans son gros ventre. En fuite au milieu de la nuit, encerclée par des militaires sanguinaires, elle sait que l'accouchement est imminent. Abo s'affaire, oublie les dangers pour s'oublier dans les joies de son métier. Dans une clairière en pleine forêt, des partisans allument un feu pour éclairer l'opération. Sur l'herbe, ils étendent une natte couverte d'un pagne. Soulié a peur, mais ne panique pas, ni ne pousse le moindre cri. La délivrance se passe sans complications. C'est un robuste garçon qui pèse bien trois kilos. Il deviendra sûrement un combattant aussi redoutable que son père, Delphin Mbumpata. L'armée, par quelques salves tirées au loin, salue la naissance du petit partisan. Vers six heures, le jour s'est déjà levé, Abo et Soulié, son nouveau-né dans les bras, se hâtent de rejoindre la colonne. Les maquisards s'arrêtent le matin dans la forêt de Masele Intsumu. Dieudonné Ndabala, qui connaît bien la région pour y avoir dirigé la sous-direction d'Ibubu, entreprend plusieurs missions pour tendre des embuscades. Le 20 août, les partisans arrivent à Pangu Ekang où, le lendemain, ils seront surpris et dispersés par des militaires. Ceux-ci arrivent de Pangu Intsumu où ils viennent d'assassiner le président du comité de village, Théophile Ndayipa et son adjoint Komda. Le soir, Mulele, Abo et une vingtaine de partisans se retrouvent aux environs de Musenge Mune-ne. Une longue marche les ramène loin au sud, vers le point de départ dans la brousse de Busongo. Les villageois renseignent les groupes dispersés, de sorte que tous rejoignent Mulele à Bembele Busongo. Les partisans ne peuvent plus rester deux jours au même endroit. Les soldats occupent les villages et hameaux, font des pointes peureuses sur les routes principales, répandent d'abondantes munitions sur les herbes et les feuillages et s'en vont. Arrogants comme des baroudeurs. Courageux comme des canards. Lors de la dispersion, Ndabala et Marie Mukulu, sa femme, se retrouvent isolés dans la forêt de Pangu. Tout à coup, ils tombent nez à nez avec deux militaires. Les balles leur sifflent autour de la tête. Marie, enceinte de sept mois, se jette dans une fosse. La bousculade, l'émotion, la panique provoqueront, le lendemain, une naissance prématurée. La fillette ne vivra que trois jours. Abo ressent toujours un trouble profond à la mort d'un nouveau-né. Et c'est juste à ce moment qu'elle apprend le décès de celui à qui elle doit sa propre survie, l'oncle Ebul. Abo a vécu parce qu'Ebul avait racheté Mabiungu, l'esclave. La maladie et la faim ont eu raison du vieil homme. Ebul était la bonté même. Abo le revoit devant son métier, en train de tisser le mbal, la pièce de raphia. Quand, enfant, elle se rendait dans sa parcelle, Ebul ne manquait jamais de lui glisser quelques pièces de monnaie dans la main. Lorsqu'un villageois était décédé à Lukamba, à Matende, à Kim-banda, il s'y rendait pour pleurer le mort. Qu'adviendra-t-il de sa famille? Sa fille Amias l'a précédé dans la tombe, son fils Gaspar Ngung a été enterré vivant. Il ne reste que Ntoma. Les partisans effectuent un retour sur Impasi Impata pour décrire ensuite une grande courbe passant par Elomo-Esala vers Masele Intsumu. Les militaires toujours sur les talons. Les maquisards décident de faire une percée vers le nord, vingt kilomètres de marche. Le 31 août, Mulele entre dans la forêt de Luele-Mbele. Pendant neuf jours, il effectue d'incessants déplacements dans un petit triangle entre Luele-Mbele, Luele-Nganda et Luele-Ekubi et il traverse deux fois la rivière Pio-Pio pour disparaître dans la forêt de Punkulu-Lakas. Finalement, il revient sur la rive gauche et s'établit à Eyene, à l'endroit où se trouvait la troisième direction de Félix Mukulubundu, en octobre 1963. Mulele y séjournera pendant deux mois. Au camp, alors que les hommes des bureaux meurent de peur, les chefs de guerre s'enivrent d'aventures. Laviwa, Mwanandeke, Musila rassemblent des équipes, se lancent au combat et rentrent le temps d'un salut pour repartir affronter les soldats. Mulele et Ntsolo dirigent une équipe vers Mukoko. Pendant toute la nuit, les militaires de l'endroit font feu sur des partisans qui ne se présenteront qu'à huit heures du matin. Mulele tire quelques coups de fusil par pure réciprocité courtoise et disparaît. Abo parcourt régulièrement la forêt, avec son équipe de jeunes filles, à la recherche de plantes comestibles. Ainsi elles découvrent des sanza banzenza, qui ressemblent à l'épinard, parsemées dans des clairières: probablement des descendantes de plantes cultivées au temps où des cases s'élevaient à ces endroits. Des vieux ont aussi exposé à Abo les qualités d'un grand nombre de plantes et d'arbres. L'équipe d'Abo cueille des feuilles de piment dans des champs abandonnés, ainsi que de jeunes feuilles d'un grand arbre inconnu, savoureuses comme l'oseille. Le 12 octobre, Evariste Menaba, le commandant de la quatrième zone, et Théotime Isungu retrouvent Mulele après une séparation d'une année. Des messagers arrivent d'Ibubu. Les militaires y ont ramassé tous ceux qui sont sortis de la forêt. Ils ont dit que Ndabala, l'ancien chef d'équipe d'Ibubu, les fait trop souffrir et qu'il faut que ça cesse. Ils se sont emparés de trois membres du clan de Ndabala. L'oncle Muke Richard a été amputé à la machette des deux pieds et des deux bras. A deux petits frères, les soldats ont coupé les bras. La pacification continue. Des militaires arrivent dans les villages de Mayungu et Mikienge, à quelques kilomètres du camp. Des équipes entreprennent plusieurs opérations au cours desquelles deux soldats et un policier sont envoyés au ciel. Fin octobre, Nelly Labut accouche d'une fille pesant à peine deux kilos. Abo doute fort que la pauvre fillette ait la moindre chance de survie. Le 5 novembre, la direction monte encore quinze kilomètres au nord et s'incruste entre les eaux limpides des innombrables petites rivières qui nourrissent la forêt tropicale du triangle Mpum-Ebaya, Tsongo-Mayili et Mayili. Faisant de courts déplacements entre ces trois villages, Mulele y connaîtra une tranquillité relative pendant onze mois. Des villageois apportent le mamonja, le manioc préparé à la manière des Badinga, pour nourrir les partisans. Bernadette Kimino en explique le secret à Abo. Les tubercules doivent d'abord tremper pendant une semaine dans l'eau, ce qui vaut au mets son nom de Kin Sept Jours. Dans le fond d'une casserole, on dispose en spirale des tiges qu'on submerge d'eau, le tout couvert de feuilles de manioc sur lesquelles on dispose les tubercules dépouillés de leur peau. On coiffe l'ensemble de feuilles. Et c'est ainsi qu'on cuit le manioc à la vapeur. Ensuite, on le pile et on en fait une boule qu'on enveloppe dans des feuilles. Enfin, une dernière cuisson sur des tiges, un fond d'eau et des feuilles de makungu. Et on peut servir le mamonja, dit aussi l'amweng en kimbunda. Menaba et Laviwa dirigent toujours des équipes très pugnaces dans leur région. Le père de Laviwa est un grand chef que ses quinze femmes ont comblé d'une descendance pléthorique de fils géants, tous des doubles mètres, dit-on, noir foncé, de vraies forces de la nature. Ses frères forment l'ossature de l'équipe de Laviwa. Mais parmi les autres maquisards, cinq cents au dénombrement du matin, le climat est morose. Lorsque les militaires, peureux, balancent quelques balles lors de leur arrivée dans un village, au camp, tout le monde se presse autour de Mulele. - Où allez-vous maintenant? leur demande-t-il. Vous pensez ne pas mourir quand vous êtes à côté de moi? Des regards effarés ne trouvent pas où se poser, personne ne répond. - Les militaires aussi sont des hommes, plus effrayés encore que vous. La révolution est devenue difficile. Il faut avoir le cœur dur pour trouver une solution. Le soir autour du feu, Mulele, le chef-guérillero, invente des jeux de société pour faire rire les présents. Question de relever le moral. Mulele badine, raconte des histoires drôles ou burlesques; le défi consiste à rester sérieux, inébranlable. Celui qui rit reçoit une punition. A la Saint-Sylvestre 1966, le camp se rapproche légèrement de la grande rivière Pio-Pio, dans la forêt de Ntsim Ansie, à un endroit baptisé Ankiel en honneur des fourmis omniprésentes et rudement plus agressives que les soldats. Pendant neuf mois, jusqu'au 22 septembre 1967, Ntsim Antsie, près de Mayili, sera le point d'ancrage du camp central. Le 8 mai, les partisans traversent une première fois la rivière Pio-Pio pour se loger pendant une brève période sur la rive droite, dans la forêt d'un minuscule village, Miti-Miti. Du 24 au 28 août, Mulele fera une deuxième incursion dans cette forêt. Il retournera à Miti-Miti une troisième fois, le 4 septembre. Mais retournons au jour du nouvel an 1967, au moment où Stéphane Etshwe termine une mission guerrière d'une semaine vers Buluem et Kalanganda. - Désespérant, dit-il, tout le monde a quitté la forêt, plus rien à faire. Abo fait un commentaire désobligeant à la femme de Stéphane: II n'y est même pas allé. Suit une dispute haute en couleurs. Mulele murmure entre ses dents, pour que son secrétaire l'entende: II se pourrait que Léonie ait raison... Sur le bébé chétif de Nelly pèse toute l'angoisse du camp. Abo voit lentement s'éteindre cette flamme trop fragile. Les incessants déplacements, l'inquiétude lors des nuits froides, le découragement les jours où une nouvelle arrivée de soldats est signalée, ont affaibli la mère. Ses seins restent vides. L'enfant est sous-alimenté et déshydraté. Abo lui donne des injections sous-cutanées de sérum physiologique auquel elle a mêlé du bécozyme aux vitamines B complexes. En vain. Début janvier, Nelly et ses amies enterrent le petit corps. Au même moment, quatre Bangoli arrivent au camp. Mulele y voit une chance de donner un nouvel élan à la révolution. Et voici pourquoi. Mulele avait appris en mars 1966 une information assez incroyable: Che Guevara, le grand Che lui-même, accompagnant des combattants de l'Est, s'approchait de Dekese, au nord du Kwilu, sur l'autre rive de la Kasaï! Mulele rêvait depuis lors de faire la jonction avec les révolutionnaires de l'Est, drôlement mieux armés que ses jeunes villageois munis de poupous, de lances et d'arcs. En Guevara, il trouverait un chef de guérilla plein d'initiative et capable d'audace. Mulele regrettait toujours la séparation avec Kafungu, surtout lorsque Ntsolo ou Ngwensungu venaient lui demander ce qu'il fallait faire: Mais c'est vous les militaires de vocation et de formation, non? Au moment où il rencontre les envoyés des Bangoli, Mulele a déjà conçu l'intention de percer vers la rivière Kasaï, en direction de Dekese, à travers le territoire ngoli. Ces derniers temps, il a beaucoup réfléchi au cours que la révolution a suivi depuis trois ans. Avant leur entrée au maquis, lui et Bengila s'étaient concertés avec Thomas Mukwidi, Léonard Mitudidi et Gabriel Yumbu et ils avaient défini de commun accord les grandes orientations du Conseil National de la Libération à créer. Depuis lors, un mouvement populaire révolutionnaire d'une ampleur jamais vue au cours de l'histoire du Congo avait déferlé sur le pays. Il s'agit maintenant de fixer les leçons fondamentales de cette expérience. Souvent, ces derniers mois, Abo a surpris Mulele et Bengila en train de fouiller dans des manuscrits, de griffonner des corrections dans la marge. Je me demande ce que Yumbu et Kabila mijotent à l'Est, dit Théo. Par des bribes de conversation, Abo a appris que Mulele veut créer un parti révolutionnaire. Un jour, un paquet de feuilles dans la main, Mulele lui dit: - Quand nous rencontrerons les combattants de l'Est, nous formerons ensemble un Mouvement Populaire de la Révolution. Les textes ont déjà été rédigés. Jadis, si tu parlais de la révolution, on te tuait. Maintenant le nom de révolution est devenu très populaire parmi les masses. Nous allons regrouper tous ceux qui refusent l'esclavage et l'oppression étrangère. Nous devons avoir avec nous les ouvriers et les paysans mais aussi les commerçants et les intellectuels, les chefs coutumiers et même les simples soldats. Le Mouvement Populaire de la Révolution mettra les affaires du Congo entre les mains des enfants du Congo. Mais il y a quelques semaines, lors d'une fuite devant l'armée aux environs d'Eyene, Mulele a perdu ses manuscrits. Pourvu que l'armée ne les ait pas récupérés. Mulele s'occupe fiévreusement à reconstituer ses documents. Il faut absolument traverser le territoire ngoli, murmure-t-il, passer la rivière Kasaï et rejoindre les combattants de l'Est. La discussion avec les quatre Bangoli dure plusieurs jours. Ils déclarent que Mulele peut rester sans problèmes dans leur forêt, puisque ça fait longtemps qu'ils désirent le voir en personne, lui, Mulele. Pensif, Ntsolo se demande s'il ne s'agit pas d'un piège. Les Bangoli expliquent que leurs amis dinga — les mariages entre Bangoli et Badinga sont fréquents — leur ont parlé de la révolution. Maintenant, disent-ils, nous aimerions la voir de nos propres yeux, cette révolution. Mais, prudence, les militaires traînassent dans les villages et ils sont en bons termes avec certains de nos frères qui n'ignorent pas ta présence dans nos forêts. Finalement, les Bangoli acceptent d'accueillir une délégation qui balisera la route de marche vers la rivière Kasaï. Une semaine après leur départ, Joseph Okwono, débrouillard, batailleur mais récalcitrant, dirige la mission. Vingt kilomètres à l'intérieur des terres ngoli, les hommes d'Okwono voient, dans les hallucinations de la faim, deux grosses chèvres bien campées sur leurs pattes. Ils les tuent et se délectent à l'odeur de la grillade, lorsque des flèches empoisonnées, décochées par les villageois d'Iwanga, les envoient rêver de bonne chair pour l'éternité. Abo consigne ce désastre dans son cahier le 16 janvier 1967. Le 22 janvier, le froid qui envahit le camp au crépuscule n'empêche pas le commandant en chef de se montrer d'excellente humeur. Il invite à la danse. Quand tout le monde s'est bien échauffé, a secoué le poids des pénibles réalités pour redécouvrir l'insouciance et la joie, le camarade en chef s'éclipse en compagnie de Bernadette Kimbadi. Bien des heures plus tard, lorsque tous les danseurs reprennent possession de leurs membres fatigués, Bernadette revient de derrière le bivouac et, passant devant Abo, éclate en sanglots. Mulele la suit de loin et disparaît honteusement mais avec la souplesse d'un chat en fuite. Il se rend chez le forgeron et y reste passer le temps jusqu'à trois heures du matin. Dans le bivouac, Bernadette a les yeux mouillés, Monique pleure, Léonie a le regard noir; les trois femmes se taisent. Le lendemain matin, Léonie prépare l'eau, le savon, la brosse à dents de Mulele, comme elle le fait d'habitude avant de se rendre au rassemblement. A son retour, elle constate que Mulele n'y a pas touché. Le commandant suprême décide que Bernadette se chargera désormais de ce rituel matinal, ce qui provoque un nouvel accès de larmes chez sa nouvelle élue. Pendant quelques jours, Léonie et Monique font la moue, l'oeil mauvais, et n'adressent pas la moindre parole à leur maître polygame. Bengila, qui lui aussi a le cœur vagabond, intervient auprès de Léonie pour sauver son ami d'une situation lourde de menaces. - Toi, tu es la mère de tout le monde. Calme-toi et laisse cette affaire comme ça. Il a peur de toi. Nous sommes en guerre, il a déjà assez de problèmes. Bengila y ajoute quelques arguments justificateurs dans le registre politique, mais l'astuce est trop grossière. Léonie accorde à Mulele qu'il ploie sous des problèmes de tous ordres et elle ne veut pas l'accabler davantage. Bientôt une triple alliance tacite mais confiante unira Léonie, Monique et Bernadette. Quelques semaines plus tard, lors d'une dispute conjugale, Mulele frappe sa première femme et se voit "agressé" par Monique et Bernadette qui le tiennent aux bras et autour des reins. Mulele prend la fuite vers le hangar où l'attendent les dirigeants pour une réunion. Le petit Ibu-labit l'y a précédé et, imitant les gestes du combat auquel il vient d'assister, ne cesse de crier: Papa, maman! Lorsque Mulele arrive, il lance d'un ton badin: - Vraiment, elles pourraient me tuer, ces femmes! Les dirigeants l'observent d'un oeil légèrement moqueur. Les trois femmes sont liées par une étrange amitié, scellée chaque nuit par un sentiment obsédant: peut-être, une d'entre nous tombera demain sous les balles ennemies. Parfois, leur mari est pris de mélancolie: - Quand je serai mort, une de vous trois pourra dire tout ce qu'il y a à dire sur ma vie au maquis... Le 7 février 1967, quelques militaires s'avancent jusqu'au poste de garde du camp, font feu et se retirent. Le lendemain, les partisans quittent le camp baptisé Okwono. Les partisans ont devant eux huit semaines de calme par un temps glacial. Les moments d'accalmie, ne cesse de répéter Mulele, ne doivent pas nous ramollir. La partie qui utilise le mieux la trêve pour préparer les batailles à venir, gagnera la guerre. Il donne l'ordre de réunir toutes sortes d'objets métalliques, d'instruments mis au rebut. Puis, avec Delphin Mbumpata et l'équipe d'Ekwomo, il étudie avec grand soin les pièces détachées d'un mortier qu'on vient de démonter. Bientôt, du matin jusqu'au soir, on voit les hommes d'Ekwomo limer des pièces. A la fin de leurs peines, ils auront copié le mortier pris sur l'ennemi. Il faut toujours se creuser le cerveau pour acquérir des armes par ses propres efforts. Le 30 avril, Ndabala part avec dix combattants dresser une embuscade près d'Elanga, au sud de Buluem. Ils tuent un militaire et rapportent armes, paquetage, uniforme et chaussures comme autant de trophées. La moindre action victorieuse réchauffe bien des cœurs dans cette froidure qui enveloppe Mayili. Le 12 mai, Kahanga, l'ancien militaire, le gradé d'élite toujours prêt à monter en première ligne, l'instructeur militaire adroit, passe à l'ennemi. Il a non seulement rejoint les militaires à Ntsim Ansié, mais a livré les noms des villageois qui apportent de la nourriture au camp. Les militaires ont transpercé à la baïonnette les cinq villageois dénoncés dont ils ont pu s'emparer. La colère au camp se double d'un désarroi profond. Les pauvres villageois ont fait beaucoup de sacrifices pour nourrir les partisans au risque de leur vie. Qu'un partisan, pire, un gradé, trahisse leur confiance, suscite une rage impuissante. Désarroi: Kahanga, volontaire de toutes les missions difficiles, était aussi un responsable de la garde et de la sécurité. Les militants ont le sentiment que les derniers verrous de leur sécurité sautent. Ils ne voient plus d'avenir. Ils n'imaginent plus une voie vers la victoire. Toutes les idées dans la tête se déforment dans un désordre inextricable à l'image de cet entassement d'arbres et de lianes, cet enchevêtrement de cours d'eau et de marais glaciaux, cette nature froide et étouffante, cette prison en plein air. Ils n'espèrent plus rien. Ils attendent l'attaque suivante pour fuir ou mourir. Marceline Mulopo veut rentrer à la maison et se lamente : II n'est plus possible de continuer, nous ne sommes que deux filles dans la famille et je ne sais pas si ma sœur est encore en vie. Dans cette forêt de Mayili, les partisans marchent souvent sous la pluie, tantôt douce, tantôt battante, mais toujours glaciale. Parfois il faut traverser des edzang, de grandes étendues d'eau stagnante entre les arbres. Les partisans s'enfoncent dans la boue et dans l'eau jusqu'au dessus des genoux. Il arrive qu'un homme tombe. La froide humidité le fera trembler tout le reste de la journée. Allumer un feu est impossible: la fumée trahirait la présence de la colonne. On attend la nuit pour cuisiner, on aménage le feu dans un trou creusé en oblique pour que la lumière ne puisse pas être remarquée de loin. Des semaines passent, puis des mois dont Abo ne se rappelle rien sauf le froid, la désolation, l'atmosphère inhospitalière de cette forêt qui étouffe les hommes. Dans la mémoire, un trou noir. Oui, mais dans ces ténèbres, il y a eu, tout à coup, comme un météore éblouissant, une journée d'émerveillement. Abo se souvient vivement de cet après-midi, glissant vers le crépuscule. Tous les partisans gardent les yeux fixés sur une éclipse solaire qui peint l'univers d'un rouge éclatant, le ciel prend les couleurs du feu et du sang, sur la forêt ruisselle une lumière rougeâtre. Camarades, même si nous sentons la mort rôder autour de nous, gardons confiance, un jour, à l'avenir, le monde entier sera rouge. Fin août, au camp, le nombre de malades se chiffre à quarante-trois. Quelques malades sont laissés dans les villages aux soins d'une famille révolutionnaire qui sait qu'en sauvant un partisan, elle risque sa propre existence. Le 31 août 1967, le vieux chef Kitondolo de Gungu, qui a courageusement passé par toutes les épreuves, meurt de maladie. Deux garçons et une partisane rendent l'âme début septembre. Dans cette nature froide où tout parle de la mort, on accepte le drame le plus déchirant sans larmes. Abo ne sait même plus où et quand elle a entendu la nouvelle effroyable. Cette nouvelle terrible qu'elle craignait depuis si longtemps. La mort de sa mère Labon l'a toujours hantée. Aujourd'hui, Abo doit s'y résigner: ma mère Mabiungu est morte, elle aussi. Awaka, mon père, a été assassiné à ses côtés. Anging Ebho et Yasa et Apwas, mes mamans, ont été tuées avec leur mari. Toute ma famille a été exterminée dans un camp de concentration à Bantsamba où la population de Lukamba avait été amassée. Pendant des mois, Abo n'a pratiquement plus rien noté dans son journal. Le découragement ne s'écrit pas. Elle a seulement enregistré quelques rares lumières solitaires. "A Ebaya-Mampa, le 27 août, l'équipe de Ndabala a attaqué les militaires qui, dans leur fuite, ont abandonné deux fusils." Le 22 septembre 1967, les partisans quittent le camp Kitondolo, près de Mayili, pour traverser d'innombrables ruisseaux, quinze kilomètres dans la forêt dense en direction de la rivière Kasaï. Halte dans la forêt d'Eyenge-Maba, à la frontière entre les Badinga et les Bangoli. Mulele a fait le trajet seul, en pirogue, sur la rivière Pio-Pio et il attend ses hommes non loin du village Eyenge-Maba. Le lendemain, Léonard Mampasi et sa femme, ainsi que Joachim Mumputu, prennent la fuite. Le camp se déplace vers le village Kintwala. Une équipe conduite par Ndabala, qui tend des embuscades aux environs de Buluem, parvient a blesser plusieurs soldats. Dans leur fuite, les militaires laissent cinq fusils automatiques Fall sur le terrain. Celestin Akaka, Nzomba et Justin Malutshi montrent à Léonie leurs mains blanches, elle regarde leurs pieds grisâtres, sur tout le corps ils ont la peau jaune, leurs cheveux aussi ont pris une couleur brun pâle: c'est l'anémie. Début novembre, court déplacement pour arriver dans la forêt de Dungu. Le 5 novembre, la colonne en marche y subit une attaque des militaires accompagnés de civils ngoli. Une fille, Emma, et plusieurs autres partisans sont arrêtés. Les partisans paniquent, se dispersent dans une forêt qui baigne dans l'eau stagnante, ils courent, tombent, pataugent dans la boue froide : à cet endroit, les rayons de soleil ne percent jamais jusqu'au sol. Comme toujours, Abo marche sur les traces de Mulele qui se hâte entre les arbres et les lianes mais ne court pas. Il est rare qu'on voie courir ce léopard-là. Les guides dinga, familiers de la région, ont disparu. Deux cents partisans se retrouvent autour de Mulele. Bengila s'est perdu. Les deux amis inséparables, Mulele et Bengila, ne se retrouveront qu'une année plus tard, dans une geôle de Mobutu. La terre étant trop humide, comme les autres partisans, Abo passe la nuit assise sur un tronc d'arbre, somnolente, le cœur sursautant au moindre bruit, dormant dans les courts espaces d'inconscience entre deux frayeurs. Dans l'aube froide, deux cents somnambules avancent sur un étroit sentier de forêt, écrasé entre deux poussées d'arbres et de verdure. Quelques partisans se sont écartés pour chercher des feuilles de manioc dans des champs abandonnés, vite reconquis par les troncs et les tiges de cette armée verte toujours prête à bondir. Des villageois les y surprennent, les arrêtent. Sur Mulele court un homme en pagne qui s'écrie, tout fier: - Nous avons arrêté les gens de Mulele. - Où se trouvent-ils? Conduisez-nous auprès de vos prisonniers. Mulele, dans son uniforme militaire, devance la colonne, suivi du villageois, sur les talons duquel marche, lui aussi en tenue kaki, Ngwensungu. Tout à coup, de front, des coups de fusil. Panique dans la file, réplique de Mulele et de Ngwensungu. Les partisans s'enfoncent dans le mur vert, le cadavre de l'indicateur barre le sentier abandonné. Dix mètres plus loin, sous un palétuvier, le partisan Léon Nkutu, à demi englouti dans une mare, expire les doigts crispés sur la radio du camarade en chef dont il a la garde. Les partisans n'ont pas le temps de se frayer un chemin à la machette, ils se jettent dans le feuillage, dans les arbustes et les lianes, ils se ruent sur les épines, des pointes en acier de deux centimètres qui étrillent le visage jusqu'au sang, déchirent les vêtements, tracent un enchevêtrement de traits sanglants sur les bras, les épaules, les jambes. Ils courent à travers des herbes aussi tranchantes que des lames de rasoir. Mbumpata, qui se sacrifie en prenant le i levant, a le corps tout rouge comme un jeune danseur huilé ,i la kola pour une fête. En courant derrière Abo, Monique Qo se fait toute petite pour mieux protéger son enfant qui bringuebale sur son dos. On passe la nuit dans la forêt d'It éré Bifari, le village où règne comme un roitelet le père de Muzungulu.Le lendemain, on s'enfonce plus profondément dans la lorêt vierge, direction Mananga. On fait une heureuse ren-< outre avec des Badinga, une corbeille pleine de mamonja sur le dos. Il y aura une petite poignée de manioc pour chacun. Pendant tout l'après-midi, les partisans sont harcelés, jusqu'à la crise de nerfs, par des nuées d'insectes, les emwe, dix fois plus petits que les moustiques mais ivres de sang. Ils passent la nuit près d'Ebaya à six kilomètres de la rivière Kamtsha. Mulele veut chercher refuge sur la rive gauche. A l'aube du 8 novembre, les maquisards prennent la direction de la rivière. Après quelques heures de marche, Joseph Malopo se retire pour faire ses besoins. A son retour, des soldats surgissent devant lui et l'abattent. L'arrière-garde de la colonne s'élance au devant des assaillants. Orner Bakanga recevra une balle ennemie en plein front et s'effondrera, les bras autour de son Fall. Petit de taille et très foncé de peau, taciturne, il était toujours le premier volontaire pour toutes les actions dangereuses. Les partisans sentent qu'avec la mort de ce commandant de compagnie, ils perdent le brave entre les braves et un des derniers ramparts contre la débandade. Mulele rencontre deux vieux Bayanzi et leur demande où l'on peut traverser la Kamtsha. Les villageois conduisent la colonne sur la route qui longe la rivière jusqu'au point de passage où elle n'a que cinquante mètres de largeur. En tirailleur, les partisans entrent dans la forêt pour s'approcher de la Kamtsha, ils descendent une pente et se retrouvent au bord de l'eau, sur une étroite bande herbeuse. Ils font face à deux cents mètres de ntaba-ta, de forêt inondée. Les palétuviers ont de longues racines, comme des tentacules menaçants qui essaient de retenir l'eau. La plupart des hommes s'affaissent, désespérés, exténués, à bout. Delphin Mbumpata et Valère Munzele commencent à couper des palétuviers, à l'aide d'une machette. Abo cherche des lianes qui rampent par terre et qui serviront à lier les troncs d'arbre. Elle ne dort pas de toute la nuit. Juste avant le lever du soleil éclate une fusillade. L'armée, qui a suivi les traces de la colonne, descend la pente. Sur l'étroite bande de terre, l'état-major fuit en amont de la rivière, le bataillon descend en aval. Les militaires se voient offrir un champ de tir comme à l'exercice. Mulele, au milieu, ne court ni à droite, ni à gauche, il s'apprête à entrer dans l'eau du ntabata, lorsqu'un militaire se rue sur lui. Un jeune partisan descend l'agresseur, arrivé à trois longueurs de bras de Mulele. Abo a son sac au dos, entend les balles frôler sa tête lorsqu'elle voit Mulele s'avancer dans l'eau. Elle y saute aussi. Ses pieds s'enfoncent dans la boue. Bientôt elle se trouve jusqu'à la taille dans l'eau glaciale. Pour avancer, elle s'accroche aux racines qui plongent comme des pinces. A trente mètres de la berge, seule sa tête émerge, cachée sous les racines d'un arbre comme derrière une fenêtre grillagée. Pendant une heure, des coups de fusil retentissent, puis s'éloignent peu à peu. L'après-midi, une quinzaine de partisans sortent du ntabata. Léonie s'est efforcée de tenir son fusil au-dessus de l'eau, mais il faut quand-même le sécher et le nettoyer. Le commandant Ntsolo a jeté son arme. Mulele le menace d'un tribunal de guerre et d'une condamnation à mort s'il ne court pas dare-dare retrouver ce qui fait de lui, Ntsolo, un militaire et un commandant. Un révolutionnaire et, a fortiori, un chef, rend plutôt son âme que son fusil. A bout de nerfs, Ntsolo éclate en pleurs. Mais le camarade en chef ne plaisante pas et Ntsolo part, avec quelques partisans, récupérer les fusils abandonnés, dont le sien, et identifier les morts. Le pauvre Ntsolo, au moment de reprendre possession de son fusil, regarde du côté de la forêt. Son sang se glace lorsqu'il y découvre le corps inanimé de sa femme, Alphon-sine Mumpende. A côté d'elle, les cadavres de deux autres filles, Marceline Mulopo, qui voulait tant rentrer chez elle pour que son clan ne s'éteigne pas et Eugénie Lalumbongo. Un partisan sauve un pagne et une photo de Marceline qu'il remettra plus tard à la famille à Matende Iwungu. Célestin Akaka, le secrétaire de Bengila, Justin Malutshi, le secrétaire du bureau du camp, Nzomba, le jeune partisan pende, tous les trois anémiques, n'ont pas eu la force de fuir et ont été abattus sur place. Richard Isita, l'officier d'ordonnance de Pierre, a aussi trouvé la mort. Plus tard, Abo verra deux corps flotter sur l'eau: Valère Munzele et Stéphane Etshwe se sont noyés lors de la fuite. 16. 10 novembre 1967 - fin août 1968, A Kimpundu Mbwitsambele - Table de matières Quatorze disciples autour de Mulele. Mulele et Abo, seuls dans la brousse de Kimpundu. Mulele protégé par les chefs de village. Dispute conjugale. Arrivée du MPR, présence d'une délégation de Brazza, conduite par Ndabala. Le radeau effectue sa première traversée à la tombée de la nuit. Le pagayeur s'assoit à genoux et fait avancer son assemblage de quatre troncs de palétuvier à l'aide d'une planche. Le bois extrêmenent léger ne supporte que deux passagers et il s'enfonce parfois complètement sous l'eau. Pour cet adieu au maquis, la nature observe un silence impressionnant, souligné par quelques frémissements des rares ondes. La lune déverse une poudre d'argent sur les cimes des arbres et transforme la rivière en voie lactée. Par intermittence, deux silhouettes accroupies sur un radeau glissent sous le clair de lune. Comme image de paix, on ne trouverait guère mieux. Les maquisards viennent de perdre leur dernière bataille. La lune, au moins, a pitié de nous, dit Mulele. Vingt-cinq partisans atteignent la rive gauche. Ils ne peuvent pas faire de feu et grelottent toute la nuit dans leurs vêtements mouillés. A force d'être restés des heures dans l'eau, tous ont la peau des pieds blafarde et ridée et ceux de Mulele sont gonflés au point de lui rendre la marche difficile. Le lendemain, les partisans doivent prendre la fuite devant des villageois yanzi qui les pourchassent avec des chiens. Le 10 novembre, Mulele se repose dans une clairière après avoir enlevé ses chaussures pour calmer la douleur de ses pieds toujours gonflés. Mais une nouvelle attaque surprise l'oblige à se sauver pieds nus. Le jour suivant, des partisans s'égarent au cours d'une autre fuite éperdue et Mulele n'est plus entouré que de quatorze disciples. Il en envoie six en mission, conduits par Ngwensungu, pour ramener Bengila. Des villageois yanzi de Kimbimbi conduisent Mulele et ses huit fidèles dans une cachette idéale, sur un kinsanga, un îlot au milieu de la Kamtsha. Enfin du repos. Enfin de la tranquillité. Les nuits offrent à nouveau le sommeil, les journées s'ouvrent à la causerie, à la pêche, à la rêverie. Sur cette île au-delà du maquis, elles sont trois femmes, Léonie Abo, Geneviève Ngulanzungu qui vient de perdre son mari Stéphane Etshwe, et une fille dont Léonie ne se rappelle plus le nom. Mulele a pu sauver son secrétaire, Vital Ipolo, puis il y a Delphin Mbumpata, le frère d'Abo et deux partisans, Itono et Odon Bwal. Les rescapés de mille dangers et de mille morts. Ils se réservent quatre semaines sur cette île de rêve pour revenir à la vie. Le chef du village leur a offert des lignes de pêche et des hameçons, du manioc, du piment et du ngai-ngai, de l'oseille cuite. Un jour, des pêcheurs découvrent une présence humaine sur l'île inhabitée. Le premier d'entre eux à aborder reconnaît immédiatement Pierre, qu'il a rencontré à Banda Buzimbila. - Et maintenant vous me pourchassez? lui demande Mulele. - Les villageois sont terrorisés, répond le pêcheur. Les militaires leur ordonnent d'attraper tous les partisans qui sortent de la forêt. S'ils désobéissent, les militaires séviront contre eux pour complicité avec les rebelles. Finalement, dans leur grande pirogue toute neuve, les pêcheurs conduisent Mulele et ses hommes quinze kilomètres en amont de la Kamtsha. Dans la brousse d'Intshwem Mukongo, Geneviève Ngulanzungu et son amie disent adieu à Mulele. Les six restants passent par Ibiala et Ibubu, s'arrêtent en brousse pour manger des fruits sauvages, continuent sur Pangu et Mwefu, Mulele toujours claudiquant sur ses pieds blessés. Ils s'attardent quelques jours près d'Ibutsu où ils avaient été si bien accueillis en 1963, puis l'année passée, en 1966. Deux villageois aperçoivent les partisans et courent prévenir le chef de leur présence. Le patriarche d'Ibutsu, connaissant ses devoirs, se lance avec les plus vaillantes de ses ouailles dans une battue à la recherche des rebelles. Ayant repéré les six vagabonds, il les suit à distance jusqu'à la forêt de Busongo. C'est à ce moment que le chef d'Ibutsu reconnaît le commandant en chef et que, pris de gêne et de honte, il reste cloué sur place, la bouche grande ouverte, sans pouvoir émettre le moindre son. - Pardon, réussit-il finalement avec peine, je pensais que c'étaient des partisans. Je ne savais pas que c'était toi. - Mais moi, je suis qui? lui demande Mulele. Je suis aussi un partisan. - Taat, pardonne-moi. Et il ordonne à un de ses hommes d'aller chercher une calebasse de vin de palme. Le 17 décembre, les quatre compagnons de Mulele et d'Abo accélèrent le pas, les distançant peu à peu. Ils ont dépassé Inkasambu, s'approchent de Mulembe, ils reniflent déjà l'air du village natal. Que va-t-il se passer maintenant? Mulele a-t-il l'intention de se livrer aux militaires? Serons-nous exécutés à ses côtés si nous nous laissons prendre avec le grand léopard? Mulele leur crie: - Be mpfu ayisa kwa? Vous faites un complot, là-bas? Arrivés à minuit devant une rivière, les quatres partisans déposent fusils, sacs et couvertures et se sauvent en courant retrouver leur famille. Pliant sous une charge supplémentaire, Mulele et Abo poursuivent seuls la route. A deux heures de la nuit, ils arrivent à Bukundu, village apparemment abandonné. Léonie part seule à Kimbanda et y retrouve la maison d'Elil. Au vu d'Abo, Elil sursaute, il croit voir une revenante. C'est bien toi, Abo? Peu après ils rejoignent Mulele dans la brousse entre Bukundu et Kimbanda. - Comment se portent les partisans depuis leur sortie de la brousse? - Ils ont beaucoup souffert. Il faut les sonder un à un pour connaître leur pensée réelle. - La terreur des militaires a été terrible. Nous avons tout perdu. Depuis longtemps, j'ai dit qu'un jour je serais seul. Dans l'adversité, les bons militants montreront leur valeur. - Veux-tu qu'ils reviennent auprès de toi? - Non, nous manquons de cadres. Si moi j'avance, derrière moi il n'y a rien. Seule dans la brousse avec son mari, Abo se demande ce qui va lui arriver. Les villageois vont-ils nous obliger à sortir? Les militaires viendront-ils nous tuer sur place? En pleine brousse, Mulele installe à l'abri de quelques arbres, un petit bivouac pour se protéger de la pluie. Le 12 janvier, Joseph Mbulu, le chef du groupement Kimbanda, prévenu par Elil, vient s'entretenir avec Mulele. Joseph Makindua, l'ancien chef d'équipe de Kimpundu qui l'accompagne, restera avec Pierre en brousse, faisant de temps à autre des missions dans les villages. Mulele se déplace vers un petit bois auprès d'un ruisseau du nom de Manzonzi. Trois semaines plus tard, il cherche refuge, six kilomètres plus loin, près de la rivière dans la forêt dense à Kimpundu Mbwitsambele. Pendant cinq mois et demi, il s'y sentira à l'aise. Début février, Mulele envoie Elil et Kambulu au dépôt de Banda Buzimbila récupérer quelques médicaments et de la poudre de chasse. Entre les arbres assez denses de la brousse, Mulele se déplace de Kimpundu à Lukamba Bozombo pour s'entretenir avec le chef Ekwalanga de Sodome. Pendant que les deux chefs devisent, Abo, Elil et Kambulu enterrent une malle métallique dans un nouveau dépôt sur la colline. Retour à Kimpundu Mbwitsambele après trois jours. Ekwalanga a évoqué un drame épouvantable qui a frappé la famille d'Abo. Cela s'est passé il y a deux ans. Tout un groupe de villageois se rendait de Matende Iwungu à Lukamba Ingudi. Charlotte Mumputu et Anzawe, les deux sœurs d'Abo, en faisaient partie. Elles portaient de grandes bassines de manioc sur la tête. Une équipe de partisans les a surpris devant la rivière Saoul. Sans contact avec Mulele, sans direction, traqués jour et nuit par l'armée, abandonnés par la plupart des villageois, les jeunes balançaient entre le désespoir et la rage impuissante. Ils ont accusé les villageois de vouloir se rendre chez les militaires à Lukamba pour leur offrir de la nourriture. Ils ont sorti leurs machettes et commencé à sabrer dans le tas. Personne parmi les pauvres villageois n'a survécu. - Qu'est-ce que tu veux que je dise? a murmuré Mulele. Avant que je vienne au maquis, les intellectuels m'avaient dit à Kinshasa: Que celui qui a le courage commence d'abord, nous suivrons. Mais voilà. Personne ne m'a suivi. Les intellectuels comprennent bien qu'il faut faire la révolution, mais ils ne veulent pas souffrir avec la population. Nous avons manqué de dirigeants capables d'encadrer la masse et de la discipliner. Vous voyez maintenant, comment peut-on faire la révolution dans l'anarchie? Début mars, les chefs de village de Kimbanda et de Kimpundu apportent une nouvelle inquiétante : - Le père Robert Delhaze d'Iwungu Matende, le Blanc qui, en 1964, a fait mitrailler la mission parce qu'il la croyait occupée par les partisans, a appris ta présence. Il est parti pour Kikwit, t'offrir en cadeau à l'armée. Valère Mukubu, le chef de secteur de Lukamba, ne sait plus sur quel pied danser. Il craint les soldats. Puis, d'un ton mal assuré, les chefs de village poursuivent: - Valère sait que tu es seul avec ta femme. Il nous a demandé de te ramener au village. Dévisageant les assistants, Mulele prend une mine affligée et commence à chanter la plainte souvent entendue devant le tribunal pour avouer une faute. - Aïe me label! Aïe me label! Ah, je suis coupable. Troublés, les chefs demandent: - Devons-nous t'emmener au village, papa? Qu'en penses-tu? - Si c'est cela que vous voulez, faites-moi sortir de la brousse. - Non, ce n'est pas notre idée. - Si vous refusez, je vous arrête et je vous garde ici. Voilà les chefs plongés dans l'embarras. - Il y a deux nœuds, continue Mulele, un nœud autour de mes mains, un autre autour des vôtres. Qui va dénouer les nœuds, vous ou moi? Envoyez une délégation chez Valère pour trancher cette question. Après le départ des délégués, des villageois apportent du vin de palme. Mulele et les chefs "en état d'arrestation" causent jusqu'à l'aube. Les militaires arrivent à Lukamba le 10 mars 1968, et convoquent les chefs de village et de groupement. De source bien informée, nous apprenons que Mulele se cache à Kimpundu. Les chefs nient en bloc: Vous savez, maintenant il y a tellement de rumeurs, les gens paniquent si vite, ils voient des esprits partout. Les militaires se rangent bien volontiers à ces fables. Eux aussi boudent la guerre. Ah non, nous n'allons pas recommencer cette histoire! Le lendemain les chefs font rapport auprès de Mulele. - Nous avons dit que personne ne t'a vu dans les parages. - Pourquoi avoir menti? - Nous ne voulons pas te trahir. S'il le faut, ce sera l'arrestation et la mort de nous tous. - Et Valère? - Il veut venir te voir. - Il ose dire que je suis seul. Je lui montrerai mon armée. Parmi les chefs se trouve Boni Ebondo qui vit sur sa plantation de palmiers près de la rivière Edzim entre Mungai et Kimbanda. Sa deuxième femme, Léonie Aluem, qui l'accompagne, était avec Abo à l'école de Totshi; a deux elles préparent la nourriture des hommes qui palabrent. Valère Mukubu arrive le soir du 13 mars. Mulele a convoqué des partisans de Kimbanda, Mungai et Kimpundu, une vingtaine au total. Pendant que Mulele discute avec son hôte sous un dais spécialement aménagé pour l'occasion, ils doivent défiler de temps en temps devant Valère Mukubu pour lui donner l'impression d'avoir vu au moins quelques centaines d'hommes. Impressionné par l'imposante garde qui entoure le commandant en chef, Valère part à trois heures de la nuit. A Kimpundu Mbwitsambele, chaque matin quelques dizaines de villageois viennent causer avec Mulele. Ils amènent du manioc, de la viande et du vin de palme. Parfois ils sont une cinquantaine et ils partent toujours au crépuscule. Une nuit, le commandant Ngwensungu fait une apparition inopinée, accompagné de Boni, un partisan dinga qui porte la mitraillette de Bengila à l'épaule. Théo, dénoncé par son parent, l'abbé Rémy Mukitshi, a été arrêté par Nestor Mutunzambi au village Lubonsi-Lamba. Les visiteurs à peine installés dans un bivouac, des villageois de Mungai annoncent que le même Mutunzambi a fait son apparition chez eux. - Il veut savoir si Mulele erre toujours dans la brousse. Personne n'a voulu l'accueillir, le nourrir ou le loger. Des vieux lui ont offert une calebasse de vin de palme empoisonné. Il a eu le ventre gonflé mais, excusez-nous, camarade en chef, il n'est pas mort. A la mi-avril, cela fait quatre mois que Mulele et Abo se cachent en brousse. La révolution est-elle finie? Abo ne saurait répondre. Depuis cinq ans, la brousse nous sert de maison. Mais étant seuls, avons-nous encore un avenir? Continuerons-nous à vivre dans l'unique attente de la mort? Qu'est-ce que Mulele a en tête? L'inquiétude, l'incertitude, le froid de la nuit, le soleil de plomb, tout cela tape sur les nerfs. Pour un rien, Mulele se chamaille avec sa femme. En Afrique, un homme placé dans les conditions les plus difficiles et précaires, trouve toujours un être sur qui dévier sa rancune, sur qui dévider son chapelet d'amertume et de rancœur: sa femme. Du moins, c'était le cas avant que vienne la révolution, avant que les filles suivent les leçons politiques pour y apprendre, avec maintes difficultés, après de multiples répétitions tant le message semblait étrange sinon incroyable, que l'homme et la femme sont égaux. Les filles n'y croyaient pas. Les instructeurs politiques ont répété inlassablement leur leçon. Ils avaient autant à se convaincre eux-mêmes qu'à faire passer l'idée chez les filles. A son arrivée au maquis, Abo écoutait sans comprendre. Son expérience de la vie lui disait que les hommes, les pères, les oncles, les frères, les maris, disposent de la vie et de l'avenir de la femme. Un homme verse la dot derrière ton dos et ton sort est scellé. A dix-huit ans, la coutume et la religion chrétienne coalisées lui avaient inculqué ces vérités. Aujourd'hui adulte - Abo a vingt-trois ans - il ne faut plus lui faire la leçon politique, elle les connaît toutes par cœur. Cinq années de révolution l'ont trempée, un peu comme l'acier fut tremp é dans ce livre soviétique dont parlait Pierre. Les femmes sont debout, elles ont porté plus que leur charge dans cette révolution. Et après tous ces combats,Mulele, perdu dans des réflexions sur un passé inextricable et un avenir incertain, s'imagine-t-il qu'il peut encore frapper sa femme? Lors d'une chamaillerie, il s'y risque. Il la frappe sur la tête. Mais il n'a pas prévu la réaction. Abo lui serre le cou de ses mains puissantes. Le chef de guerre étouffe, le sang fait bourdonner ses oreilles. Il peut s'estimer heureux que Joseph Makindua ait accouru pour séparer le couple. Abo s'enfuit dans la brousse, se cache sous un arbre non loin du camp. Le matin, une trentaine de villageois, accueillis par le commandant en chef, s'étonnent: Camarade, nous ne voyons pas ta femme? Joseph trouvera Léonie, endormie sous son arbre. - Viens, la population veut te voir. Elle reste avec les villageois jusqu'à ce que le soleil éteigne lentement le violent brasier rouge au dessus de la brousse. Abo a déjà oublié l'incident de la veille. Mais pas Mulele. - Tu as voulu montrer ta force, tu pensais pouvoir m'étrangler? Et des coups pleuvent. - Si tu es tellement têtue, je te ferai mettre à la commande. Ce sont justement les paroles qu'il ne fallait pas prononcer. - Une fois, mais pas deux. Tu m'as mise une fois à la commande et je ne l'accepterai plus jamais. Les partisans, appelés pour ligoter la femme rebelle, reçoivent sa main lourde et ses griffes en plein visage. Ils ne sont guère convaincus de la sagesse du chef dans cette affaire. Abo échappe à ses assaillants, s'enfuit, tombe sur un arbre couché, se blesse gravement le genou mais poursuit sa course. Pendant des heures, elle reste assise sous un arbre, en proie à toutes les peurs et inquiétudes. Où pour-rais-je partir? En pleine nuit, elle se met à courir, elle se jette dans le mur d'herbes, dans une folle escapade, une fugue désespérée, elle fonce dans la brousse qui la surplombe, qui se referme sur elle comme une mousse après avoir cédé sous son élan. Tout à coup, Abo se trouve face à face à un animal sorti de la nuit et tout aussi ébahi qu'elle. Abo passe et continue sa course folle. A trois heures de la nuit, elle frappe à une porte à Kimpundu Mbwitsambele. Les braves gens la conduisent auprès de Kilutu, le chef du village. - Ma sœur, qu'est-ce qui t'arrive? Elle lui explique la chamaillerie, le tapage matrimonial, le passage à tabac, la riposte et la fugue. - Tu ne peux pas rester ici. Il y a de mauvaises gens au village. Ils iront prévenir les militaires. Le chef Kilutu reconduit Abo au camp. Il y arrive vers quatre heures et demi, absorbé dans de graves pensées. - Chef, je ramène ta femme. Que se passe-t-il? - Elle sait qu'elle ne peut pas aller au village. Si les militaires l'attrapent, ce sont les villageois qui mourront. - Non, ce n'est pas ça, chef. Elle est venue chez moi, qui suis son frère, demander conseil. - C'est ma femme, elle fait la tête. - Chef, ce n'est pas bien ce que tu fais. Nous venons ici pour recevoir de l'éducation, pour écouter les leçons politiques et maintenant tu vas te battre avec ta femme? Ce n'est pas bien. Tu devras payer une amende. L'air maussade, Mulele obtempère. Quand le chef a commis une gaffe, il doit payer une amende. Ainsi le veut la coutume. Un jour, des villageois, apparemment troublés, s'assoient sous le dais. Il faut que le camarade en chef leur explique. Dans les villages, des gens s'amènent avec cette histoire du MPR. Ils prétendent que MPR veut dire Mulele Pierre Révolution. Ils nous demandent d'acheter les cartes de ce MPR. Et Mulele d'expliquer quelle sorte de révolution Mobutu prêche. Ce type, commence-t-il, a mené, avec l'aidé de mercenaires sud-africains, d'officiers belges et de pilotes américains, une révolution contre les villageois, les ouvriers et les autres enfants du pays. Mobutu s'abouche avec nos pires ennemis et il boit leurs paroles, mais quand il se présente parmi nous, il parle notre langage révolutionnaire pour mieux nous tromper. C'est un fraudeur et un copieur. Moi-même, j'avais rédigé au maquis, dans les environs d'Eyene, des documents pour créer un Mouvement Populaire de la Révolution. Les militaires s'en sont emparés. Et maintenant, Mobutu, qui a toujours combattu la révolution et le peuple et qui continuera à le faire, copie nos idées et nos mots d'ordre pour vous désorienter. Si vous achetez ses cartes, vous lui donnerez encore plus de force pour qu'il puisse revenir nous tuer. Il serait mieux de vous cotiser pour que nous puissions nous préparer à une nouvelle lutte. Les villageois retrouvent le rire, manifestement délivrés d'un poids étouffant. En prenant congé du chef, ils expriment leur joie d'être arrivés à conclure une affaire difficile en chantant:
Le tribunal des Bambunda Les chefs de village de Kimpundu, de Kimbanda et de Lu-kamba commencent d'emblée à récolter les contributions. Bientôt un mouvement d'émulation se développe dans tous les villages de la région, s'étendant jusqu'à Idiofa, à Gungu et à Kikwit. On achète des cartons de poudre de chasse et on les cache dans les dépôts de Kimpundu. Le 5 mai 1968, une cinquantaine de villageois sont assis en cercle autour de Mulele dans la brousse de Kimpundu Mbwitsambele, lorsque des partisans introduisent Dieu-donné Ndabala. Arrêté dans la forêt d'Itéré, le 8 novembre, Dieudonné a réussi à s'échapper de la prison et à rejoindre Brazzaville. Le Parti Communiste Congolais, récemment créé par des lumumbistes à Brazza, l'a chargé de contacter Mulele au maquis du Kwilu et lui a adjoint un de ses membres, Paulin Muzimbiriki. Au cours de nombreuses conversations qu'il mène avec la délégation, Mulele se rend compte que le lumumbisme à Brazza est rongé par la passivité et la désunion. En cinq ans, ces gens n'ont jamais réussi à créer ne fût-ce qu'une seule liaison avec le maquis. Ils ont pris l'avion pour Pékin et pour La Havane, mais aucun de ces combattants formés politiquement et militairement n'est venu faire la démonstration de ses connaissances au Kwilu. Des armes sont arrivées à Brazza à destination du maquis, mais aucune d'elles n'en a pris le chemin. Mulele ne doit guère insister auprès de Ndabala pour faire comprendre ses intentions. Il faut d'abord avoir la volonté de lutter. Tous les lumumbistes de Brazza doivent donc rejoindre immédiatement le maquis. En plus, il faut l'unité dans la lutte. Qu'ils cessent ces chamailleries et ces scènes de ménage à l'étranger. Musimbiriki aussi semble comprendre. Pourront-ils convaincre les chefs lumumbistes à Brazza? Le 11 mai, Mulele remet trois lettres à la délégation, sur le point de repartir: un message pour Brazza, un autre pour Gizenga et un troisième pour Kabila, à l'Est. "La plupart des intellectuels qui n'ont suivi aucune formation politique nagent dans l'opportunisme; on ne peut les considérer comme d'authentiques cadres de la révolution. Bien que nous comptons sur vous qui êtes à l'extérieur, nous ne perdons pas de vue que la révolution doit se faire sur notre propre sol. Dans ce combat, notre force, sans laquelle rien n'est possible, est constituée par les masses populaires. Sans elles, on ne peut pas parler de révolution. Je peux affirmer de la façon la plus catégorique que notre révolution a la confiance des masses qui y restent fortement attachées. Les chefs coutumiers nous ont apporté pendant cinq ans leur aide morale et matérielle. La création de ces innombrables partis à l'étranger est l'œuvre des ennemis qui se servent de Congolais pour diviser nos forces. La fondation d'une nouvelle organisation devra se faire à l'intérieur. Un parti d'avant-garde ne pourra être créé que lorsque tous les responsables auront été contactés". Avant de quitter Kinshasa pour le maquis du Kwilu, Ndabala avait rendu visite à Bengila dans la prison du camp Kokolo. Mulele le presse d'aller rendre visite à Théo à son retour dans la capitale. - Souhaite-lui beaucoup de courage de ma part. Devant les ennemis, sous les souffrances, un bon partisan ne recule jamais et ne trahit jamais ses convictions politiques. Dis à Théo qu'il profite de l'occasion pour donner quelques leçons politiques aux militaires. Puis Mulele ajoute: - Si Nima et Mibamba, vos dirigeants à Brazzaville, ont de l'argent, ils doivent tout d'abord en donner une partie à Eugène Munene, le mari de ma sœur. Il pourra corrompre les militaires pour que Bengila puisse s'échapper et revenir au maquis. Après le départ de Ndabala, Boni occupe ses journées à recopier les leçons politiques d'après l'original, dans des cahiers d'écolier. Abo parviendra à les sauver à sa sortie du maquis. Le 18 juin, deux émissaires des révolutionnaires de Kikwit rencontrent Mulele. Le premier, Ibanga, est un Mumbunda, le deuxième, Gimafu, chef de secteur, un Mupende. Le même jour, des militaires arrivent à Kimpundu Mbwitsambele. Trois jours plus tard, Mulele fait un déplacement d'une quinzaine de kilomètres, vers Lukamba Bozombo. Il s'y fixe à Sodome dans la forêt sur la colline, près de la maison du chef Ekwalanga. Si les militaires osent se présenter, Ekwa-langa, qui n'a rien perdu de ses pouvoirs magiques, pourra peut-être les foudroyer de ses éclairs. En attendant, il se limite à envoyer de la nourriture à Mulele. Sa femme Lasiel, la sœur d'Abo, fait le va-et-vient. Mulele juge prudent de ne pas faire défiler trop de gens dans son nouveau camp qui compte deux bivouacs et cinq résidents permanents, lui, Abo, Ngwensungu, Makindua et Boni. Un jour, un homme de Kimpundu Mbwitsambele arrive chez Mulele et Abo. Il leur raconte l'aventure que son enfant a vécue au moment où les militaires sont entrés à Kimpundu pour traquer Mulele. Comme les grands restent muets, disaient les soldats, il nous faut tirer des renseignements des enfants. Aussi l'homme avait-il souffert mille morts lorsque les militaires avaient amené son enfant derrière la maison. - Est-ce que tu connais Mulele? - Aïe. - Est-ce que tu as vu Mulele? - Aïe. - Sais-tu où Mulele se cache? - Aïe. - Si tu n'arrêtes pas tes aïes, nous te tuerons. Sans un mot, l'enfant s'est mis par terre, écartant les bras et les jambes comme pour dire: Alors, tuez-moi. Abo comprend. A douze ans, avant que ne commence la lutte pour la première indépendance, on lui a demandé: Est-ce que tu connais Opep, est-ce que tu connais Jean Marteau? Et il fallait répondre aïe, le mot en kimbunda pour dire non, je ne sais rien. Mulele quitte Lukamba le 27 juillet pour prendre demeure entre Kimpundu-Idiofa et Kimbanda. Le lendemain, il y reçoit la visite de Valère Malutshi, un des rescapés de la Kamtsha. Abo note dans son cahier une leçon que Mulele répète souvent devant les villageois. "Faites attention à l'histoire! Une même nation. Deux classes. Un seul chef. La première classe, celle des nobles. La deuxième classe, celle des esclaves. Le chef, d'où vient-il? De la classe des nobles ou de la classe des esclaves? Si le chef venait a mourir, on chercherait un nouveau chef. Ce nouveau chef, est-ce qu'il travaillera pour la classe des nobles ou pour la classe des esclaves? Le MPR, de qui est-il le sauveur? Qui souffre? D'où vient cette souffrance? Qui cherche un sauveur?" Le 4 août, onze soldats viennent fouiner à Kimbanda. Mulele s'esquive. Mais les militaires sont déjà partis après avoir raflé des poules. Le 23 août, Pierre Ngwensungu rentre dans son village, Lungu, près d'Idiofa. Mulele pousse jusqu'au lac Ndanda. A Léonie, Joseph Makindua et Boni, les seuls à l'accompagner, il dit son idée de partir pour Brazzaville. - La population a donné tout ce qu'elle pouvait pour que la lutte recommence. J'ai écrit trois lettres à Brazza pour appeler d'urgence les cadres au maquis. Toujours pas la moindre réponse. Qu'est-ce que je peux faire maintenant? Je pourrais commencer la lutte, mais comme il n'y a pas d'encadrement, nous buterons sur les mêmes problèmes.
Le Bureau de la Santé à Impasi. L'équipe de filles de Léonie Abo - debout, à droite, avec le chapeau. Sur la photo, on retrouve Mathilde Manima, Flaurentine Muke, Marceline Muke, Véronique Muyasa, Eugénie Ente, Nelly Mumbongo et Hélène Pulese. 2 septembre - 29 septembre 1968, Sur les fleuves et à Brazza -Table de matièresMulele et Abo, huit cents kilomètres en pirogue sur les rivières. En résidence surveillée à Brazza, négociations avec le président Ngouabi. Discussions avec les lumumbistes résidant à Brazza, décision de partir pour Kinshasa. Mulele a la folle idée de descendre dans une petite pirogue sur huit cents kilomètres, les rivières Kwilu, Kwango et Kasaï pour traverser ensuite le fleuve Congo et arriver au Congo-Brazzaville. Expédition impossible. Tu es sûr, risque Joseph, que nous pouvons parvenir à Brazza en pirogue? - Kayi kamfa, kayi moyi. Là ou il y a la vie, il y a la mort. Que celui qui craint les loups, n'aille point en forêt. Mulele, Abo, Makindua et Boni achètent de la farine de manioc, des sardines et du sel pour une navigation au long cours. Isidore Kabwat, le grand frère de Léonie, pêcheur de son métier, les accompagne jusqu'à Kiyaka sur la Kwilu. - Si l'on veut entreprendre une action, il faut se décider à la réaliser à tout prix, a dit encore Mulele à Makindua. Bon d'accord, nous ferons huit cents kilomètres sur l'eau. Mais qui sait pagayer? Personne. Mulele demande à Isidore, expert en navigation sur rivières et fleuves, de les conduire à Brazza. - Il n'en est pas question. Tu as déjà ma sœur. Et d'ailleurs, si un jour tu reviens, il te faudra des hommes sur place. Alors Joseph aura deux jours pour apprendre à pagayer et à diriger une pirogue. - Il le faut bien, Joseph, nous n'avons pas de choix. Nous sommes devant un mur. Les partisans veulent revenir. J'ai refusé. Est-ce que je peux me transformer en mille personnes pour diriger tout ce monde? Nous devons ramener les cadres de Brazza. Mulele part le 2 septembre, par une splendide nuit de demi-lune qui éparpille une étrange lumière de paix. Adieu, soleil, et tes feux de guerre dévorants. Nous te reviendrons. Mais concède-nous pour l'instant le clair de lune et la paix pour notre longue marche sur l'eau. Isidore Kabwat accompagne Mulele pour vérifier que son piroguier, Joseph, ne le fera pas échouer sur la première berge ou se fracasser sur le premier rocher. Non, le début est prometteur. A cinq heures, Kikwit dépassé, Isidore laisse Mulele continuer seul son voyage avec ses trois compagnons. Le jour, Mulele se cache en forêt, la nuit il descend sur l'eau. Il porte une tunique bleue et un chapeau, moins voyant que les tenues kaki qu'il n'a pas quittées depuis cinq ans. Il emporte deux mitraillettes et deux revolvers. La deuxième nuit, la pirogue manque de chavirer dans la turbulence causée par un hippopotame de passage. Une heure plus tard, Léonie pousse un cri: encore un hippopotame, tout près, à droite! Mulele regarde et voit un arbre flottant dans la rivière. - Pourquoi m'as-tu suivie? Tu as peur? Tu n'a pas pensé que tu pourrais mourir en route? Puis Joseph découvre des bêtes à droite, à gauche, devant, derrière, c'est affolant comme il y des bêtes dans ces eaux. Mulele ne veut rien entendre, faut aller tout droit! - Nous sommes quatre à penser à ce pays. Nous devons à tout prix arriver à destination. Si la mort nous attend, alors nous mourrons. Ni la peur ni les cris ne peuvent écarter la mort. Le quatrième jour, Mulele le passe dans une forêt en aval de Bulungu. Des pêcheurs remarquent Boni à côté d'une pirogue de forme inhabituelle. Méfiants, ils l'enjoignent de les suivre chez le chef: il est interdit de traîner en forêt. Une demi-heure plus tard, sur instruction du chef, les villageois reviennent ramener tous les étrangers au village. Joseph Makindua leur demande de le suivre auprès de son patron. Quand les villageois reconnaissent Pierre Mulele, qui a mis sa tenue militaire pour l'occasion, ils se raidissent, reculent à petits pas, se retournent brusquement pour fuir comme si leurs pagnes avaient pris feu et se jettent à l'eau. Mulele, Joseph et Léonie sautent en toute hâte dans la pirogue et pagayent à s'en rompre les os. A la radio, Mulele suit les bouleversement à Brazzaville où Massamba Débat a été renversé le 4 septembre, deux jours après le départ des maquisards pour Brazza. Connaissant personnellement Massamba, Débat, Mulele savait qu'il lui réserverait un bon accueil. Mais du coup, l'avenir semble vaguer au hasard. Un Conseil National de la Révolution, présidé par le capitaine Marien Ngouabi, a pris le pouvoir. - Mwana wana nayebi te, ye moto akosukisa ngai, dit Mulele. - Je ne connais pas cet enfant, peut-être cet homme signifiera-t-il ma fin. Près de Bandundu, la pirogue s'approche de la rive, lorsqu'une tête d'hippopotame surgit, de front, au-dessus de l'eau. Joseph vire in extremis et la pirogue touche la berge. En panique, nos trois marins de fortune pataugent dans l'eau, se sauvent dans le bois: si l'hippopotame est d'humeur rancunière, il poursuit les fauteurs de troubles et s'il les rattrape au bord de l'eau, il les écrase sous sa masse de plomb. Cette nuit-là, des nuages voilent le clair de lune sur les largeurs infinies de la Kwilu. Après trois heures de navigation, Mulele découvre qu'il tourne en rond sur un lac. Il pagaye à la recherche des feuilles de la Congo Ja Sica, une plante qui garnit abondamment les bords de la rivière. Détachées, ces feuilles et ces fleurs, portées par les eaux en offrande au dieu de la lune, suivent les courants les plus puissants. Si nous suivons la route des fleurs, réfléchit tout haut Mulele, nous découvrirons le courant principal de la rivière. A Bandundu, Joseph achète un énorme poisson aux pêcheurs locaux. Pour le conserver, on le débite en morceaux que l'on roule ensuite dans du sel. Ça change le menu: depuis Kiyaka, on ne consomme que de la farine de manioc et des sardines. Sur la rivière Kasaï, une lune croissante qui blanchit le ciel, un plan d'eau couleur platine, vibrant, s'étirant à perte de vue. Du monde, rien d'autre ne subsiste. La pirogue longe des bancs de sable où se réveillent, le temps de deux coups d'ailes, des oiseaux blancs. La pirogue glisse le long d'îlots où la brise soulève dans les bambous un bruissement plein d'énigmes. Lorsque se dissipe la magie nocturne, Mulele, à l'aube, accoste sur une île. Joseph allume un feu de bois et pose le poisson sur les braises. Ce jour-là, depuis un bon moment, deux pirogues suivent Mulele à distance. Elles s'approchent. Trois hommes dans l'une, cinq dans l'autre. D'un aspect nullement rassurant. Des brigands, des pirates d'eau douce. Ils pensent aborder bientôt un navire de riches commerçants rempli de diamants. Joseph s'accroupit, rentre la tête: - Ils ont des fusils! Mulele répond: - Laisse-les venir. Quand les forbans se trouvent à deux longueurs de pirogue, Mulele se dresse, sa mitraillette pointée dans leur direction. Il n'en faut pas plus pour qu'ils s'éloignent à coups de pagaie endiablés. Le lendemain, des montagnes se pressent contre la rivière qui, de peur, se rétrécit et se met à galoper. Dangereusement, à certains endroits. La nuit, les trois voyageurs tendent l'oreille au moindre bruit. Dans les rapides, l'eau fouette de grands rochers. La pirogue s'y écraserait. Dès qu'on capte l'écho d'un rapide, on accoste. En plein jour, on pourra voir par où passer sans courir de danger. Le 13 septembre à 5 heures, enfin l'immensité du grand Congo, le pari gagné! Devant Mulele, majestueuse comme le fleuve, la liberté! Après deux heures de lutte contre le fleuve récalcitrant, Mulele met pied à Ngabe. Des pêcheurs le conduisent au chef de village. Bientôt, les rumeurs de la présence du chef maquisard parviennent aux gendarmes qui se pointent devant la case du chef. Au camp de la gendarmerie, Mulele annoncera son intention de continuer la route en descendant le Congo en pirogue, jusqu'à Brazza. Ces derniers jours, Mulele suppute longuement le sort qui l'attendra à Brazza. Comment connaître les intentions des nouveaux dirigeants du Congo? Dans ses moments pessimistes, il marmonne entre ses dents qu'il cherchera refuge à l'ambassade de Chine. Les gendarmes ne lui en laissent pas l'occasion. Ils embarquent Mulele dans une jeep en partance pour la capitale. On y arrive à 17h30. Au camp militaire, les gendarmes s'entretiennent avec le commandant Sylvain Goma. Abo perçoit quelques bribes de leur conversation. - Ce type est très dangereux... Nous ne pouvons pas nous attirer des problèmes avec le gouvernement de Kinshasa... Une maison? Non, trop risqué... Le camp de la milice sera mieux... Dans une salle de réunion aux murs blancs, au premier étage du bâtiment administratif, des militaires ont installé deux lits de camp, une table et quatre sièges. Mulele et Abo y logeront jusqu'au 29 septembre. Joseph Makindua est hébergé dans une petite chambre au rez-de-chaussée. Cinq militaires veillent en permanence. Le lendemain, le commandant Mabiala de la gendarmerie conduit Mulele et Abo au bureau de Marien Ngouabi. Abo reste dans le couloir à méditer sur l'étrange réception qui leur est faite. L'entretien terminé, Ngouabi salue Abo et lui remet 3.000 francs CFA pour faire des achats au marché. Mulele a le moral au zénith. - J'ai dit à Ngouabi que je suis venu à Brazza pour ramener les lurnumbistes au maquis. Il m'a demandé une liste de mes hommes. Il a promis de les convoquer. La femme d'un policier initie Abo aux méandres du marché de Bakongo. Chaque jour, Léonie refoule ses appréhensions en se vouant à la cuisine. Chaque jour, elle voit Mulele partir en compagnie du commandant Mabiala pour des entretiens avec Ngouabi. A mesure que le temps s'écoule, Mulele prend des airs renfrongés, devient d'humeur taciturne. C'est mauvais signe. Par bribes, Léonie apprend ce que Ngouabi a en tête. L'expérience montre qu'une lutte révolutionnaire ne peut pas être menée de l'extérieur. Moi-même, j'ai été rétrogradé et mis en prison sous Massamba Débat. Si j'avais pris la fuite à l'étranger, je ne serais pas arrivé à renverser la situation. Les lumumbistes se trouvent depuis cinq ans sur le territoire du Congo. Qu'ont-ils pu réaliser? Des divisions en grand nombre. Si nous leur donnons encore cinq ans, ils continueront à se chamailler et à végéter. Nous avons envoyé une délégation à Kinshasa. Mobutu lui a déclaré qu'il connaissait l'adresse de chaque lumumbiste se trouvant à Brazza, qu'il n'ignorait pas le moindre de leurs gestes. Vous devez rentrer à Kinshasa. Pour continuer la lutte, il faut se trouver au pays. Un matin, Mulele, au moment où sa femme s'apprête à partir, lui dit: - Je n'ai toujours vu aucun de nos gens. Essaie de prendre des informations au marché, peut-être pourras-tu y rencontrer un des lumumbistes. Avant d'arriver à Brazza, Abo n'avait jamais vu une véritable ville. Kikwit, à l'époque, n'était qu'une bourgade. Après une semaine de présence dans la capitale congolaise, elle se sent toujours une intruse au milieu de la cohue grouillante et criarde — dépaysement étrange après cinq années de vie en brousse. Un jour Abo entre, à l'heure de midi, au camp de la milice. Une conversation animée entre Mulele, Ngouabi, Mondjo, le ministre des Affaires étrangères, et un inconnu vient de se terminer. Après le départ de ses hôtes, Mulele, les nerfs en boule, arpente la chambre. Les Congolais m'ont trompé, grommelle-t-il, Ngouabi m'a présenté ce type, il s'appelle Akafumu Antoine, et je croyais qu'il était un lumumbiste. Je lui ai demandé: Mais qu'est-ce que vous faites ici, à l'étranger? Les masses souffrent, elles croupissent dans la misère, tandis que vous vivez bien à l'étranger. Il m'a répondu que nous sommes des enfants d'une même famille, qu'il est temps que nous marchions tous la main dans la main pour assurer la dignité et le bonheur du Congo, que Mobutu a déclaré Patrice Lumumba héros national. Ça m'a étonné. Ngouabi l'a interrompu pour me dire: II est le mieux placé pour arranger votre affaire. Je comprenais de moins en moins. Mais à la sortie, tout devenait clair. Akafumu est parti dans une voiture diplomatique et je me suis rendu compte qu'il agissait pour le compte de Mobutu. Mulele devient méconnaissable. En s'embarquant dans la pirogue à Kiyaka, il blaguait, fulminait, riait, enivré à l'idée de cette longue aventure sur l'eau, content de retrouver bientôt le Congo révolutionnaire, décidé à ramener les cadres en vue d'un combat revigoré. Onze jours sur les rivières l'ont amaigri. Parfois transi sous la pluie, tenaillé par des insomnies à cause des moustiques, des nuits froides sur l'eau, de la tension aussi, Mulele a la santé ébranlée. Dans sa chambre au camp de la milice, il commence à tousser dangereusement, se plaint de maux de tête. Brazzaville le tracasse, l'inquiète: et si la solution espérée ne s'y trouvait pas? Je n'ai toujours pas vu mes hommes, répète-t-il à sa femme. Je suis ici comme en prison, se plaint-il. Je suis l'hôte de Ngouabi, je dépends de lui. Qu'est-ce que je peux faire? Abo ne sait pas ce qui l'attend. Elle assiste au va-et-vient quotidien de Mabiala, aux convocations de Mulele. Elle ne comprend pas ce qui se passe. Nous sommes venus pour chercher les cadres de la révolution, mais nous ne voyons personne. Le 27 septembre à 21h00, Léonie voit arriver au camp son instructeur militaire des premières heures du maquis, Félix Mukulubundu. A Mathias Kemishanga qui l'accompagne, Mulele dit: - Si j'avais su que tu étais à Brazza, je t'aurais appelé pour amener la révolution en territoire luba. J'avais quatre Baluba chez moi, mais pas de cadres. Puis arrivent trois hommes inconnus de Léonie : Salomon Musikangondo, Zenon Mibamba et Alias Malonga. Ils sont suivis d'Innocent Ndumbu, le même qui a conduit Abo dans son camion jusqu'au maquis, vers Nkata. C'était le 8 août 1963, il y a une éternité. Avec le grand cri des retrouvailles inattendues, Mulele embrasse deux copains, deux conjurés de la vie nocturne à Kinshasa, Ferdinand Nima et Antoine Katassa, le chanteur d'orchestre fort expert en mélodies mbuun et pende. Au maquis, Mulele parlait souvent de ses deux amis avec qui il avait exécuté ses premiers pas en politique à l'aube de la lutte anticoloniale. Abo pressent des événements majeurs. Mais seront-ils heureux, seront-ils malheureux? La chambre est archi-pleine lorsqu'arrivent Michel Mongali, qui fut parlementaire lumumbiste, Louis Mulundu, un ex-frère et Lumbuele, un ancien dirigeant de la jeunesse lumumbiste. Ça discute chaudement dans tous les coins. Enervement. Tension. Assise à l'écart, Abo entend dire: - Le gouvernement ne veut pas qu'il reste à Brazza. Elle se demande: de qui parle-t-on? - Ils ont signé un accord pour qu'il parte à Kinshasa. Se peut-il qu'ils parlent de nous? - Mulele a accepté de partir, ça tournera mal. - Envoyons d'abord une délégation pour voir ce qui se trame à Kinshasa, dit une autre voix. Abo reste perplexe. Ne dit rien, enregistre en silence. Mulele lève le ton, les bruits s'estompent, tous écoutent son récit du maquis. Léonie n'y fait pas attention. Mais elle l'entend dire: - J'étais venu pour vous ramener au maquis. Mais la situation a changé. Qu'est-ce je peux encore faire? Mobutu lance un ballon d'essai. Le gouvernement de Brazza a signé des accords formels avec Kinshasa. Je ne peux pas ne pas y répondre. Qui ne risque rien, n'a rien. Vous dites que Mobutu me tuera. Peut-être. Dans ce cas, l'opinion africaine et mondiale vous donnera raison quand vous continuerez le combat contre ce régime. La palabre s'enflamme, se traîne, se répète pendant toute la nuit. Puis, dans la lueur pâle, dans le mutisme indéfini de l'aube, douze ombres glissent vers la sortie du camp. Ce samedi 28 septembre, quelques heures de sommeil relancent tout le monde dans un état d'excitation extrême. L'après-midi, Katassa et Ndumbu entraînent Abo jusqu'à l'ambassade du Mali puis à celle d'Egypte. Ils y demandent l'asile politique pour leur chef. Ils en rapportent de vagues promesses qu'on enverra un télex à Bamako et au Caire. Entre temps, Mulele s'est rendu chez Ngouabi. Il lui a parlé de la maladie qui le mine et de son souhait de se faire soigner avant d'aller à Kinshasa. Ngouabi lui a répondu que, comme des accords ont été signés, il vaut mieux partir demain. Tu pourras revenir ensuite à Brazza pour des consultations médicales. Le soir, les lumumbistes se perdent encore en parlotes. Ndabala, qui vient d'arriver, mentionne qu'à son retour du maquis, en mai dernier, il a vu Bengila en prison. Et il a noté sur un petit bout de papier le message que Bengila lui a transmis. "Dans la lutte, il y a des perdants et des gagnants, des morts et des survivants. Ceux qui restent ne doivent jamais se décourager, ils doivent toujours être animés d'un noble idéal, celui de continuer la révolution jusqu'à la victoire finale. Le camarade Mulele ne va pas abandonner la révolution parce qu'il m'a perdu, moi qui suis capturé par les militaires. Si vous apprenez un jour qu'on a arrêté ou tué le camarade Pierre, il reviendra à vous de continuer le combat jusqu'à la victoire." Le dimanche 29 septembre à onze heures, Mulele se rend sur le bateau présidentiel à la réception offerte par le ministre des Affaires étrangères de Kinshasa, Justin Bomboko. Ndumbu s'y mêle au personnel civil vêtu d'élégants costumes blancs. Ce sont tous des militaires, dira-t-il à Mulele, et ils se promettent de te tuer. De retour au camp, Mulele dit devant tous les lumumbistes: - Je suis à votre disposition. Faites ce que vous voulez pour sauver ma vie. Lumbuele et Mibamba se précipitent à l'ambassade cubaine, toute proche, demander l'asile. Pourquoi les lumumbistes ont-ils couru, la veille, toutes les ambassades, sauf celle de Cuba? Mystère. De toute façon, ils n'y ont pas bonne renommée. Les Cubains et les Chinois leur ont donné de l'argent et du matériel pour Mulele. Rien n'est parvenu à destination. Lors d'une dispute échauffée, hier soir, Ndabala a accusé Mibamba d'avoir trahi Mulele, d'avoir saboté son action au maquis. En plus, Mibamba est partisan du retour à Kinshasa. Qu'a-t-il dit à l'ambassade cubaine? Autre mystère. A quinze heures, Mulele s'y rend, conduit par le commandant Mabiala. Une heure plus tard, Léonie Abo et Théodore Kabamba entrent à leur tour chez les Cubains, trouvent tout le monde assis dans le salon. Mabiala, transpirant de la tête aux pieds, dit qu'il est temps de partir au beach, le bateau attend. Léonie s'exclame: - Si vous acceptez que Mulele parte, il sera certainement tué. L'ennemi, c'est l'ennemi. -Comme il y a un accord signé, il peut partir, lui répond un Cubain. 18. 29 septembre 1968 - 30 mars 1969, A Kinshasa - Table de matières Arrivée à ïétat-major de Bobozo, trois jours dans la parcelle de Bomboko. Arrestation de Mulele. Abo et neuf femmes enfermées au camp Kokolo. Bruits sur l'assassinat de Mulele, fuite d'Abo pour Brazza. Avant que le bateau accoste la rive gauche du Congo, du côté du mont Ngaliema, le paysage devient flou devant les yeux d'Abo. Mille inquiétudes la tourmentent: qu'est ce qui nous attend de ce côté-ci du fleuve, la vie ou la mort? Avant le départ, toute la délégation de Brazza, conduite par le ministre des Affaires étrangères Nicolas Mondjo, a quitté le bateau présidentiel. Abo avait pensé qu'elle accompagnerait Mulele à Kinshasa. Contrairement à ses attentes, le navire ne s'est pas dirigé tout droit vers le beach, lieu d'accostage habituel, mais a descendu le fleuve. Que se passe-t-il? A l'arrivée au Mont Ngaliema, près de l'état-major de l'armée, avant de s'engager sur la passerelle, les maquisards entendent des coups de fusil. - Ecoute, dit solennellement le ministre Bomboko, l'armée t'adresse ses salutations. A l'amarrage, Mulele retrouve sa mère et Hygen, son fils aîné. Sans mot dire, Mulele les embrasse, n'ayant d'yeux que pour Abiba, sa dernière fille, née en Egypte. Il ne l'a vue qu'une seule fois, en juillet 1963, lors de son passage clandestin à Kinshasa. Aussitôt, Mulele et Abo sont discrètement conduits à une voiture militaire. On emmène la délégation dans la cour de Bobozo, à l'état-major. Dix-huit heures. Le crépuscule. La parcelle entourée de lampadaires déjà allumés. Trois longues tables chargées de nourriture. Des généraux en uniforme. Kabamba reconnaît le général Niamasekua au moment où il refuse ostentatoirement de serrer la main au chef maquisard. Des journalistes s'empressent autour de Mulele. Ebahie, Abo regarde un poste de télévision: des images de l'arrivée de Mulele, puis, sans transition, un prêtre, chantant une messe de requiem. Makindua, Abo et Kabamba s'assoient à l'écart, sans rien se dire - à côté d'eux, ce sont certainement des agents de la Sécurité -, enregistrant, le désespoir aux yeux, la mise en scène à laquelle ils ne comprennent rien. A vingt-trois heures, Mulele, Abo et Makindua sont déposés à Léo-Kalina, dans la parcelle de Justin Bomboko où ils passeront la nuit. Quand on entre dans la parcelle, la vaste demeure de Bomboko se trouve à gauche, la maison de ses hôtes en face, à droite. Salon, salle à manger, puis un réduit où dormira Joseph Makindua. Au premier étage, une chambre à coucher toute blanche. La femme de Bomboko apporte quatre belles pièces de wax. - Demande à Thérèse Mulele d'en confectionner un boubou, pour le jour où le président te présentera à la population, au stade. - Tu vois le bon accueil que nous te réservons, dit Bomboko, il n'y a pas de militaires ici, n'aie donc plus d'inquiétude. C'est la première fois de leur vie que Mulele et sa femme dorment dans un lit normal, confortable et doux, mais ils savent que cette douceur est traîtresse, que ce confort meuble l'antichambre de la mort. Le lendemain matin, plusieurs dizaines de personnes viennent rendre visite à Mulele. Cinq militaires en civil, devant la parcelle, prennent note de leur identité. La mère de Pierre est là, Thérèse, sa sœur et tous ses enfants, Hygen, Gauthier, Germaine, Godelieve, Jeannette et Abiba, la petite. Léonie rencontre Henriette Malanda, la fille de Casimir Malanda, devenue magistrate après ses études en Union soviétique. - Tu sais, Léonie, hier, beaucoup de gens se sont rués au beach. Ils voulaient vous faire fuir. Ils se méfient. Un grand nombre d'entre eux venaient du camp Lukamambu, entre Kitambo et Bandalunga, où l'on a parqué les Bayaka et les Basuku. Ici à Kinshasa, les gens du Kwango sont tireurs de pousse-pousse, domestiques ou chômeurs, ils constituent la classe la plus opprimée. - Non, j'ignorais ça, je ne suis jamais venue à Kinshasa. - Eh bien, ces gens sont très forts et courageux, ils ne veulent pas que les militaires tuent Mulele. Après le repas de midi — Abo n'arrive pas à avaler quoi que ce soit - Mulele s'entretient avec quelques vieux Bam-bunda. Germain Mwefi prend Abo en aparté. - Ça tourne mal, je suis sûr qu'il va arriver quelque chose, le bruit court qu'on va tuer Mulele. Dis-lui de tout faire pour fuir. Mulele les rejoint, intervient. - Qu'as-tu dit, Germain? - Dehors, j'entend des murmures qu'on va te tuer. - Laisse la femme tranquille. Je sais que je vais mourir, mais je mourrai seul. Maintenant, je suis entre les dents du lion. Comment pourrais-je m'enfuir? Si je fuis, ils tueront beaucoup de monde. Qui, alors, va continuer la révolution? Le soir, Mulele non plus ne parvient pas à manger. Enrhumé, il ne cesse de tousser, ses maux de tête ne le quittent plus. La matin du premier octobre, le va-et-vient incessant reprend, des natifs du Kwilu-Kwango surtout qui veulent parler avec Mulele. Léonie, comme les enfants de Pierre, reste à l'écart, toutes ces palabres n'ont plus le moindre intérêt pour elle. Dans sa tête, elle tourne et retourne une seule question: sera-ce la vie ou sera-ce la mort? Il sera tué, a dit Germain. Il sera présenté à la population, a dit Thérèse. Comment savoir? Une jeune fille se présente. Marguerite Ndulanganda, l'enfant de l'oncle Jacob, grâce à qui Abo a pu fréquenter l'école. Leur première rencontre. Marguerite apporte des nouvelles de la famille. Monique Ilo et son enfant Ibulabit sont enfermés à la prison d'Oshwe. Avec ton frère Delphin Mbumpata et ton oncle Louis Mimpia, l'ancien chef de secteur de Lukamba. Et Joseph Mankienge, ton oncle de Kikwit. Puis Marguerite hésite longtemps. - Rémy Makoloni aussi a été à Oshwe. Quand il a quitté la prison, il était déjà malade. Tu sais, on y empoisonne les gens. Après sa sortie, Rémy ne travaillait plus, il a rejoint son père à Matende Mazinga. Il n'a pas voulu se remarier, il t'aimait beaucoup. - Oui, nous nous aimions bien. Mais il y a eu le maquis. - Tu sais, Rémy se promenait souvent en solitaire en forêt et en brousse. On le voyait revenir de la Labue, il se battait, seul, contre un adversaire fantôme. En gesticulant, il est tombé. Mort. C'était en juin dernier à Matende Mazinga. Le matin du 2 octobre, Germain Mwefi se présente tôt. - Mobutu rentre aujourd'hui. Nous nous inquiétons pour toi. - Maintenant je ne peux plus rien faire. Je ne suis pas venu à Brazza pour aboutir à Kinshasa. Il y a eu un changement de gouvernement là-bas et cela m'a amené ici. Il y a trois choses, la naissance, la vie et la mort. J'ai vécu, j'ai semé des graines partout, elles ne sont pas tombées sur les pierres mais sur la bonne terre, elles vont pousser. Si je meurs, vous continuerez. J'attends maintenant mon dernier jour. Mulele, jusque-là debout, s'assied. Ils étaient huit à l'écouter. La femme de Bomboko vient s'informer si Thérèse a déjà confectionné un boubou. Léonie lui montre les quatre wax, toujours au même endroit, par terre dans un coin. Vers trois heures, une dizaine de femmes entrent dans la cour. Parmi elles, la mère et Thérèse. Peu après, un homme en civil amène une petite VW devant l'entrée. - Mobutu est arrivé, les officiers, la population, tout le monde vous attend au stade Tata Raphaël. Henriette Malanda offre à Léonie un boubou d'un vert violent et deux pagnes jaunes à dessins huit-huit. La voiture part, Mibamba devant, Abo derrière, entre Pierre et Thérèse. Personne ne dit mot. La VW quitte la grand-route et prend un chemin goudronné. Thérèse s'exclame: - Mais c'est le chemin du camp Kokolo! Mulele ne dit rien. Sa main serre le bras d'Abo. Ses ongles s'y enfoncent. Ça fait terriblement mal. La voiture s'arrête dans la cour intérieure de la prison autour de laquelle les bâtiments forment un cercle. Cinquante militaires en uniforme cernent immédiatement Mulele et le conduisent vers le fond de la cour. Léonie et Thérèse reviennent sur leurs pas, vers le corps de garde à l'entrée. Frappée de stupeur, Abo y aperçoit Bengila, les mains sur l'appui de fenêtre. Il a vu Pierre sortir de la voiture. Bengila se retourne et sourit à Abo, de son éternel sourire de jeune lycéen... - Ah, Abo, fait-il, vous êtes venus ici pour que nous mourrions tous ensemble? Puis les militaires le dirigent vers la porte par où Pierre a disparu. Quelques minutes plus tard, un militaire remet à Léonie la montre, la ceinture et les chaussures de Pierre. Entre-temps, tous ceux qui se trouvaient dans la parcelle de Justin Bomboko ont été emmenés en camion. Conduits à la prison de Kokolo, les femmes et les enfants sont parqués dans une grande salle vide au premier étage. On y trouve la mère de Mulele, Abo et Andzwal, sa belle-sœur, mariée à Félicien Ebanga, Thérèse et Henriette Malanda puis cinq autres femmes. Anita et Catherine, les deux filles de Bengila, Faustin, le fils de Thérèse et cinq enfants de Mulele. Devant la porte ouverte, quatre soldats en armes. A vingt heures, des militaires viennent chercher Léonie. Elle part, la montre de Pierre dans sa main. Dans le couloir, un militaire lui dit en kimbunda: - Je sais que c'est une montre magique. Cache-la. Ils vont te la prendre. Dans la cour de la prison se trouve une petite loge. Sept militaires l'y attendent. - Dans tes bagages, nous avons trouvé une petite calebasse que personne n'arrive à soulever. Qu'est-ce qu'il y a là-dedans? - Rien. Elle contenait le vin de palme du commandant en chef. - Cette calebasse pèse comme si la terre entière y était enfermée. - Elle est vide. - Au maquis, est-ce que d'autres hommes pouvaient coucher avec toi? - Est-ce que vous couchez avec la femme de Mobutu? Un moment de perplexité, puis les militaires entre eux: - Tu entends comment elle nous répond? - Voyez un peu comme ces gens là-bas sont têtus! - Vraiment, nous sommes sauvés. Si cet homme était resté dans la forêt, nous aurions tous trouvé la mort. A ce moment, un clairon sonne et les militaires poussent Léonie dehors. En traversant la cour, elle voit y entrer de grosses voitures noires. Les généraux arrivent, disent les soldats. Cette nuit, comme toutes celles qui vont suivre, femmes et enfants dorment sur le ciment froid, un pagne étendu sous le corps. Le lendemain, elles tendent l'oreille. Que se passe-t-il? Aucune information ne leur parvient. Des soldats leur servent des haricots rouges mélangés à du poisson salé et de la panse de bœuf. Un brouet primitif à la teinte noirâtre. Abo n'avale rien. Pendant une semaine, elle n'a aucune nouvelle de son mari, elle ne mange pas. Un lieutenant la convoque. Je te donnerai du pain et des boîtes de sardines si tu couches avec moi. Abo le fixe droit dans les yeux et s'en va. Qu'elle est loin, la prison de Gungu et son commissaire avec sa femme luba. Celui-là au moins offrait des mets exquis, même si je n'y touchais pas, par peur de l'okomin, le médicament qui oblige une femme à suivre un homme qu'elle n'aime pas. Imbécile de lieutenant avec tes maigres sardines. N'y va plus toute seule, dit la mère au retour d'Abo. Deux jours plus tard, au rendez-vous suivant, Abo emmène quatre enfants. Sur le bureau du lieutenant, l'appât, bien en vue: trois boîtes de sardines. - Pourquoi amènes-tu les enfants? - Ils me suivent. - Faut venir seule. Et d'un geste nerveux, il fourre ses sardines dans sa serviette. Abo maigrit à vu d'oeil, elle n'a rien mangé depuis douze jours lorsqu'une crise de mal d'estomac la frappe. Elle éprouve de la difficulté à respirer. La mère, assise sur le sol, pose la tête d'Abo sur ses jambes et, pour l'aider, comprime son thorax des deux mains. La mère pleure, convaincue que la fin de sa bru s'approche. Le seizième jour, Abo perd conscience, toutes les femmes pleurent et se lamentent. Les militaires de garde téléphonent au service d'ambulance. Puis ils préviennent Bobozo qui transmet la nouvelle au général Itambo: une femme se meurt, va voir. Un capitaine accourt et engueule les gardes: - Comment osez-vous téléphoner au chef de l'état-major? Itambo arrive et trouve Léonie inconsciente par terre. Les femmes, les mains sur la tête, gémissent, sanglotent. On évacue Abo vers la maison d'Itambo. Elle s'y affaisse, des soldats retendent sous la véranda. Itambo appelle les deux hommes de la garde. - Vous savez ce que cette femme a fait? Son mari a laissé ses partisans en brousse et vous osez embêter le chef de l'état-major? Vous avez pitié d'elle parce qu'elle est du Bandundu, comme vous. Vous avez trois mois de cachot. Le capitaine emmène immédiatement les deux coupables. Itambo se tourne alors vers les autres militaires. - Conduisez-la au dispensaire. Mais faites gaffe, si on lui enlève ses vêtements, elle peut disparaître. Vous êtes prévenus, si elle disparaît, je vous enterre tous les six! Au dispensaire, Abo reçoit une injection et avale les pilules qu'on lui donne. A son retour, les femmes lui tendent une bouillie de riz apportée par un visiteur. Les jours suivants, Abo mange un peu de pain que la mère a pu acheter. Elle se rétablit lentement. Ni les femmes, ni les enfants ne peuvent quitter la salle. En face, il y a un WC à l'usage de plusieurs groupes de prisonniers. Dès l'après-midi, le pot est plein, la merde déborde, se répand sur le sol. Puanteur infecte, nauséabonde. Des prisonniers sénégalais courent aux toilettes avec une vieille cafetière remplie d'eau pour se laver le cul. L'eau et la merde s'écoulent dans le couloir. La petite Abiba les provoque. Dès qu'un Sénégalais s'amène avec sa cafetière, elle s'écrie: - Sé négalais na mulangi na WC!Un Sénégalais avec sa bouteille dans le WC! Henriette Malanda est libérée de cet enfer après trois semaines. Puis on autorise plus de visites, les familles apportent des victuailles que les femmes se partagent. La mère, Léonie, Thérèse, les filles de Bengila n'ont plus personne dehors. Les semaines passent. Puis les mois. Abo se sent complètement vide, elle est sourde et muette. Un jour, début janvier 1969, un gradé vient dire aux femmes de partir. Vous êtes libres. Toute la famille suit Thérèse, à pied, jusque chez elle. On y trouve les deux sœurs de la première femme de Pierre Mulele, Clémentine Musangi. Elles rapportent le bruit qui circule en ville selon lequel Pierre et Théo ont été assassinés ensemble. Le lendemain, la mère, Abo et les enfants s'en vont occuper la maison de Mulele, 115 rue Tumba à Bandalunga. L'eau et l'électricité y sont coupées. Comme il y a beaucoup de lumière dans la rue, Abo passe toutes ses soirées et ses nuits assise sur une chaise sous la véranda. La mère et Annie y dorment sur un pagne jeté à même le sol. Abo somnole mais ne dort pas. Elle ne mange presque rien. Elle sent sa vie glisser à petits coups vers sa fin. Au bout d'une semaine, une forte fièvre l'abat. Elle avale deux comprimés de flavoquine, puis, les ayant aussitôt oubliés, en absorbe deux autres. Son corps se met à trembler, un froid terrible l'envahit, son cœur bat à tout rompre. A demi consciente, elle ne répond plus aux questions de la mère. Un taxi. Au dispensaire. On lui vide l'estomac, croit à une tentative de suicide. Dorénavant, la mère ne la quittera plus des yeux. L'abbé Pierre Kayembe rend visite à la famille. Le 27 juillet 1963, quand Mulele et Bengila sont partis pour organiser le maquis, il les a accompagnés en voiture jusqu'au pont de Ndjili. Il faut s'y résoudre, dit-il, Pierre a été assassiné. Les hommes qui l'ont tué, on les a liquidés ensuite pour qu'ils ne parlent pas. On libère les hommes de la prison début février. Joseph Makindua rejoint Abo et la mère. Toute la journée, il reste sur sa chaise à côté de la porte. Le menton dans la main, les doigts sur la bouche, il fixe le ciel. - Non, Pierre n'est pas mort, il reviendra. - Viens Joseph, on va manger. - Pierre arrive, il arrive. - Nous ne pouvons plus rien faire ici, Joseph. - Si, Pierre va recommencer. Il est là. - Ne serait-il pas mieux que nous allions à Brazza? - Non, il ne faut pas le croire, Pierre n'est pas mort. Joseph a l'esprit troublé. Pourtant, les femmes aussi restent dans le doute. Tout le monde n'est pas persuadé que Mulele est mort. Les informations exactes, vérifiées, n'existent guère à Kinshasa. Alors, sait-on jamais? Mais petit à petit, la vérité s'impose à l'esprit. - Non, Abo, il est mort, dit la mère. Tu es là, nous sommes là, essaie d'oublier. Regarde-moi. Lui, il était mon seul garçon à s'occuper de moi. Maintenant je l'ai perdu. Abo se résigne. Nous avons perdu la lutte, j'ai perdu mon mari. A quoi sert encore la vie? La nuit, Joseph Makindua ne quitte pas sa chaise sous la véranda. Abo veille sur sa chaise à elle. Entre eux, sur un pagne, Annie et la mère qui s'éveille de temps à autre pour vérifier si Abo se trouve toujours à ses côtés. Ainsi se passent toutes les nuits. Les mois se succèdent. Début mars, Abo reçoit la visite de Bernadette Kimbadi, la première partisane qu'elle retrouve. Tendres embrassades, larmes brûlantes. Puis, une nouvelle apportée par Léo-nie Katassa: Antoine, mon frère, a envoyé quelqu'un de Brazzaville avec un message pour Abo, mais la police en a eu vent, le messager a dû se sauver. Lentement une idée s'impose à Abo. Il y a encore des gens qui veulent lutter. Je suis venue de Brazza, je dois retourner à Brazza. Elle s'en va chercher un laissez-passer au Pont Gaby, à la Grande Place, en compagnie de Germain Mwefi. Ils attendent, Mwefi debout, Abo assise. Un homme se place à la droite de Germain. Il regarde au loin et commence à parler en kimbunda. - Si tu vois la femme de notre chef qu'on vient de tuer, dis-lui de traverser. Le bruit court qu'ils se préparent à l'arrêter. Qu'elle parte vite. Le lendemain, conseil de famille. Le frère Félicien Ebanga ne peut pas donner son accord. Nous n'avons plus de femmes dans la famille. Viens avec moi à Mbuji Mayi, tu y seras en sécurité. Thérèse non plus ne veut pas que Léonie parte pour Brazza. Tu iras où? Ta famille se trouve-t-elle là-bas? La famille? Celui qui n'était pas au maquis ne peut pas comprendre. Awaka, Mabiungu, les autres mamans, Ebul, il y a eu tellements de morts dans la famille. J'ai trouvé ma nouvelle famille dans la brousse et la forêt. La famille des révolutionnaires. Mais voilà la défaite, l'échec. Pierre l'avait prévu. Après l'échec, il y aura une nouvelle lutte, plus forte, avait-il dit. Il faut que j'aille retrouver la famille des révolutionnaires. A Brazza. La coutume veut, continue Thérèse, que la veuve retourne au village. Les vieux connaissent le traitement pour une femme qui a perdu son mari. Oui, bien sûr, les vieux connaissent. Abo se revoit jeune fille à Lukamba. Elle s'y est souvent étonnée devant l'étrange spectacle de la femme ompfwel, la femme en deuil. Pendant des mois, elle garde les mêmes vêtements puants, les cheveux sales et en désordre, elle ne peut pas faire sa toilette ni se laver le corps. Elle baisse la tête devant les hommes. Le matin à cinq heures, elle doit éclater en sanglots de façon bien audible pour tout le village, de même qu'à cinq heures du soir. L'esprit de l'homme défunt continue à rôder autour d'elle. On impose à la femme une ceinture de chasteté pour que l'esprit ne puisse pas coucher furtivement avec elle. Si par malheur cela arrive, à l'instant même, la femme tombe raide morte, il n'y a pas à en douter. Abo ne retournera pas au village. Il n'y a plus personne pour m'y attendre. Les militaires viendront sûrement me tuer. Faut aller à Brazza. Là je trouverai des hommes pour continuer la lutte. Abo quitte la maison à quatre heures et demie du matin, avant l'aube, le 30 mars. Elle a pris une bonne dizaine de photos de Mulele, de Bengila, de Lumumba et de Gizenga dans l'album de famille. Elle arrive trop tôt au beach. Elle demande à un passant: - Comment fait-on? Je n'ai jamais traversé. Est-ce qu'ils fouillent les gens? Elle panique. Choisit une photo de Mulele qu'elle coud dans la doublure de son sac. Les autres photos, elle les déchire et en jette les morceaux. Le moment du départ approche. La femme du service de contrôle remarque son petit sac. - Tu reviens demain? - Oui. - Qu'as-tu dans ton sac. - Rien. - Vas-y. Mais demain, amène-moi de la bière Kronenbourg. Encore la tension pendant la traversée. Puis Abo se retrouve devant un immense bâtiment, elle le regarde, hôtel Cosmos, Brazzaville. Libre. Elle retire la photo de Pierre de son sac. La seule photo de Pierre Mulele qu'elle a pu sauver. Un jour, tous les enfants du Congo connaîtront la véritable histoire de cet homme. Présence du maquis - des massacres, toujours des massacres. Monguya à propos de l'assassinat de Mulele; l'exécution de la mère de Mulele. L'écho de la voix de Pierre Mulele. Une génération est passée depuis le jour où Abo a quitté le Congo-Kinshasa. Nous sommes le 30 juin 1990, vingt-et-un ans plus tard. Le majestueux fleuve Congo a déversé beaucoup d'eau dans la mer, beaucoup de cadavres aussi et pas mal d'illusions. Des mercenaires blancs venus d'Afrique du Sud, à l'époque de l'insurrection muleliste, ont eu tout loisir d'écrire leurs mémoires. Ils y ont fait étalage de leur haine des nationalistes et des communistes et multiplié leurs éloges au Pacificateur et à son Authenticité. Travaillant comme infirmière à Brazzaville, Abo n'a jamais quitté le maquis du Kwilu. Peu après son arrivée à Brazza, elle a appris le décès de Louis Mimpia, son oncle qui la logeait lorsque, enfant, elle fréquentait l'école primaire à Lukamba. Libéré de la prison d'Oshwe, il est mort quelques mois plus tard. Empoisonné. Joseph Mankienge, son oncle qui vivait à Kikwit, n'a pas survécu non plus au poison administré à Oshwe. A mesure que les années passent, le maquis dévoile petit à petit ses secrets restés dans l'ombre. Mais Abo est toujours sans nouvelles de certains maquisards. Louis Kafungu, le plus courageux entre les combattants, qu'a-t-il fait depuis notre séparation, le 22 mars 1966? Abo a capté une information disant que Kafungu, retiré dans la région de Ngashi-Kilembe, n'a pas cessé le combat contre les militaires jusqu'en 1970. C'est alors que l'armée aurait eu raison de lui. Mobutu l'a amené à Kikwit où Kafungu, fermement ligoté, a été traîné derrière un camion, les pierres et les cailloux lui enlevant la peau. Un autre visiteur dira que la population a été réunie au stade de Kikwit. Sadiques, les militaires ont arraché au chef muleliste sa barbe et ses cheveux pour les enfoncer dans sa bouche et y mettre le feu. D'autres disent que les soldats l'ont torturé en lui enlevant les dents, le sang coulant abondamment de sa bouche, supplice auquel le célèbre chanteur Abong fait allusion dans une de ses ballades. Mais Abo ne sait toujours pas comment les militaires ont finalement achevé le grand guerrier qui portait si fièrement son chapeau aux plumes de mpung. Au cours de ces vingt-et-un ans, Kinshasa a connu pas mal de jours de fièvre. Le 4 juin 1969, cent étudiants de l'université de Lovanium ont été massacrés. Histoire d'éradiquer la subversion marxiste-léniniste. Abo en a eu le cœur serré: dommage qu'ils ne soient pas montés aux barricades quelques années plus tôt, lorsque nous nous battions au maquis du Kwilu. Avec quelle joie les paysans, les coupeurs de noix de palme, les instituteurs et les infirmiers auraient accueilli les cadres intellectuels ! Le 15 août 1985, saisi par l'effervescence mystique, Kinshasa a commémoré une religieuse noire. En 1964, elle avait été percée par une lance rebelle en défendant sa virginité. Ce 15 août-là, dans un duo habilement mis en scène, Mobutu et le Pape Jean-Paul II ont proclamé la sainteté d'Anuarité Nengapeta. Ils en ont fait le symbole de la méchanceté des rebelles. Le pape veut que nous commémorions Anuarite, dit Abo à ses deux filles, pour que nous oubliions les dizaines de milliers de villageois tués par les mercenaires blancs qui prétendaient défendre l'Occident chrétien. Aux yeux d'Abo, ce culte artificiel d'Anuarité n'est qu'une drogue administrée au peuple congolais pour qu'il oublie ses véritables héros. Les jours de fièvre et les jours de deuil ont été tout aussi nombreux dans les autres coins du Congo mais leurs échos, affaiblis, ne parviennent à Brazza qu'avec un retard considérable. Il y a eu les massacres au Shaba en 1977 et en 1978, les tueries à Katekelayi en 1979, le bain de sang à Moba en 1985, la terreur au Nord-Kivu en 1986. Lors d'un séjour en Belgique, Abo apprend les détails du massacre des étudiants que l'armée de Mobutu vient de perpétrer à Lubumbashi dans la nuit du 11 mai 1990. Les chiffres avancés varient entre cinquante et deux cents morts. La presse rapporte comment les troupes de la Brigade Spéciale Présidentielle, entraînées par des Israéliens, ont torturé et éventré des étudiants au poignard et à la machette. Des étudiants, achevés à la baïonnette, ont été jetés dans la brousse. Plusieurs récits mentionnent que les militaires ont amputé certains étudiants des mains et des bras. En février 1989 aussi, des militaires avaient tué des dizaines d'étudiants à l'IPN et dans d'autres instituts de Kinshasa. Une étudiante été amputée d'un sein à la baïonnette. Abo constate que les atrocités barbares, commises en 1964-1965 sur les villageois, s'étendent aujourd'hui aux intellectuels. Est-ce que ceux-ci prendront finalement le parti de leurs parents, les villageois, les paysans et les ouvriers, dans le combat contre l'impérialisme et la dictature? Abo a deux filles, Ghislaine et Eulalie. Ghislaine, elle l'a mise au monde le 6 juin 1974 à Brazza. Elle lui a donné un deuxième nom, Labon, en mémoire de sa mère, morte en lui donnant le jour. Et elle l'appelle aussi Patience, parce qu'elle a attendu cet enfant si longtemps. Eulalie est l'enfant d'Agnat, fille d'Agnang, fille d'Okal Olam, la sœur de Labon. Okal Olam que la foudre a tuée, laissant un coq au splendide plumage sur les lieux. Eulalie est née le 10 septembre 1971 à Matende. Les difficultés de la vie au village ont amené ses parents à l'envoyer chez sa grand-mère Léo-nie. Ghislaine et Eulalie écoutent l'histoire d'Abo et se demandent si elles auront autant de courage que leur mère. Au hasard des causeries, elles prennent connaissance des événements du maquis du Kwilu et des tueries abominables perpétrées par l'armée. Qui en dira l'effet sur leurs cœurs trop tendres? Abo leur a conté ses voyages en Europe, à Paris et à Bruxelles en 1984, puis en 1986. Elle y a rencontré Daniel Monguya Mbenge, qui, en 1966, au moment où Mulele et Abo se trouvaient non loin d'Idiofa, régnait sur Kikwit en tant que vice-gouverneur de la province du Bandundu. Dans un livre publié en 1977, il a écrit ceci: "II n'y a pas eu moins de trois mille assassinats sous les ordres du colonel Monzimba au camp militaire, situé vers la plaine d'aviation, lieu surnommé par le colonel: la Boucherie Nationale de Kikwit. Dans un seul puits, des familles entières ont été enterrées vivantes par les militaires. " Lorsqu'il a rencontré Abo, Monguya a dit, la voix tremblant d'émotion: - Madame, dans l'histoire du Congo, votre mari est un personnage immortel; toute ma vie, j'aurai des remords et je me ferai des reproches pour avoir aidé à barrer la route du succès à Pierre Mulele. Oui, Monguya connaît aussi la version de la mort de Mulele qui circule dans les milieux dirigeants de Kinshasa. Elle vient de Bomboko, lourdement impliqué dans cette affaire. Elle a été confirmée par Nguza Karl i Bond dans un livre où il déclare que «Mulele fut tué dans des conditions indescriptibles, on lui arracha les yeux avec des baïonnettes». Les militaires ont voulu assassiner Mulele à la façon dont ils ont mis à mort d'innombrables villageois du Kwilu. Au couteau, ils lui ont coupé les oreilles, puis le nez, puis les organes génitaux. A la dague, ils lui ont sorti les yeux des orbites pour les arracher ensuite. A la machette, ils lui ont amputé les bras, puis les jambes. Le film "CIA - Cruauté Impitoyable Autorisée" de l'Italien Guiseppe Ferrara reconstitue cette scène insoutenable. Lorsque Eulalie l'a vue en 1989, elle n'a pas pu supporter ces images et, d'horreur, a fermé les yeux, rageusement. Eulalie n'a qu'un vague souvenir des événements qui ont meurtri Matende, son village, en 1978. Elle les découvrira avec Léonie, de nombreuses années plus tard. En voici une reconstruction. En 1970, une nouvelle danse fait rage dans la région d'Idiofa: la lazare. Tous les dimanches, des milliers de personnes se retrouvent dans un village choisi. Au début de la lazare, un homme est supposé mourir. Les villageois dansent pendant de longues heures autour d'un cercueil, provoquant, finalement, la résurrection du défunt à la manière de Lazare. Message limpide: Lazare n'est autre que Mulele. Mobutu envoie l'armée dans les villages interdire tout rassemblement pour danser la lazare. En 1971, pour la première fois, des bruits courent que Pierre Mulele serait dans la région. Un Mutetela du nom de Martin Kasongo Mimpiepe se cache dans la forêt, prêche une nouvelle religion et prétend être Pierre Mulele ressuscité. En novembre 1976, à Brazzaville, Léonie prend connaissance d'une lettre que Thérèse Mulele a adressée à Gauthier, le fils de Pierre. Ton père est vivant, dit-elle en substance, Ngampen, un garçon de Lukamba est venu en témoigner; il nous a apporté des chèvres, des poulets, des sacs de fouiou que Pierre nous envoie. Notre mère a déjà pris la route avec Ibulabit. Gauthier, qui vit chez Abo, lui demande conseil. - Ce sont des histoires. Il faut savoir que ton père a été assassiné. C'est incontestable. Et pourtant, toute la population entre Kikwit, Idiofa et Gungu reste convaincue qu'un jour Mulele reviendra. Avec l'arrivée de la mère de Mulele à Lukamba, en 1976, la secte de Kasongo prend une grande extension. François Mbwangala, le grand frère d'Abo, celui qui a arrangé son premier mariage, organise des collectes pour soutenir la nouvelle révolution. Des jeunes construisent des bivouacs à Esiet Lankat, à l'endroit même où Mulele et Bengila ont commencé le maquis, le 2 août 1963. Un nombre croissant de villageois entrent en religion. En s'excusant, l'un d'eux dira plus tard à Abo: - Tu sais, tout le monde avait tellement l'amour de la révolution... Un jour, début janvier 1978, à la pointe de l'aube, une foule d'adeptes du prophète Kasongo se trouve entassée dans l'église de Mulembe, lorsque l'armée surgit et ouvre le feu sans le moindre avertissement. Sous le sifflement des balles, les villageois cassent la clôture et fuient dans toutes les directions, laissant des dizaines de cadavres sur le terrain. Des amis portent Delphin Mbumpata, le frère d'Abo, atteint par les balles, jusqu'à Banda Buzimbila d'où il sera évacué vers l'hôpital de la mission de Matende Iwungu. Le lendemain, les militaires arrêtent Nestor Mbuun dans sa maison à Lukamba Bozombo. Ils l'abattent dans la rue au vu et au su de tous. Minkulu, Idiakungu et Mblmi, trois hommes de Mungai, tombent également sous les balles à Lukamba. En camion, les soldats reprennent leur route vers Matende Iwungu. Ils traînent Delphin Mbumpata de son lit d'hôpital et le tuent au milieu du village. Accompagné de sa femme, Théophile Mboko a pris la fuite vers Idiofa. Arrêté à Malele, il sera tué devant les villageois de Yassa Lokwa. Ntoma, le petit frère de Mulele, un des neuf garçons qui ont accompagné Abo au maquis, est fusillé par les militaires. Ntoma, le dernier enfant de l'oncle Ebul encore en vie. Les soldats exigent que les villageois leur disent où se cache Ignace Luam, la mère de Mulele. A Mulembe, ils abattent Etu Mbwun, un frère d'Ignace Luam. A Lukamba Bozombo, ils tuent Okul, la fille d'une sœur d'Ignace. Ils ligotent à la commande le fils d'Okul, Nestor Edzu. Mais celui-ci les maudit et crache en leur direction. Les militaires tirent une balle dans la tête du prisonnier ligoté. Puis ils tuent François Mimpembe, marié à une sœur d'Abo. Comme les militaires ne retrouvent pas la mère de Mulele, ils exécutent Kingoma, le chef du groupement Lukamba, qu'ils soupçonnent de complicité. D'après les rumeurs, Ignace Luam se cacherait chez la femme de François Mbwangala. Arrêté, ce dernier affirme qu'il ne sait pas où se trouve son épouse. François est assassiné sur place. Un jour plus tard, les militaires mettent la main sur Ignace Luam qui errait dans la forêt en compagnie de Théophile Mbwuni. Ils les emmènent à Lukamba Ingudi et commandent aux villageois de tabasser les deux prisonniers avec des planches et des pilons. Puis la mère est conduite en camion vers Matende. Ngampen, le garçon qui est venu la chercher à Kinshasa, sera pendu, avec d'autres prisonniers, devant la population de Gungu. Le 14 janvier 1978, Martin Kasongo Mimpiepe, le prédicateur, est traîné au stade d'Idiofa pour y être pendu avec quatorze de ses disciples. Comme tu es Mulele, lui auraient dit les militaires, tu pourras t'envoler encore et revenir à nouveau. Chaque nouveau témoignage, recueilli avec des années de retard, balance d'autres noms de victimes, amis d'enfance ou inconnus. L'armée a tué Kasongo Mumbwitshi et Kimpuili, l'enfant d'Idiakungu. Et Joséphine Kisenge. Ombul aussi a été abattu. Et Célestin, le père de Marie Mukulu, celui-là même qui apportait de la nourriture au camp d'Impasi Makan-ga. Il a payé de sa vie son attachement à la révolution. Ekwa-langa, le chef de Lukamba Bozombo, marié à Lasiel, la sœur d'Abo, chez qui Mulele s'est caché en juillet 1968, a lui aussi été fusillé. Pratiquement tous les hommes, femmes et enfants du village Mulembe ont été assassinés. Yuku, Nkata, Chamusila et tous les autres. Les rares survivants ont trouvé refuge dans les villages environnants. De Mulembe, rien ne subsiste. Dans la région, entre deux et trois mille villageois ont trouvé la mort sous la rage folle et aveugle des pacificateurs. De la fin d'Ignace Luam, beaucoup de versions différentes passent de bouche à oreille. Peu avant l'intervention de l'armée, elle avait percé à jour le jeu de Kasongo. Toi, tu as la peau très noire, avait-elle dit, tu ne peux pas être mon enfant. Mais oui, c'est moi, tu m'as oublié, avait répondu l'imposteur. Dans un rapport, rédigé le 28 avril 1978 par des gens de Lukamba et parvenu des années plus tard à Brazza, Abo lit ceci: "Les militaires lièrent la maman avec des cordes en formant une croix. Avant qu'elle ne soit fusillée, elle fit ces déclarations aux militaires: 'Vos mamans vous ont mis au monde; est-ce qu'elles savaient que vous deviendriez des militaires?' Les militaires tireront pendant longtemps sur elle sans que les balles ne l'atteignent. Ils la couperont en morceaux avec des poignards. Chaque partie sera enterrée à part. " La plupart des témoignages affirment que la mère de Mulele a été tuée à Kilembe. Avant de mourir, elle a dit: - Ce n'est pas moi qui ai envoyé mon fils dans cette révolution. Moi je suis sa mère, mais qu'est-ce que j'ai fait? Pourquoi est-ce que je dois maintenant mourir dans une affaire que je ne connais pas? Pourquoi ne m'avez vous pas tuée avec mon fils? Lorsqu'elle est entrée dans le maquis, à l'âge de dix-huit ans, Abo n'avait pas la moindre idée de la cruauté barbare dont était capable l'armée. L'impérialisme qui nous opprime depuis cinq siècles, ne cessait de répéter Mulele à l'époque, est un monstre sans pitié et les traîtres noirs qui, tout au long de ces cinq siècles, se sont mis à son service, ont les mains toutes rouges du sang de leurs frères. Au moment même, la jeune Abo ne comprenait pas. Maintenant elle comprend. Sans une lutte armée de libération, menée par les travailleurs et les paysans, dirigée par un parti révolutionnaire, le grand Congo ne sera jamais libre. Cette idée que Mulele et Bengila ont exposée mainte fois, ne s'est imposée que progressivement comme une vérité, à mesure qu'Abo a enregistré dans sa mémoire la suite interminable de mutilations, de meurtres et de massacres commis par l'ennemi. Au 9 juin 1963, Abo s'était installée chez les parents de Rémy Makoloni, à Matende Mazinga. Elle avait dix-huit ans, ne connaissait rien au Congo ni au monde et ne rêvait que de bonheur. Ce jour-là, Bengila, rentré clandestinement à Kinshasa, et Mulele, arrivé discrètement à Brazza, ont publié, au nom du Parti Solidaire Africain, un manifeste. "Le pays est tombé entre les mains d'une caste qui ne cherche qu'à s'enrichir d'une manière scandaleuse, rapide, révoltante, impitoyable au détriment des intérêts réels du peuple qui continue à mourir de faim et à être privé de ses droits essentiels. Il va de soi que nos frères réformistes et traîtres, qui servent d'intermédiaires aux compagnies et sociétés capitalistes et qui constituent directement ou indirectement le support d'une politique étrangère incompatible avec les intérêts nationaux, doivent subir les rigueurs de notre lutte d'affranchissement total, sous la direction d'un pouvoir populaire et démocratique. L'indépendance, si on la veut entière et totale, entraîne une lutte héroïque et implacable du colonisé parce que son acquisition implique un changement radical. La lutte sera dure et de longue haleine. C'est un leurre de croire que la décolonisation totale et réelle puisse se réaliser sans casse. L'histoire de l'humanité nous le prouve avec éloquence. Notre détermination dans la lutte nous donnera la victoire et celle-ci est inéluctable." Ces paroles ont été prononcées il y a vingt-sept ans. Au Congo, une génération est passée qui n'a jamais pu les entendre: Mulele et Bengila assassinés, leur voix a été étouffée dans le sang. Mais aujourd'hui que les interminables discours démagogiques de leurs assassins se perdent dans le vent, usés, élimés comme de vieilles loques, l'écho lointain de ces paroles si justes, si véridiques, si fières, de Mulele et de Bengila parvient, avec une force croissante, aux oreilles du peuple, désespérément à la recherche de la voie de sa libération. Août 1984 - novembre 1990 Ludo Martens, Bruxelles, Belgique * (1) A propos des différentes ethnies du Congo: au pluriel, on dit les Bambunda, les Bapende, au singulier: un Mumbunda, un Mumbala; l'adjectif est: mbuun, pende, mbala, la langue: le kimbunda, le kipende, le kiyanzi. Op de kaarten klikken voor een vergroting, sluiten of swipen om terug te keren. Carte 1, chapitre 3, 4 en 17 - Table de matières - Cartes Carte 2, chapitre 1, 2, 3, 4, 5 en 10 - Table de matières - Cartes Carte 3, chapitre 6-14 - Table de matières - Cartes Carte 4, chapitre 5-6-7-8 - Table de matières - Cartes Carte 5, chapitre 10-11-12-13 - Table de matières - Cartes Carte 6, chapitre 15 - Table de matières - Cartes Carte 7, chapitre 15-16 - Table de matières - Cartes Carte 8, chapitre 16 - Table de matières - Cartes
Photos (Repris du réédition Abo, Une femme du Congo, l'Harmattan, 1995) - Table de matières
Léonie Abo, debout, deuxième à partir de la gauche, au milieu d'une équipe de partisans. Photo prise le 31 juillet 1966 par Antoine Kayoko
Les partisans comptaient en moyenne 25% de femmes et déjeunes filles dans leurs rangs. A gauche, devant, Orner Bakanga
NelJy Labut, au milieu; à sa droite Hélène Pulese et à sa gauche Mathilde Manima. Nelly mena une équipe d'une vingtaine de jeunes filles et d'une dizaine de garçons dans la région du Bankutu, pour y implanter la révolution. En haut, deuxième à partir de la gauche, le commandant Ngwensungu. En bas, à droite, le frère de Léonie, Delphin Mbumpata, qui sera assassiné en 1978
Le commandant de zone Valère Munzele, menuisier de métier, au milieu de ses partisans. Il se noiera dans la rivière Kamtscha pendant l'attaque décisive, le 9 novembre 1967
De gauche à droite, debout: 1. Kabombo, 2. Jean Mawala (?), 3. Dieu-Mulele, 8. Barthélemy Mwanandeke, 9. Théotime Ntsolo, 10. Théophile Bulachard Isita 14. Onbekend, 15. Papa Michel Onsuil. Assis: 1. Valère Malutshi, 2. Valere Isita, 7. Omer Bakanga, 8. Dieudonné Ndabala, 9- Makila.
né Muku, 4. Inconnu, 5. Théodore Bengila, 6. Ankawu, 7. Pierre Mulele 11. Delphin Muzungulu, 12. Munzikatshive, 13. Zéphérin Langung, Munzele, 3. Vital Ipolo, 4. Joseph Okwono, 5. Pierre Ngwensungu, 6. Ri-
Le commandant du bataillon, Théotime Ntsolo, troisième à partir de la gauche, devant un bureau de la direction générale
Le commandant Ntsolo, avec à sa droite papa Kasaï et à gauche Dieudonné Ndabala, devant les hommes du bataillon
Le bureau de santé d'Impasi. L'équipe de filles de Léonie Abo -debout, à droite, avec un chapeau. Sur la photo, on voit Mathilde Manima, Flaurentine Muke, Marceline Muke, Véronique Muyasa, Eugénie Ente, Nelly Mumbongo et Hélène Pulese
Pierre Mulele à son arrivée le 29 septembre 1968 à Kinshasa. Léonie Abo embrasse la mère de Pierre, qui n'a d'yeux que pour sa plus J ne fille Abiba. Derrière lui, Joseph Makindua |